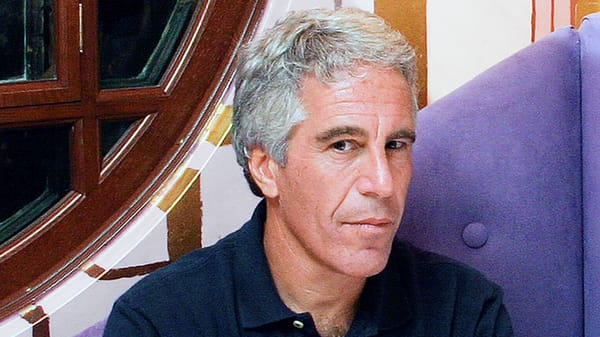Demain, mercredi 12 novembre 2025, l’Assemblée Nationale s’apprête à accomplir un acte hautement symbolique : voter, dans le cadre du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026, la suspension de la réforme des retraites de 2023. Cet événement, qui peut sembler n'être qu'une manœuvre budgétaire initiée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, est en réalité l'épilogue (provisoire) d'un fiasco politique majeur.

Il clôt une décennie d'obstination réformatrice qui aura vu l’exécutif échouer par deux fois : d'abord sur la réforme systémique par points en 2020, puis sur la réforme paramétrique de 2023.
On peut, bien sûr, analyser cet échec sous l'angle conjoncturel. Il est tentant de l'attribuer au manque de légitimité chronique d'Emmanuel Macron. Un président élu par défaut, porté au pouvoir par des scores faibles au premier tour et une abstention massive, ne dispose tout simplement pas du capital politique nécessaire pour bouleverser le contrat social le plus sensible des Français. Cette fragilité originelle a joué un rôle déterminant, nous l'avons souvent évoqué et annoncé.
Mais s'arrêter là serait manquer l'essentiel. Car derrière l'échec de l'homme, il y a l'échec d'une idée, ou plutôt d'une idéologie : celle du "jardin à la française".

La tyrannie de l'abstraction
Cette vision, portée historiquement par une haute fonction publique biberonnée au rationalisme cartésien et à la planification, rêve d'un ordre parfait, lisible, géométrique. Appliquée aux retraites, cette idéologie se traduit par une obsession : le régime universel. Un seul système, une seule règle, une parfaite symétrie où "rien ne doit dépasser". C’est l’application de la logique de l’ingénieur à la complexité du vivant.
Le projet élitaire a toujours été celui de la "simplification". Or, cette simplification n'est souvent que l'autre nom de l'abstraction. Les régimes spéciaux, la diversité des statuts, la prise en compte des histoires professionnelles ne sont pas, aux yeux du peuple, des anomalies à corriger. Ils sont le fruit sédimenté de notre histoire sociale, des compromis qui reconnaissent la réalité des métiers et des vies.
Vouloir raboter cette complexité, c'est refuser de voir le réel. C'est tenter de réduire le peuple à une équation mathématique, à une variable d'ajustement dans un tableur Excel de Bercy. Le vote de suspension de demain n'est pas seulement le rejet d'une mesure d'âge ; c'est l'illustration éclatante de la résistance française à cette mise au pas technocratique.

L'éternel retour du dogme
L'ironie de la situation est cruelle, et révélatrice de l'aveuglement de nos élites. Au moment même où l'on enterre la réforme de 2023, l'idéologie du jardin à la française refait surface, intacte, comme si rien ne s'était passé. Lundi, Gabriel Attal, figure emblématique de cette génération persuadée de détenir la vérité rationnelle, appelait déjà à une "véritable révolution" pour instaurer, enfin, ce fameux système "universel, clair et compréhensible".
Cet éternel retour du même démontre que la leçon n'a pas été apprise. L’échec n’est pas perçu comme la preuve de l’inadaptation du projet, mais comme une simple erreur de méthode. Le dogme prime sur l'expérience.
Le débat qui s'ouvre n'est donc pas seulement financier. C'est un affrontement fondamental entre deux visions de la société : celle d'une France uniformisée, rationalisée par le haut, et celle d'une nation qui assume la complexité organique de son modèle social. Demain, l'Assemblée Nationale ne fera qu'acter une réalité têtue : on ne gouverne pas un peuple comme on taille un buis.