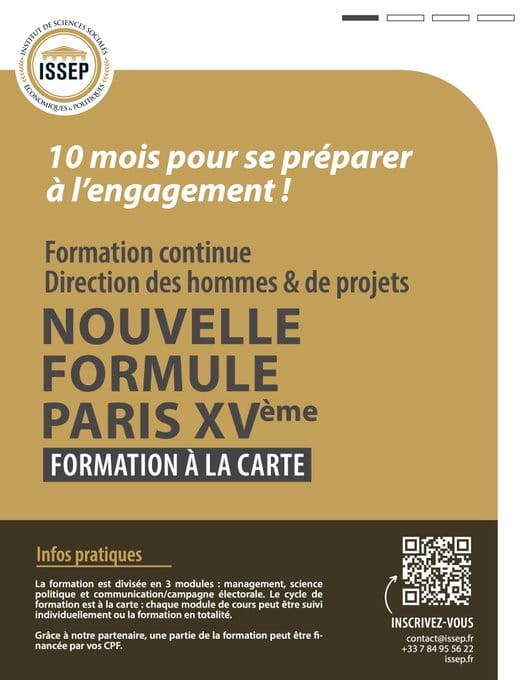Par JULIEN G. - Le 14 octobre 2021, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté une requête d’un Sapeur-Pompier Professionnel, qui contestait la suspension de son traitement pour non vaccination. Tous ces recours de soignants rejetés jour après jour, malgré des argumentaires solides et sourcées, posent légitimement la question de l’impartialité du juge administratif vis-à-vis de l’administration.
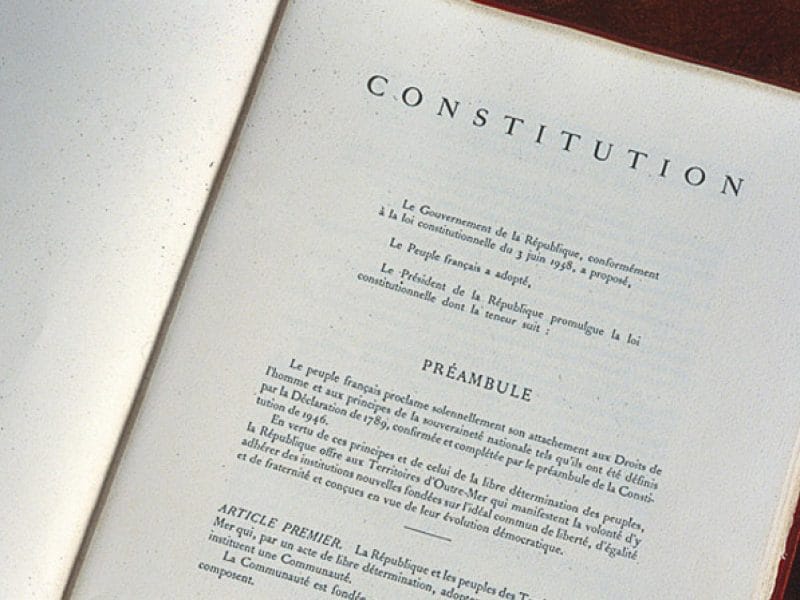
1.Des décisions de rejet qui s’accumulent et se ressemblent
Pour justifier sa décision, le TA de Caen a mis en avant 3 points :
- La décision de suspension qui n’est pas fondée sur l’existence d’une faute ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l’article 89 de la loi du 13 juillet 1983
- Le règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 a un objet étranger à l’obligation vaccinale
- Les autres moyens invoqués par M.XXX à l’encontre de la décision du 15 septembre 2021 ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision
Sur un référé de plus de 30 pages, le juge « bâcle » son rendu en trois petites conclusions.
En bref, circulez il n’y a rien à voir.
Au-delà d’un certain mépris des arguments, on peut se demander clairement si les juges n’ont pas de modèles types de rejet au vu du nombre de retour des TA qui se ressemblent beaucoup.
2.Les liens privilégiés avec l’administration qui perdurent
Deux qualités essentielles sont attachées à la fonction de magistrat : indépendance et impartialité. C’est la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 6§1) qui le dit mais en vérité la Convention ne fait que reconnaître des principes intrinsèques à la fonction de juge dans un État de droit.
Ce qui est en jeu, c’est un manque d’indépendance plus insidieux, indirect, qui tiendrait au mode de nomination des juges administratifs les plus « capés ».
Or il y a une différence importante entre la nomination des présidents du corps des tribunaux administratifs (TA) et des Cours administratives d’appel (CAA) et celle des présidents de section et du vice-président du Conseil d’État.
Les premiers sont nommés par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel, les seconds par décret en Conseil des ministres, comme les … directeurs d’administration centrale, ce qui, on peut le concevoir sans indignation, peut susciter quelques interrogations, d’autant que le même Conseil d’État est gestionnaire du corps des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel, et, par-là, décide de la nomination des présidents de TA et CAA.
Les modes de recrutement, en particulier pour les magistrats sortis de l’ENA et les détachés des administrations centrales, les mobilités statutaires au sein de l’administration, le déroulement de carrière, tout laisse à penser qu’il existe une très grande (trop grande ?) proximité des juges administratifs et de l’administration, et que les premiers sont peut-être trop prompts, de bonne foi la plupart du temps, à confondre l’action de la seconde et la poursuite de l’intérêt général.