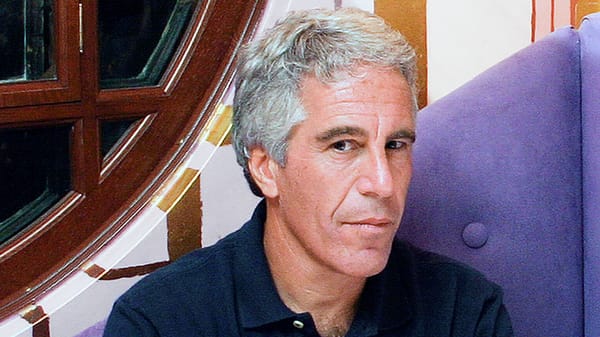Coup de théâtre à Antananarivo, le mardi 14 octobre 2025, à 16 heures, le colonel Michaël Randrianirina a annoncé depuis le Palais d’État d’Ambohitsorohitra la prise du pouvoir par l'armée, suspendant la Constitution et plusieurs institutions. Entre justification de “prise de responsabilité” et dénonciation d’un “coup de force”, Madagascar entre dans une nouvelle ère d’incertitude politique.

Le colonel Michaël Randrianirina a annoncé la prise du pouvoir par l’armée malgache. S’exprimant devant la presse, il a proclamé la suspension de la Constitution et la mise en place d’un Conseil de Défense Nationale de Transition (CDNT) pour une durée de deux ans. Cette annonce a été contestée par la Présidence sortante, qui dénonce un acte "illégal, irrégulier et inconstitutionnel".
Une “prise de responsabilité” selon l’armée
Le colonel Randrianirina, 51 ans, s’est défendu de tout “coup d’État”, préférant parler d’un “acte de responsabilité nationale”. Selon lui, l’État était en situation de vacance prolongée, sans Président, sans gouvernement fonctionnel et avec des institutions paralysées.
Face à ce constat, il a annoncé la suspension de la Constitution du 11 décembre 2010 et de plusieurs institutions jugées inopérantes : le Sénat, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), la CENI, la Haute Cour de Justice (HCJ) et le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie (HCDDED).
Seule l’Assemblée nationale a été maintenue “dans sa forme actuelle”, un geste interprété comme un gage minimal de continuité institutionnelle. Le colonel a également évoqué la création d’une “Haute Cour pour la Rénovation”, chargée de superviser la transition judiciaire et constitutionnelle avant un référendum et des élections générales.

Les justifications du pouvoir militaire : entre vide et accusations
Le discours de Michaël Randrianirina se veut celui d’un militaire “contraint d’agir” face au chaos. Il dénonce le “silence du pouvoir civil” depuis plusieurs jours et l’“abandon du pays par ses dirigeants”.
Il accuse en outre l'administration Rajoelina de “sabotages économiques” : coupures d’eau et d’électricité volontaires, enrichissements illégaux, favoritisme et corruption, et de désinformation ciblant les forces armées.
Le colonel cherche à se poser en restaurateur de l’ordre et de la souveraineté nationale, dans un pays frappé par la pauvreté et la défiance envers les institutions.
Mais ces justifications ne suffisent pas à dissiper les doutes : la “transition de deux ans” et la concentration du pouvoir entre les mains des militaires font craindre un retour à une logique de pouvoir fort qui pourrait éloigner le pays des principes démocratiques.
La HCC confie provisoirement le pouvoir au colonel Randrianirina
Dans une décision datée du 14 octobre 2025 (réf. n°10-HCC/D3), la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) a constaté la vacance du poste de président de la République et invité le colonel Michaël Randrianirina à exercer les fonctions de chef de l’État.
Le poste de président du Sénat étant également vacant, et le gouvernement jugé incapable d’assurer la continuité de l’État, la HCC a choisi de désigner “l’autorité la plus apte à agir”, incarnée par le colonel Randrianirina.
Cette décision survient où les forces armées avaient pourtant annoncé la suspension des institutions, y compris celle de la HCC.
La Haute Cour précise toutefois que cette délégation s’exerce “sous son contrôle” et pour une durée limitée, enjoignant le colonel à organiser des élections dans les 60 jours suivant la notification de la décision.
Cette décision, si elle confère une légitimité juridique a posteriori à l'intervention militaire, est immédiatement discréditée par la Présidence de la République sortante.
Celle-ci dénonce une décision « illégale, irrégulière et inconstitutionnelle », soulignant une saisine par une personne « non habilitée » (le vice-président de l’Assemblée nationale) et évoquant des pressions et menaces ayant entraîné l'évacuation des hauts conseillers de la HCC avant la clôture de la séance.
Les réactions et les défis immédiats
Les prochains jours seront décisifs pour observer la réaction des autres forces vives du pays :
- L'Armée : le soutien est-il unanime ou s'agit-il de l'action d'une faction ?
- La Société Civile et la Population : accepteront-elles cette transition sous contrainte ou manifesteront-elles leur opposition ?
- La Communauté Internationale (UA, ONU, UE, France) : la communauté internationale reste prudente, pourtant son rôle sera crucial. Reconnaîtra-t-elle la transition, au nom de la stabilité, ou la sanctionnera-t-elle comme un coup d'État, avec les conséquences diplomatiques et économiques que cela implique ?
La promesse d’un retour à la légalité dans deux ans dépendra largement de la capacité du CDNT à maintenir la stabilité tout en préparant des réformes crédibles et inclusives. Mais les précédents historiques à Madagascar – de 2002 à 2009 – rappellent combien les transitions militaires finissent souvent par s’enliser ou dériver vers l’autoritarisme.