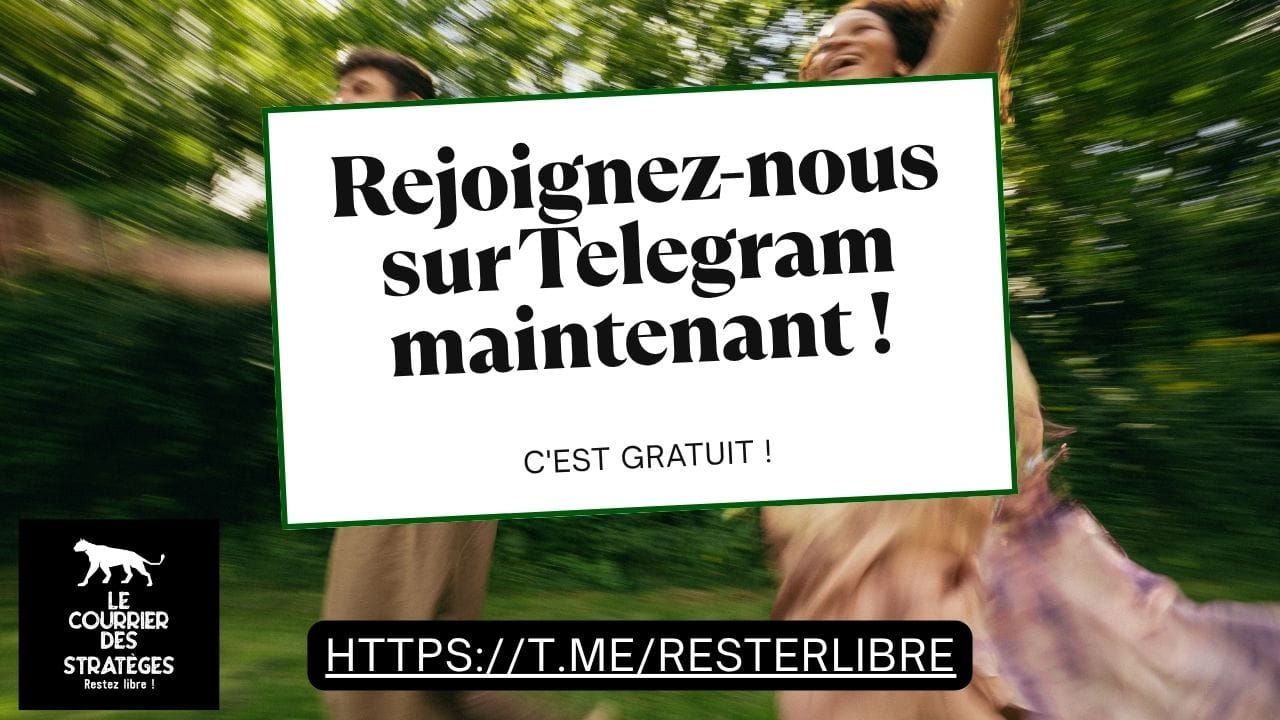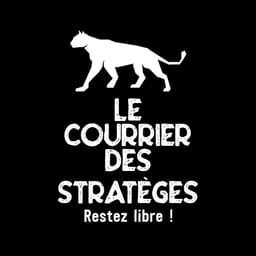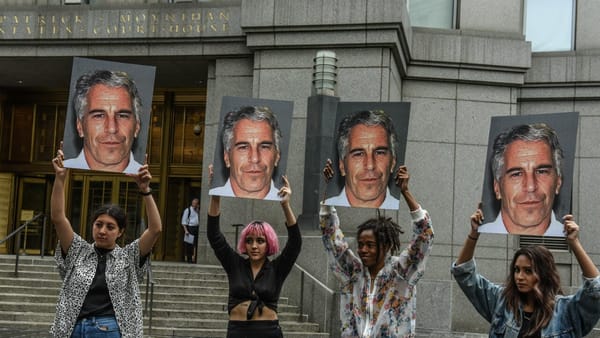Le boycott américain du G20 de Johannesburg révèle moins un désintérêt pour l’Afrique qu’une crainte croissante : celle de perdre le monopole de l’influence mondiale. En laissant le champ libre, Trump accélère paradoxalement la multipolarisation qu’il prétend combattre.
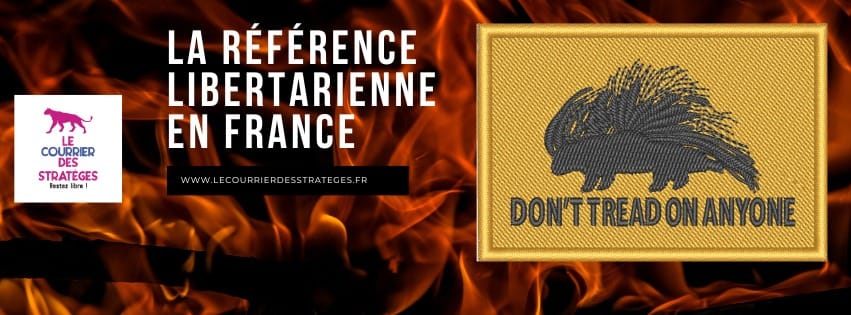
Pour la première fois, le G20 se tient sur le sol africain. Un moment historique pour l’Afrique du Sud, déjà membre des BRICS, qui cherche à consolider son rôle de puissance intermédiaire. Mais ce sommet marque surtout un tournant géopolitique majeur : le retrait volontaire des États-Unis, qui boycottent une réunion qu’ils présideront pourtant dès décembre. En s'isolant, les États-Unis offrent un boulevard aux puissances émergentes, actant l'accélération inéluctable d'un ordre mondial multipolaire.
Trump et le G20 : la peur américaine de la perte d’influence
Le retrait américain est officiellement justifié par des divergences politiques avec Pretoria, notamment les tarifs douaniers et la plainte sud-africaine contre Israël devant la CIJ. Dans les faits, l’administration Trump considère l’Afrique du Sud comme trop ouverte, l'Afrique du Sud est rejetée en raison de son adhésion à l'idéologie de la Diversité, de l'Équité et de l'Inclusion (DEI), que les Républicains combattent chez eux.
Mais derrière les prétextes, l’enjeu est ailleurs : Washington redoute la montée d’un bloc africain souverainiste, trop proche des BRICS, trop désireux de s’affranchir des institutions dominées par l’Occident. En boycottant, les États-Unis pensent affaiblir le sommet ; en réalité, ils le renforcent en révélant leur malaise stratégique.
En boudant le G20, l'administration Trump ne fait qu'une chose : elle renforce la position de l'Afrique du Sud et des puissances concurrentes. Le boycott, lourd de conséquences pour Washington, est une opportunité en or pour Pretoria de rallier les autres nations autour de causes cruciales comme la réforme de la dette et le financement climatique. L'Occident panique dès que l'Afrique ose affirmer sa souveraineté et son désir de diversifier ses relations, selon Mavis Owusu-Gyamfi de l'African Center for Economic Transformation.
Ce recul américain est la preuve que le modèle unipolaire est révolu. Les États-Unis craignent de se retrouver dans une enceinte où ils ne seraient plus les seuls maîtres du jeu, où ils devraient écouter, négocier, et concéder.

L’Afrique du Sud saisit l’occasion pour réaffirmer sa souveraineté
Loin d'être affaiblie, Pretoria profite du vide laissé par Washington pour affirmer son rôle pivot. Comme le souligne Mavis Owusu-Gyamfi, le monde commence à reconnaître que la stabilité globale dépend de la trajectoire africaine. Avec sa population jeune, ses minerais stratégiques et sa future importance géoéconomique, l’Afrique n’est plus un continent périphérique mais un centre de gravité incontournable.
Le sommet devient ainsi l'espace où se formule une stratégie de montée en gamme : quitter la dépendance à l'exportation brute pour créer localement de la valeur ajoutée. Une logique que l’Occident ne voit pas d’un bon œil, car elle signifie moins de dépendance, moins de contrôle — et plus de souveraineté.

Le chemin est long, semé d'embûches (corruption, chômage), mais ce G20 est un moment politique fort pour le continent. L'objectif, parfaitement aligné avec une vision libertarienne de l'autonomie, est de passer d'une dépendance à l'exportation de matières premières à une valeur ajoutée créatrice d'emplois. Pour y parvenir, l'Afrique doit se concentrer sur l'unité politique, obtenir une voix au CSNU et gagner en influence sur la gouvernance financière mondiale.
En choisissant l'isolement, les États-Unis ne sont plus les garants du libre-échange et de la souveraineté. Ce vide sera comblé par ceux qui, comme la Chine ou les autres membres des BRICS, sont prêts à s'engager avec l'Afrique sans imposer un carcan idéologique ou hégémonique. Le nationalisme protectionniste de Trump accélère, paradoxalement, la fin du monopole américain. En tournant le dos à Johannesburg, Washington offre la multipolarité sur un plateau d'argent.