Tandis que le marché électrique bute sur le coût, l'autonomie et les infrastructures, Vinci Autoroutes et Electreon déploient un tronçon d'autoroute à recharge par induction sur l'A10. Cette prouesse technologique, permettant de recharger en roulant, pourrait alléger le poids des batteries. Mais à quel prix, et pour quelle véritable libéralisation de la mobilité ?
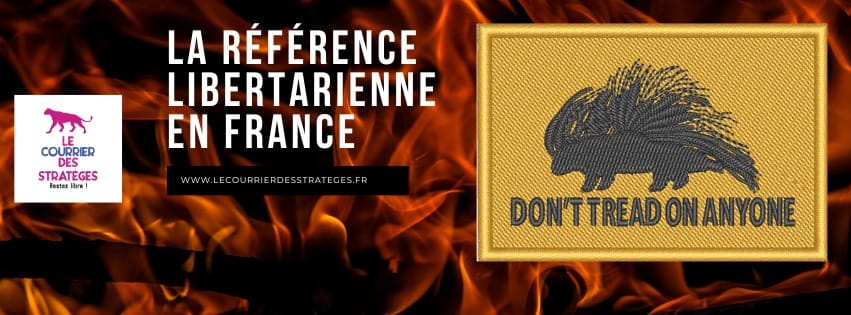
Sur l’A10, à Angervilliers, Vinci Autoroutes a inauguré un tronçon de 1,5 km où les voitures électriques peuvent se recharger par induction en pleine circulation. Un exploit technologique, présenté comme une révolution. Grâce à 900 bobines de cuivre intégrées sous l’asphalte, l’énergie est transmise sans câble, permettant à un véhicule d’accumuler jusqu’à un kilomètre d’autonomie par kilomètre parcouru.
Sur le papier, l’idée est séduisante : moins d’arrêts, des batteries plus légères, et donc moins de métaux rares. Mais à 6 millions d’euros le kilomètre, cette innovation frôle l’utopie économique.
Une autoroute pouvant recharger les véhicules électriques
Le projet, initié en 2023, vise à équiper une portion d’autoroute de bobines d’inductions capables de transmettre de l’énergie aux véhicules compatibles en utilisant la technologie de l’induction électromagnétique. Ces dispositifs fonctionnent comme les chargeurs sans fil pour smartphones. En d’autres termes, ils sont capables de recharger les véhicules en mouvement.
Plusieurs acteurs contribuent à la réalisation de ce grand projet. Il y a VINCI Autoroutes qui se charge de la mise en œuvre technique. La société israélienne Electreon offre la technologie d’induction.
L’Université Gustave Eiffel se charge de la supervision des tests scientifiques. Hutchinson, le spécialiste des matériaux industriels, apporte également son expertise dans la réalisation du projet. Bpifrance est le financeur.
Des essais en laboratoires et des tests en conditions réelles sur l’autoroute A10 ont déjà été réalisés. Selon les initiateurs du projet, ce projet avantagera les acteurs de l’industrie automobile et les propriétaires des véhicules électriques. D'une part, « la dépendance aux bornes fixes » sera réduite. Et d'autre part, les constructeurs pourront équiper leurs véhicules de batteries plus légères, plus petites et moins onéreuses.

Un modèle centralisé au service des grands groupes
Ce type de projet bénéficie avant tout aux géants de l’infrastructure. Vinci Autoroutes, qui contrôle déjà le réseau autoroutier français, s’impose ici comme acteur central de la « mobilité verte ». Sous couvert d’écologie, cette innovation renforce la dépendance des automobilistes à un système payant, connecté et surveillé.
De plus, cette solution maintient une dépendance forte à l'infrastructure routière existante, et impose aux automobilistes l'achat d'un véhicule équipé d'un "récepteur spécial", ce qui limite la liberté de choix et favorise certains acteurs.
L'argument de la réduction de la taille des batteries est louable, mais il ne résout pas la question fondamentale : pourquoi l'État doit-il forcer une transition qui ne se ferait pas naturellement, au risque d'imposer des coûts faramineux à la société ?
Les libertariens y verront une transition pilotée d’en haut, où la liberté de circuler se soumet progressivement à des réseaux fermés, contrôlés et subventionnés par l’État ou l’Union européenne.
Installer des routes à induction sur 10 000 km relèverait du fantasme budgétaire : cela coûterait plus de 60 milliards d’euros, sans garantir la compatibilité des véhicules.
Si la route à induction de l’A10 marque une avancée, elle ne résout pas les questions fondamentales : qui paiera, qui en profitera, et à quel prix ?











