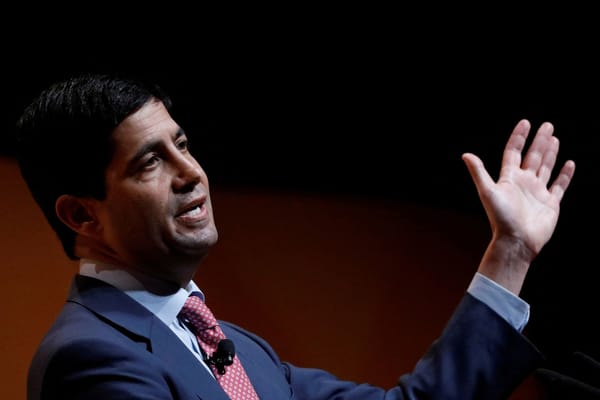L'analyse du paysage géostratégique mondial, en cette fin d'année 2025, révèle une intensification marquée de la compétition militaire entre les grandes puissances. Cette dynamique, caractérisée par une hausse record des dépenses d'armement, une modernisation accélérée des arsenaux, notamment nucléaires, et l'érosion rapide des cadres de régulation, confirme l'entrée dans une nouvelle ère de confrontation.

Voici une analyse détaillée de cette nouvelle course à l'armement.
1. Dans quelle mesure pouvons-nous parler d'une nouvelle course à l'armement ?
Nous pouvons affirmer sans équivoque l'existence d'une nouvelle course à l'armement, attestée par des indicateurs convergents et préoccupants :
- L'explosion des dépenses militaires : les dépenses militaires mondiales atteignent des sommets historiques. Selon les instituts de recherche comme le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), les budgets de défense ont connu ces dernières années leur plus forte augmentation depuis la fin de la Guerre Froide, stimulés par la guerre en Ukraine, les tensions en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
- La modernisation et l'expansion nucléaire : les neuf États dotés de l'arme nucléaire sont tous engagés dans de vastes programmes de modernisation de leurs triades (vecteurs terrestres, maritimes et aériens). Plus inquiétant encore, certains arsenaux sont en expansion rapide, notamment celui de la Chine, qui vise la parité stratégique avec les États-Unis et la Russie.
- La course technologique qualitative : la compétition se focalise sur les technologies de rupture qui remettent en cause les équilibres stratégiques : missiles hypersoniques (extrêmement rapides et manœuvrables), intelligence artificielle (IA) pour l'autonomie des systèmes d'armes, capacités cybernétiques offensives et militarisation de l'espace (armes anti-satellites).

2. Qui a relancé cette course ?
La responsabilité ne peut être imputée à un seul acteur. Elle résulte d'un changement systémique majeur : la fin de l'ère unipolaire dominée par les États-Unis et le retour à une compétition entre grandes puissances dans un ordre multipolaire contesté. Trois dynamiques principales convergent :
- La rivalité stratégique sino-américaine : c'est le facteur le plus structurant. La montée en puissance militaire fulgurante de la Chine et son assertivité régionale ont poussé les États-Unis à réorienter leur stratégie de défense pour contrer ce qu'ils appellent le "pacing challenge" (le défi du rythme).
- Le révisionnisme russe : la volonté de la Russie de réaffirmer sa puissance, culminant avec l'invasion de l'Ukraine, a provoqué un réarmement massif en Europe. Moscou investit dans des systèmes stratégiques novateurs (comme le drone sous-marin Poséidon ou les missiles hypersoniques) pour compenser ses faiblesses conventionnelles et défier l'OTAN.
- L'érosion de la confiance : le délitement progressif de l'architecture de sécurité internationale et le manque de dialogue stratégique ont créé un vide sécuritaire, favorisant une logique de compétition débridée.

3. Quel est le rôle de Trump dans une nouvelle prolifération de l'arme nucléaire ?
Le rôle de Donald Trump est central dans l'accélération de cette course et la déstabilisation de l'ordre nucléaire international. Son approche, marquée par le rejet du multilatéralisme et une préférence pour la démonstration de force, a favorisé la prolifération verticale (l'augmentation des arsenaux existants) en démantelant les cadres de contrôle.
- Le démantèlement des traités (premier mandat 2017-2021) : son administration a retiré unilatéralement les États-Unis d'accords cruciaux :
- Le JCPOA (Accord sur le nucléaire iranien) en 2018.
- Le Traité FNI (Forces Nucléaires Intermédiaires) en 2019, mettant fin à l'interdiction des missiles de portée intermédiaire en Europe et en Asie.
- Le Traité Open Skies (Ciel ouvert) en 2020, réduisant la transparence militaire.