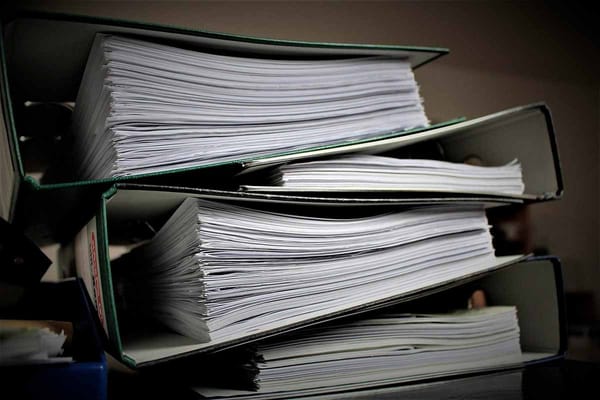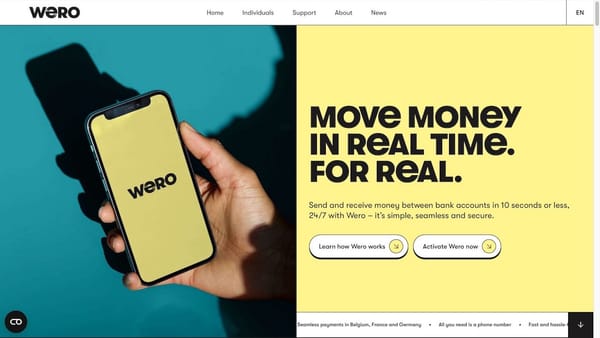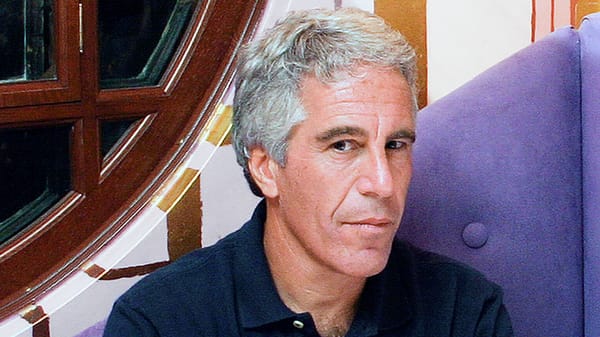Pendant vingt ans, la France a regardé passer la révolution numérique comme on observe un train depuis le quai. Nous étions parmi les pionniers du digital public — 4ᵉ au monde au début des années 2000 selon l’ONU — et nous voici aujourd’hui relégués autour de la 35ᵉ place. Ce décrochage n’est pas seulement une question de classement : il coûte des milliards d’euros à la collectivité, ralentit les services publics, et mine la confiance des citoyens dans l’efficacité de l’État.
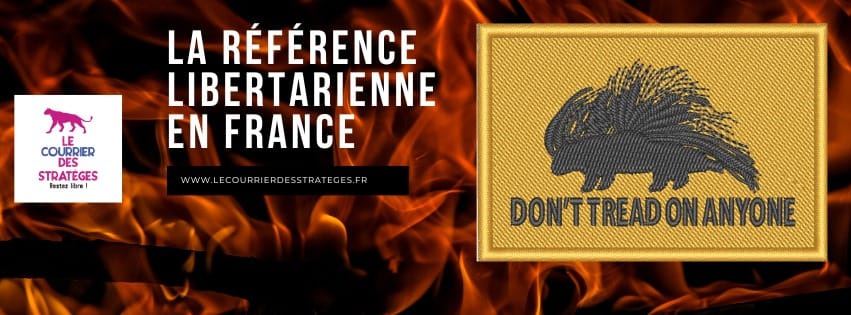
L’intelligence artificielle ne doit pas être vue comme une menace, mais comme une chance : celle de réformer non pas les citoyens, mais bien l’administration elle-même.
L’État numérique, un rêve français devenu cauchemar bureaucratique
Il fut un temps où l’administration française faisait figure de modèle. L’informatisation des services publics, la carte Vitale, les déclarations fiscales en ligne : tout cela avait placé la France à l’avant-garde de la modernisation de l’État.
Mais depuis, l’ambition s’est essoufflée. Les grandes réformes numériques ont été éclatées entre ministères, les projets pilotés en silos, les bases de données cloisonnées, les budgets grignotés par les urgences du moment. Résultat : un millefeuille technologique ingérable, où chaque service public vit dans sa propre logique informatique.
Dans le même temps, les pays les plus avancés ont fait de la simplification numérique une priorité politique. Le Danemark, souvent cité en exemple, a créé un portail unique pour tous les services publics — impôts, santé, emploi, sécurité sociale, démarches locales. Tout y est accessible en quelques clics, avec un identifiant unique. Le Royaume-Uni a fait de même avec GOV.UK, qui a permis d’unifier des centaines de sites et de supprimer des milliers de formulaires redondants.
Pendant que nous multiplions les guichets, eux les suppriment. Pendant que nous complexifions la paperasse numérique, eux la rendent invisible.

Le coût du retard : une dette cachée
Chaque formulaire inutile, chaque bug de portail, chaque document papier imprimé et renvoyé par la poste représente un coût. Ces coûts, les citoyens ne les voient pas directement, mais ils les paient à travers leurs impôts et le déficit public.
Selon les estimations du gouvernement britannique, le déploiement massif de l’intelligence artificielle et de l’automatisation dans l’administration pourrait générer jusqu’à 45 milliards de livres d’économies. Pas par austérité, mais simplement par efficacité.
En France, rien de tel n’est à l’ordre du jour. On débat de taxes, de coupes budgétaires, de “justice sociale” — pendant que la machine administrative tourne avec des logiciels du siècle dernier. Le coût de notre retard numérique est colossal : plusieurs dizaines de milliards d’euros gaspillés chaque année en doublons, en lenteurs, en procédures manuelles que des algorithmes pourraient exécuter mieux et plus vite.
Un État performant n’est pas un État orwellien
Dès qu’on parle d’intelligence artificielle dans l’administration, les réflexes de méfiance ressurgissent : surveillance, “Big Brother”, perte d’humanité… Pourtant, les pays les plus digitalisés sont aussi parmi les plus protecteurs des libertés publiques.