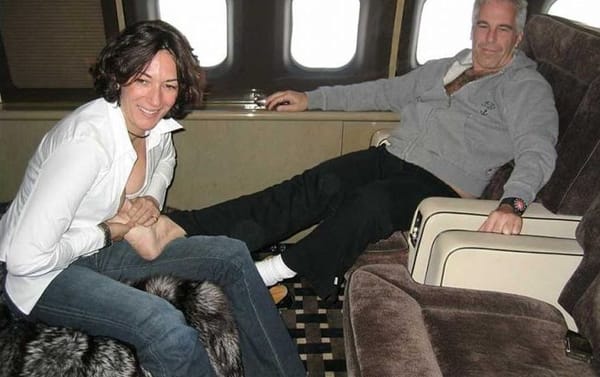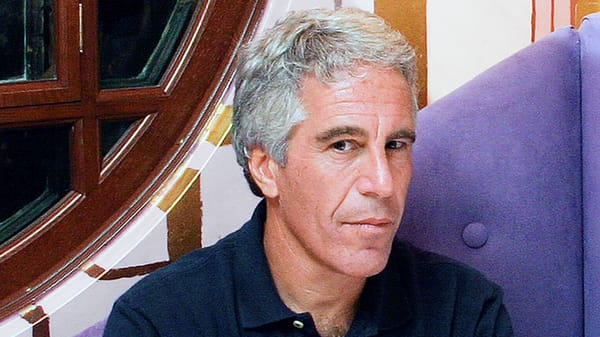À Antananarivo, le 25 septembre 2025, des milliers de manifestants se sont mobilisés. Ce qui a débuté par une exaspération face aux délestages insupportables – jusqu'à huit heures par jour – et au manque d'eau potable, a révélé une fracture bien plus profonde. Elle a allumé un brasier, poussant les Tananariviens et les habitants de l'île à exprimer leur désespoir.

La colère pacifique initiale s'est transformée en une journée de tensions extrêmes, de répression et de vandalisme, montrant l'impuissance du gouvernement en place et le ras-le-bol d'une population à bout.
« Leo Délestage » : une colère qui couve
Le mouvement « Leo délestage » (Marre des délestages) est une manifestation de l’exaspération généralisée, mais il se distingue par sa spontanéité et son mode d’organisation.
La mobilisation, portée par des élus de l’opposition à la mairie de la capitale, des influenceurs et la jeunesse (Gen Z), a adopté un symbole globalisé : le drapeau du Jolly Roger du manga One Piece, revisité "à la sauce malgache".
Les manifestants dénoncent la fréquence des coupures d’électricité, parfois prolongées plusieurs heures par jour, ainsi que les pénuries d’eau récurrentes qui affectent les foyers, les centres de santé et les entreprises. Le mot d’ordre « Leo » traduit un sentiment de lassitude face à des mois d’attente de solutions pérennes.

Face à cette mobilisation pacifique, la réponse des autorités a été brutale. Les manifestations ont été réprimées par des tirs de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, des arrestations musclées et arbitraires. Aucun communiqué officiel, mais selon les sources hospitalières au moins trois personnes décédées et une dizaine de blessés ont été recensées.
Impuissance de l'Etat à gérer la crise
La journée a basculé lorsque certains individus se sont dirigés vers des symboles concrets du pouvoir. Trois résidences de personnalités proches du président, comme la sénatrice Lalatiana Rakotondrazafy, ont été incendiées. Cette violence ciblée montrerait elle une radicalisation d'une partie des manifestants?

Au début de la soirée, un peu partout,les habitants ont enflammé des barrages à partir de déchets ou de pneus renversés au milieu de la chaussée. Des casseurs ont profité de la situation, qui a vite dégénéré en pillages généralisés de supermarchés, de banques et de centres commerciaux, sous les yeux de forces de l'ordre ayant reçu l'ordre de ne pas intervenir.
Le retrait des forces de l'ordre a laissé la place au chaos, symbolisant l'impuissance de l'État à gérer la crise. L'absence de réaction des autorités, à l'exception du préfet, est un signe d'un pouvoir affaibli et déconnecté de la réalité de sa population.
L'instauration d'un couvre-feu de 19 h à 5h, sera renouvelé ces prochains jours tant que l’ordre n’est pas rétabli, a indiqué le préfet d’Antananarivo. Actuellement, la situation reste très tendue, les pillages continuent dans certains quartiers de la ville et s'étendent dans les autres grandes villes.
La JIRAMA, symbole d'un État en faillite
Officiellement, le mouvement de protestation est né de l'incapacité de la compagnie nationale d'eau et d'électricité, la JIRAMA, à assurer ses missions les plus basiques. Pour les Malgaches, elle incarne l'échec cuisant du régime. Les usagers subissent une double peine : des factures en constante augmentation pour un service quasi inexistant.
Les promesses répétées de solutions – énergie solaire, barrages – n'ont jamais materialisé, laissant la population face à des réseaux vétustes et une gestion désastreuse. Cette crise énergétique, paralysant le quotidien et l'économie, est devenue le catalyseur d'une rancœur accumulée contre un pouvoir perçu comme sourd et inefficace.
Pour autant, depuis la tribune des Nations-Unies à New York, le président Rajoelina a évoqué un tout autre bilan: selon lui, “des progrès notables ont été réalisés” en matière d’accès à l’électricité, affirmant une hausse de plus de 66 % en six ans.
Les manifestations qui secouent Antananarivo sont la traduction d'une rancœur profonde. Les coupures d'eau et d'électricité ne sont que le révélateur d'un malaise plus grand, celui d'un pays qui s'enfonce dans le chaos depuis des années.
La répression de la protestation pacifique et la descente aux enfers de la capitale en une journée révèlent l'extrême fragilité du régime Rajoelina. Le silence des plus hautes autorités, hormis le préfet, est la preuve d'un pouvoir qui ne sait plus comment faire face à la tempête.