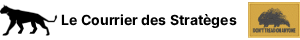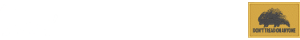Alors que les ""Epstein Files" ébranlent les élites mondiales, l’appareil d'État français et ses relais médiatiques dénoncent une ingérence russe. Sous couvert de lutte contre la désinformation, cette stratégie vise surtout à étouffer tout débat lucide sur les dérives oligarchiques.

La publication, fin janvier 2026, de millions de documents issus des archives de la justice américaine concernant Jeffrey Epstein aurait dû provoquer un séisme de transparence. Au lieu de cela, nous assistons en France à une manœuvre de diversion classique : la réduction d’un scandale de mœurs et de finance internationale à une simple opération de "guerre hybride" menée par Moscou. Emmanuel Macron, dont le nom apparaît au détour des fichiers, exhorte la justice américaine à "faire son travail", tout en laissant ses services de renseignement numérique saturer l'espace pour invalider toute critique.
L’épouvantail de l’ingérence russe
Le narratif officiel est désormais rodé. Pour chaque révélation embarrassante, le service Viginum et les agences de presse subventionnées dégainent les noms de codes : " Storm-1516 " ou "Matriochka". Certes, des contenus techniquement douteux, possiblement générés par IA, circulent sur les réseaux sociaux. L'usage de deepfakes et de sites miroirs est une réalité technique de notre siècle.

Toutefois, l'insistance quasi obsessionnelle sur la "main de la Russie" occulte le fond du dossier. En focalisant l'attention sur la forme — une vidéo mal doublée ou un faux article de France-Soir — le pouvoir s'épargne une analyse factuelle de la présence de personnalités françaises dans l’entourage du réseau Epstein. Le journalisme de préfecture préfère traquer des bots russes plutôt que d'enquêter sur les connexions réelles de l'oligarchie financière.
Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine, les accusations d’ingérences numériques se multiplient. L’organisation américaine NewsGuard affirme avoir identifié 561 sites qui publient régulièrement des contenus trompeurs favorables aux intérêts russes.
Moscou, de son côté, nie systématiquement toute implication dans ce type d’opérations.
La tentation du réflexe automatique
Toute contestation est-elle désormais qualifiée de « désinformation prorusse » ? Toute critique relève-t-elle d’une opération d’influence ?
À l’inverse, toute révélation alternative est-elle crédible sous prétexte qu’elle contredit la version dominante ?
La facilité serait de choisir un camp. La rigueur impose autre chose : vérifier les sources primaires, distinguer les documents authentifiés des productions anonymes, séparer faits judiciaires et interprétations politiques.
Le rôle des médias dans cette affaire est révélateur. Plutôt que de disséquer les millions de pages des "Epstein files" pour y chercher des délits financiers ou des trafics d'influence, l'effort journalistique se concentre sur le "débunkage" de rumeurs secondaires.
Cette méthode permet d'occuper le terrain informationnel. En invalidant une rumeur grossière , on discrédite par extension toute interrogation légitime sur les réseaux d'influence actuels. Le cartel médiatique ne corrige pas les mensonges pour servir la vérité, mais pour protéger le périmètre de respectabilité du chef de l'État.
La réponse politique : prudence et surveillance
Face à ces remous, Emmanuel Macron a déclaré : « que la justice américaine fasse son travail ».
Position de principe. Mais en parallèle, le gouvernement français renforce les dispositifs de lutte contre les ingérences numériques. Sous couvert de protection contre la désinformation, l’État pourrait étendre son contrôle sur l’espace numérique.

Le dilemme est réel. Protéger sans surveiller excessivement. Informer sans censurer. Deux biais peuvent coexister : manipulation étrangère et exploitation politique intérieure.

L’affaire Epstein révèle des réalités judiciaires troublantes. Mais elle expose d’un côté, des documents authentiques encore en cours d’analyse. De l’autre, des opérations de désinformation sophistiquées. Entre les deux, un public confronté à un brouillard permanent. La véritable question n’est peut-être plus seulement « que contiennent les archives ? ». Mais : qui contrôle le récit autour de ces archives ?
Dans cette guerre cognitive, la première victime n’est ni un camp ni un dirigeant. C’est la capacité collective à distinguer le fait du récit.