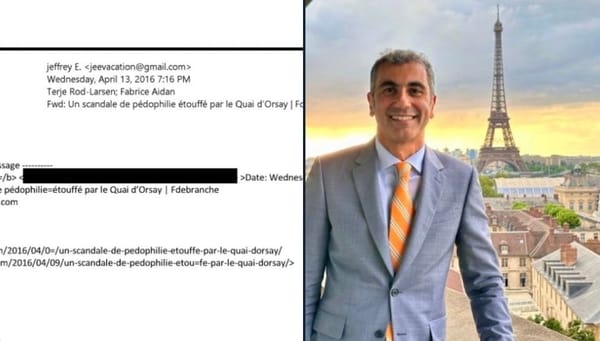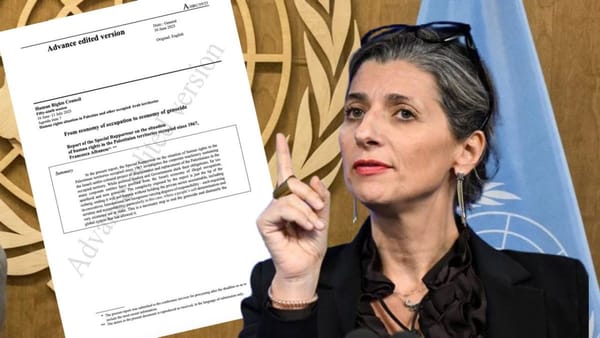Le chiffre est sec, la trajectoire implacable. Selon les projections officielles du Projet de Loi de Finances, la subvention d'équilibre versée par l'État pour combler le déficit du régime de retraite de la RATP (CRPRATP) atteindra 902 millions d'euros en 2026. La question n'est plus de savoir si le mur du milliard sera franchi, mais quand : la barre des 981 millions d'euros est déjà attendue pour 2027.

Cette dérive n'est pas un accident conjoncturel. C'est la conséquence d'un système structurellement insolvable, dont la charge est méthodiquement transférée au contribuable.
La subvention, déjà de 634 millions d'euros en 2022 et projetée à 757 millions en 2024, n'est pas un "déficit" comptable. C'est un transfert de charge direct. En 2022, le régime RATP a versé 1,44 milliard d'euros de prestations, tout en ne collectant que 807 millions d'euros de cotisations (salariales et patronales). Le chèque du contribuable, via l'État, a comblé l'écart. En clair : le contribuable finançait déjà 44% du total des pensions RATP versées cette année-là.

Anatomie d'un régime "hors norme"
Le débat public se focalise souvent sur l'âge de départ dérogatoire des agents statutaires de la RATP. C'est une erreur d'analyse. L'anomalie financière la plus structurelle n'est pas l'âge, c'est le montant des prestations.
En 2023, le montant moyen de la pension brute à la RATP s'élevait à 3 700 euros par mois.
Mettons ce chiffre en perspective. Au même moment, la pension moyenne de droit direct au régime général (CNAV) était de 1 531 euros bruts. La pension moyenne à la RATP est donc 2,4 fois supérieure à celle du régime général.
La subvention d'équilibre payée par le contribuable ne sert donc pas à garantir un minimum vital, mais à financer un niveau de vie moyen à la retraite que ce même contribuable ne peut espérer pour lui-même.

La faillite démographique comme moteur
La viabilité de tout régime par répartition repose sur son ratio démographique. Celui de la RATP est en état de faillite. En 2022, la caisse comptait 41 079 cotisants pour 49 822 pensionnés. Le ratio est de 0,82 cotisant par pensionné.
Ce seuil critique (moins d'un cotisant par retraité) a été franchi dès 2011. Il est désormais deux fois plus faible que celui du régime général (1,7) ou de la fonction publique territoriale (1,9).
Pire, ce déséquilibre s'accélère. En 2022, le nombre de pensionnés a crû de +1,4% tandis que le nombre de cotisants n'augmentait que de +0,1%. Le passif (les bénéficiaires) croît 14 fois plus vite que l'actif (les contributeurs). Cet "effet de ciseau" rend le déficit mathématiquement incontrôlable, avant même de considérer l'impact de l'inflation, qui, en s'appliquant sur des pensions de base élevées, fait exploser les dépenses.

La réforme, un accélérateur de passif
Face à cette dérive, la réforme des retraites de 2023 a appliqué la "clause du grand-père" : le régime spécial est "fermé" aux nouveaux entrants depuis le 1er septembre 2023.
Cette solution politique est un désastre financier à moyen terme. En théorie, on "éteint" le régime. En pratique, on accélère son insolvabilité.

Un régime par répartition a un besoin vital de nouveaux cotisants (jeunes, payant loin de la retraite) pour financer les pensionnés actuels. La réforme de 2023 détourne ces nouvelles recrues RATP vers le régime général. Le régime spécial (CRPRATP) est donc privé de ces cotisations vitales. Il se retrouve seul, avec ses cotisants vieillissants et ses pensionnés croissants.
La "mise en extinction" (run-off) aggrave l'effondrement du ratio démographique et fait exploser le besoin de financement.
L'explosion de la subvention vers le milliard d'euros n'est pas malgré la réforme ; elle est, en partie, à cause de celle-ci. L'État a acheté la paix sociale en garantissant les droits des agents statutaires, tout en sachant que le coût de cette garantie, formalisée par la loi, serait transféré intégralement et automatiquement au contribuable. Le milliard de 2026 n'est qu'une étape.