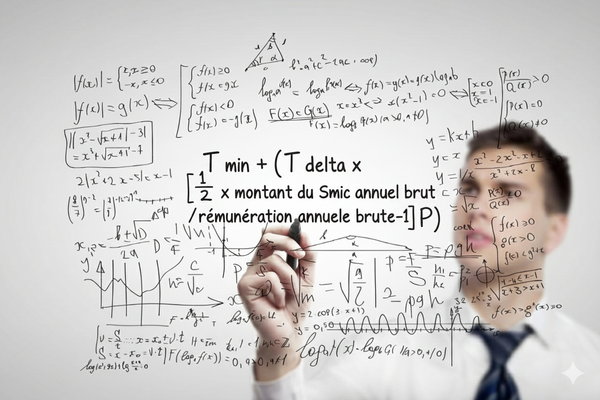Le 107e Congrès des maires, traditionnellement consacré aux urgences des trottoirs et aux doléances de la cohésion sociale, est devenu en novembre 2025 le théâtre d’une opération de communication politique d’une rare violence. Le général d’armée aérienne Fabien Mandon, Chef d’État-Major des Armées (CEMA), n’est pas venu à Paris pour rassurer, mais pour rompre. Son intervention, le mardi 18 novembre, fut un coup de semonce stratégique, une irruption du régalien externe dans le sanctuaire du régalien de proximité.

L’analyse de l’événement révèle une dissonance brutale : tandis que l’autorité militaire exigeait des élus qu’ils se fassent les relais d’une angoisse stratégique, les maires ne demandaient qu’un renfort de moyens pour gérer une insécurité quotidienne et un désengagement financier croissant de l’État. En clair, on leur a demandé de préparer le terrain pour la guerre de haute intensité, alors qu’ils luttent déjà pour financer la paix sociale dans leurs communes.
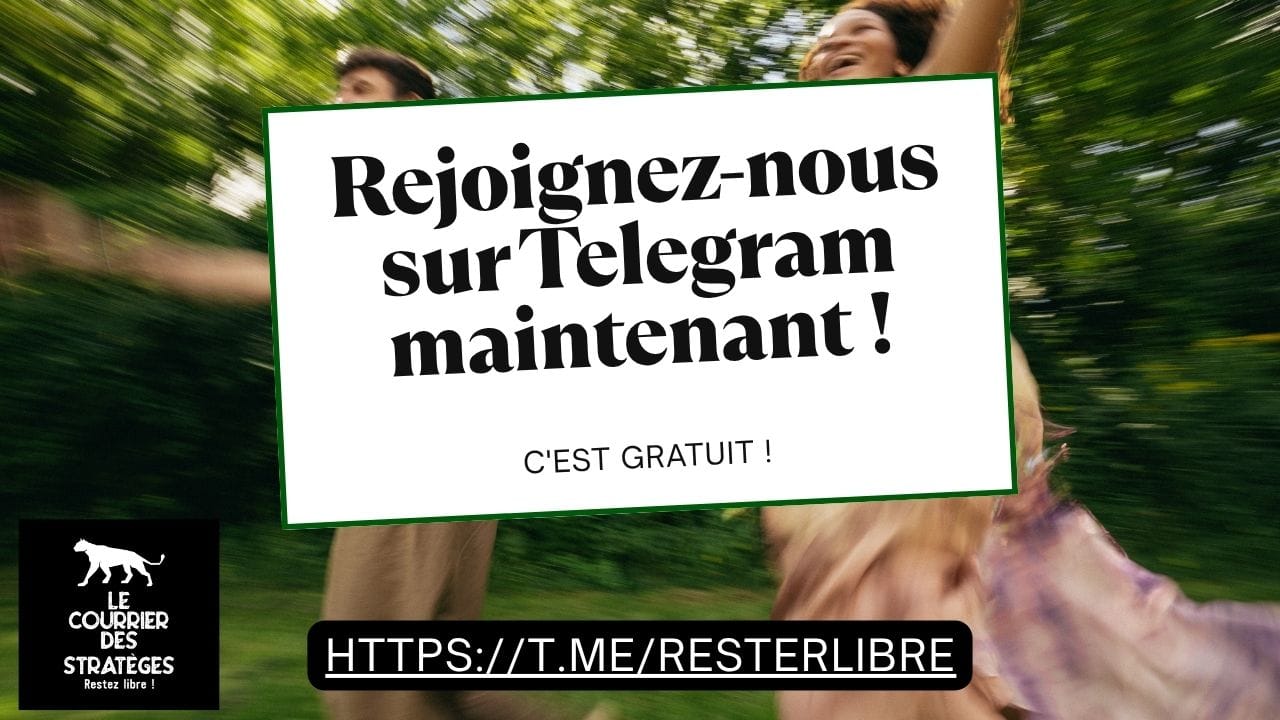
L'injonction au sacrifice : un discours d’État-Major sans filtre
Le général Fabien Mandon a choisi la tribune des maires pour délivrer un message qu’il a lui-même qualifié de « vital » : « le moment est particulièrement grave ». Le CEMA, loin de la prudence diplomatique, a dressé un panorama stratégique lugubre. Il a rappelé le basculement géopolitique (Chine puissance militaire de premier plan, désengagement américain de l’Europe) pour justifier l'accélération de la menace sur notre propre continent.
Le dogme est désormais clair : la Russie, selon les estimations de l’État-Major, ne s'arrêterait pas à l'Ukraine et préparerait une confrontation avec l’OTAN d'ici 2030, soit à un horizon de « 3 ou 4 ans ». Le risque n’est plus lointain, il est « crédible ».
La militarisation de la conscience publique
Mais là où le discours est devenu politique, au sens le plus viscéral du terme, c'est dans l'injonction faite à la Nation. Pour survivre à cette confrontation, la France doit « accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est ». Le CEMA a frappé fort en employant une figure rhétorique macabre, exigeant que la nation soit prête à « accepter de perdre ses enfants » et à « souffrir économiquement ».
Le message, qui visait officiellement les soldats volontaires, a eu l'effet d’une sidération, renvoyant chaque maire à la mémoire des monuments aux morts. L’objectif avoué était de transformer l’élu local en un « relais » de cette prise de conscience anxiogène dans sa commune. Le CEMA Mandon, sans le vouloir, a ainsi posé la question centrale : qui a la légitimité d’imposer le concept de sacrifice à une Nation en temps de paix?
La riposte des élus : la dignité avant l’anxiété
Les réactions ont été immédiates et acerbes, traversant tout l’échiquier politique. Sébastien Chenu (RN) a nié toute « légitimité pour affoler les Français » au général, tandis que Jean-Luc Mélenchon (LFI) exprimait son « désaccord total » avec cet appel à des « préparations guerrières ».
Michèle Picard, maire de Vénissieux, a condensé le malaise des élus de terrain, refusant d'être la courroie de transmission d’un « discours militaire et alarmiste ». Elle a souligné le paradoxe budgétaire criant : l'augmentation massive de 6,7 milliards d'euros pour la défense en 2026 contraste "scandaleusement" avec la progression de la pauvreté et les difficultés des communes à garantir la cohésion sociale. En d’autres termes, l’État investit massivement dans la défense d’un conflit hypothétique (2030) tout en se désengageant de la sécurité et de la dignité sociale immédiates.
Le prix de la sécurité : le marché de l'immobilier et de la justice locale
Face à l’onde de choc Mandon, l’autre haute autorité présente, le général d’armée Hubert Bonneau, Directeur général de la Gendarmerie Nationale (DGGN), a tenté de rétablir une relation plus pragmatique avec les élus. La Gendarmerie, « force armée de couverture des territoires », a renouvelé son ancrage local par la signature d'une nouvelle convention avec l’Association des maires de France (AMF) le 19 novembre 2025.
L’ancrage territorial monnayé : « Pas de gendarmes sans caserne »
L’une des priorités de cette nouvelle alliance est loin d’être glorieuse : elle est logistique. Un groupe de travail a été créé pour aborder la réflexion stratégique sur l'immobilier de la gendarmerie. Le DGGN l'a dit sans détour : « Il ne peut pas y avoir de gendarmes sans caserne! ».
Ce détail est essentiel. Pour maintenir une présence régalienne sur plus de 95 % du territoire, l’État compte désormais sur les collectivités locales pour fournir le gîte. Les maires sont transformés en facilitateurs fonciers, en logisticiens de l’État, un partenariat qui est en réalité une dépendance mutuelle. On demande aux élus de soutenir l’intégration des familles des militaires pour garantir que les forces régaliennes restent dans leurs murs. Le prix du maintien de la sécurité de proximité est désormais lourdement indexé sur le soutien logistique municipal.
Le transfert de charge masqué : la loi sur les polices municipales
L’autre grand sujet du Congrès, le projet de loi visant à étendre les prérogatives des polices municipales (PM) , est la parfaite illustration du transfert de charge larvé. Certes, les maires réclamaient plus d’efficacité opérationnelle pour leurs 28 000 agents. Le texte, déposé au Sénat en novembre 2025, prévoit d’accorder aux PM des pouvoirs de police judiciaire (PJ) étendus, notamment pour verbaliser par amende forfaitaire délictuelle neuf infractions (usage de stupéfiants, vente à la sauvette, occupation illicite de halls, outrage sexiste).
Cependant, l’AMF a posé sa ligne rouge :
- Refus du désengagement : le rôle du maire reste complémentaire à la mission régalienne de l'État, et les « polices municipales ne pallieront pas un retrait de l'État ».
- Volontariat conditionnel : les nouveaux pouvoirs sont optionnels, soumis à l'accord du maire et du conseil municipal, préservant ainsi la libre administration.
Le point de blocage, et là encore le nerf de la guerre, est financier. Le Conseil d'État a reconnu que la réforme « entraînera nécessairement des dépenses supplémentaires » pour les communes (recrutement, formation, encadrement judiciaire). Or, le texte ne prévoit aucune compensation financière. L'État, qui réclame la préparation au conflit de haute intensité et augmente son budget de défense, offre la possibilité d’une sécurité renforcée à condition que le maire paye les surcoûts.

Le front numérique : l'illisibilité des défenses
Enfin, le Congrès a révélé l’état de nos défenses sur le front numérique, un domaine où la militarisation de la menace par l’Intelligence Artificielle (IA) est déjà une réalité, notamment par l'usage de deepfakes et la génération de tentatives de phishing ultra-crédibles. L'enjeu est d'autant plus critique que les élections et l'intégrité institutionnelle sont directement visées par la désinformation.
Face à ce péril croissant, l'État a déployé une panoplie d'outils (MonAideCyber, Mooc SenCyCrise, 17cyber). La promesse est là, mais l'exécution fait défaut. Patrick Molinoz, vice-président de l'AMF, a tiré la sonnette d’alarme, dénonçant la « dispersion des moyens » et le « foisonnement des interlocuteurs ».
Comment voulez-vous qu’un maire de petite ou moyenne commune, déjà responsable de tout mais coupable de rien, navigue entre quinze interlocuteurs différents quand une attaque par rançongiciel (comme celle qui a coûté 50 000 euros à Gravelines) survient? L’État propose des outils sophistiqués, mais néglige l’opérationalité simple. Les élus réclament un point de contact unique : « Quand j'appelle le 17, débrouillez-vous pour que ça fonctionne ».
Cette fragmentation de l’aide technique, couplée à un financement instable, maintient les collectivités locales dans une position de vulnérabilité chronique. Elles sont les cibles des grandes menaces stratégiques (cyber, désinformation), mais restent les victimes de la complexité administrative de l’État.

Épilogue : l'hypothèque sur l'avenir
Le Congrès des maires de 2025 restera l’année où le Chef d’État-Major des Armées a fait irruption dans le débat public avec un discours de défense totale. L’enjeu n’était pas de discuter de la défense, mais de conditionner psychologiquement la Nation à la prééminence de l’effort militaire au détriment de l’effort social et financier local.
C’est une nouvelle étape franchie dans la militarisation du débat public : non pas par l’uniforme dans la rue, mais par l’injonction au sacrifice et par la dramatisation politique de la menace. En demandant aux maires de se faire les porteurs de cette anxiété stratégique, le Général Mandon a réussi à placer l'hypothèque d’une guerre lointaine au cœur de la gestion quotidienne de nos territoires. Reste à savoir si les maires, déjà à bout de souffle financièrement, accepteront d’endosser ce costume de chef de guerre, ou s’ils rappelleront à l’État sa première mission : assurer les moyens de la paix et de la dignité, ici et maintenant.