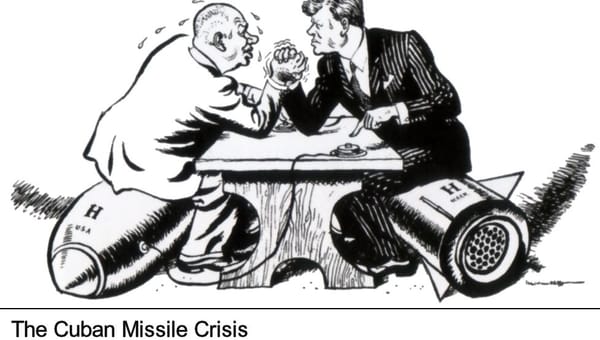Il nous a semblé important de remettre au point quelques informations sur la véritable nature du régime de Vladimir Poutine, par-delà le mythe de l'ogre fou propagé par la presse subventionnée, mais aussi par-là le mythe du chevalier blanc propagé dans les milieux poutinolâtres.
Cette analyse se concentre principalement sur les relations entre la Russie d'aujourd'hui et l'héritage soviétique, mais aussi sur la nature économique du régime russe actuel (que nous qualifierons de capitalisme d'Etat), et sur le poids de l'oligarchie russe, puisque, n'en déplaise aux populistes de tous poils qui dénoncent la concentration des richesses en Occident, la Russie est le pays industrialisé champion MONDIAL de la concentration des richesses autour du 1% le plus riche de la population ! (point qui interroge sur les véritables intentions des grands bourgeois parisiens, notamment, qui font l'éloge de ce régime).
La Russie de Poutine, une synthèse post-soviétique
Le régime de Vladimir Poutine, qui domine la scène politique russe depuis le début du XXIe siècle, défie les classifications simplistes. Il ne constitue ni une simple restauration de l'Union Soviétique, ni une démocratie de marché à l'occidentale. Il s'agit d'un système autoritaire hybride, unique et cohérent, qui a réinventé et instrumentalisé des éléments de l'héritage soviétique pour consolider un modèle de capitalisme d'État. Dans ce système, l'élite économique, connue sous le nom d'oligarques, a été transformée de maîtres du jeu politique sous Boris Eltsine en vassaux du Kremlin, dont la fortune et la survie sont conditionnées par leur allégeance politique. Je me propose d'analyser en profondeur les trois piliers fondamentaux de ce système : son rapport complexe et sélectif avec le passé soviétique, la nature véritable de son modèle économique, et le pacte de pouvoir qui lie le Kremlin à son oligarchie.
Ces trois dimensions ne sont pas des phénomènes isolés, mais des composantes interdépendantes d'une même logique de pouvoir. La première partie examinera comment Vladimir Poutine a délibérément puisé dans l'arsenal politique et symbolique de l'URSS non pas pour la ressusciter, mais pour en extraire les outils de contrôle les plus efficaces – la centralisation du pouvoir, la primauté des services de sécurité et une idéologie impériale – afin de les adapter à un projet nationaliste post-communiste. La deuxième partie se penchera sur la structure de l'économie russe, arguant qu'elle ne correspond pas aux critères d'une économie de marché libre, mais plutôt à un capitalisme d'État où les secteurs stratégiques sont sous la tutelle du Kremlin et où, depuis 2022, la logique de guerre a supplanté toute autre considération. Enfin, la troisième partie retracera l'évolution du rôle des oligarques, d'une élite qui "capturait" l'État faible des années 1990 à une classe de "vassaux" dont la richesse est devenue un instrument au service du pouvoir poutinien.
En reliant ces trois axes, je proposerai une vision intégrée du "système Poutine" : un modèle politique et économique construit pour durer, qui a su démontrer une résilience certaine face aux chocs externes, mais qui porte en lui les germes de vulnérabilités structurelles profondes, exacerbées par la militarisation de l'État et de l'économie.
L'héritage soviétique réinventé
L'analyse du régime de Vladimir Poutine révèle une relation complexe et pragmatique avec le passé soviétique. Loin de chercher à "ressusciter l'URSS" dans son intégralité idéologique et économique, le pouvoir poutinien s'est engagé dans un processus de sélection et de réinvention. Il a délibérément extrait de l'héritage soviétique les instruments de contrôle étatique les plus efficaces – la centralisation du pouvoir, le rôle prépondérant des services de sécurité et un symbolisme national puissant – pour les adapter à un projet impérial et conservateur post-communiste. Cette approche n'est pas motivée par une nostalgie idéologique, mais par une stratégie calculée visant à construire un système autoritaire durable, adapté aux réalités du XXIe siècle.
La "verticale du pouvoir" : la refondation d'un État centralisé
Dès son arrivée à la tête de la Russie, Vladimir Poutine a fait de la restauration de l'autorité de l'État sa priorité absolue, une mission qu'il a résumée par la volonté de "remettre de l'ordre". Cette démarche s'est inscrite en réaction directe au "chaos" perçu des années 1990 sous la présidence de Boris Eltsine, une période marquée par un affaiblissement du pouvoir central, une autonomie régionale croissante et l'influence démesurée des acteurs économiques sur la politique. La construction de ce que l'on a appelé la "verticale du pouvoir" a constitué le socle de son projet politique, s'appuyant sur une longue tradition russe et soviétique de centralisation étatique.

L'une des premières réformes majeures de Poutine a été de démanteler méthodiquement le fédéralisme asymétrique hérité de l'ère Eltsine. Durant les années 1990, les dirigeants régionaux avaient acquis une influence considérable, ignorant souvent la loi fédérale et se comportant comme des "mini-dictateurs" dans leurs propres régions. Pour réimposer le contrôle de Moscou, Poutine a instauré en 2000 sept districts fédéraux, chacun supervisé par un représentant présidentiel doté de larges pouvoirs de surveillance sur les gouverneurs régionaux. Cette mesure a été complétée par des lois permettant au président de révoquer les gouverneurs et de dissoudre les assemblées régionales, vidant ainsi de sa substance l'autonomie politique des sujets de la fédération.
Parallèlement à cette reprise en main territoriale, le système politique national s'est progressivement crispé. Le parlement, en particulier la Douma d'État, a été transformé en une simple chambre d'enregistrement, dont le rôle se limite à valider les décisions déjà prises au Kremlin. Le contrôle du processus électoral a permis au parti présidentiel, Russie Unie, d'obtenir des majorités écrasantes, marginalisant toute opposition parlementaire réelle. De même, le pouvoir judiciaire a vu son indépendance s'éroder. Les tribunaux restent soumis à une forte pression politique, et lorsque le Kremlin a besoin d'une décision en sa faveur, il est quasiment certain que le système judiciaire la lui fournira, comme l'a illustré de manière flagrante le procès de la compagnie pétrolière Ioukos. Le grand nombre de recours déposés par des citoyens russes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme témoigne du manque de confiance de la population dans son propre système de justice. Cette centralisation extrême du pouvoir, où toutes les décisions importantes remontent au sommet de l'exécutif, est une caractéristique fondamentale du système poutinien, en rupture avec le pluralisme désordonné des années Eltsine mais en continuité avec la tradition autocratique russe et la structure de pouvoir soviétique.
Les Siloviki : la primauté des services de sécurité
La clé de voûte du système Poutine, et l'une des continuités les plus manifestes avec l'ère soviétique, est la primauté accordée aux services de sécurité, les siloviki ("ceux de la force"). L'ascension de Vladimir Poutine, lui-même un ancien lieutenant-colonel du KGB, a marqué le retour au pouvoir de l'appareil sécuritaire qui avait été marginalisé, mais non démantelé, après la chute de l'URSS. Dès son arrivée au Kremlin, Poutine a œuvré à "redonner toute sa puissance à cette organisation qui était redoutable", comme le souligne l'historien Stéphane Courtois.
Le Service fédéral de sécurité (FSB), principal successeur du KGB, est devenu l'acteur le plus influent et le plus décisif de la politique russe contemporaine. Son influence s'étend bien au-delà de ses missions traditionnelles de contre-espionnage et de sécurité intérieure. Les hommes issus du FSB et d'autres agences de force ont été placés à des postes clés dans l'administration présidentielle, les ministères, les gouvernements régionaux et à la tête des grandes entreprises d'État. Cette infiltration systématique de l'élite dirigeante par les siloviki a profondément modelé la culture politique du pays, instaurant une mentalité de siège, une méfiance à l'égard de l'Occident et une propension au secret et aux méthodes coercitives.

Cette primauté se manifeste également par la réactivation de méthodes héritées de l'ère soviétique. L'usage du kompromat – la collecte et la divulgation sélective de documents compromettants pour discréditer ou neutraliser des adversaires politiques ou des rivaux économiques – est une technique favorite du pouvoir. L'affaire du procureur général Iouri Skouratov en 1999, dont la carrière a été brisée par la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel alors qu'il enquêtait sur la corruption au Kremlin, est un exemple emblématique de cette pratique, orchestrée par Poutine alors qu'il dirigeait le FSB. Le système judiciaire lui-même est instrumentalisé, avec des lois appliquées de manière sélective pour punir ceux qui défient le régime. Les entreprises ou les organisations qui déplaisent au pouvoir se retrouvent rapidement sous le coup d'enquêtes fiscales ou d'inspections sanitaires qui paralysent leurs activités. Le régime est ainsi dominé non seulement par un personnel, mais aussi par une culture et des méthodes directement issues des services de sécurité soviétiques, constituant une continuité structurelle et opérationnelle majeure avec le passé.
L'idéologie impériale : entre nostalgie soviétique et nationalisme Grand-Russe
Le projet politique de Vladimir Poutine ne repose pas sur une restauration de l'idéologie marxiste-léniniste, qu'il a lui-même critiquée, mais sur la construction d'une nouvelle idéologie syncrétique, à la fois nationaliste, conservatrice et impériale. Pour ce faire, il a consciemment cherché à "glaner dans toutes les périodes de la Russie ce qui lui paraît de nature à consolider la société russe", réconciliant les héritages tsariste et communiste afin de reconstituer une "fierté russe". Cette démarche est fondamentalement instrumentale : les symboles et les mythes soviétiques ne sont pas réhabilités pour leur valeur intrinsèque, mais pour leur capacité à mobiliser la population autour d'un projet de "Grande Russie".
Un pilier central de cette idéologie est l'instrumentalisation du mythe de la "Grande Guerre Patriotique". Sous Poutine, la victoire de 1945 a été érigée en véritable culte civique, supplantant la Révolution d'Octobre comme mythe fondateur de la nation. Cet événement est utilisé pour légitimer le pouvoir actuel, présenter la Russie comme une forteresse assiégée luttant contre un "fascisme" renaissant (un discours appliqué à l'Ukraine) et souder la nation autour de l'armée et de son chef. La commémoration de la bataille de Stalingrad, par exemple, est l'occasion de célébrer "l'amour de la patrie" et la "volonté de défendre ses intérêts" comme un "grand héritage".

D'autres symboles soviétiques ont été réactivés de manière sélective. La réintroduction en 2000 de la mélodie de l'hymne national de l'URSS, avec de nouvelles paroles, n'était pas un hommage au communisme, mais un appel à la restauration d'un État fort et d'un empire perdu. Cette nostalgie sélective est encapsulée dans la célèbre formule de Poutine : "Celui qui ne regrette pas l’Union soviétique n’a pas de cœur, celui qui souhaite son retour n’a pas de tête". Elle exprime un regret pour la puissance géopolitique perdue, et non pour le système socio-économique.