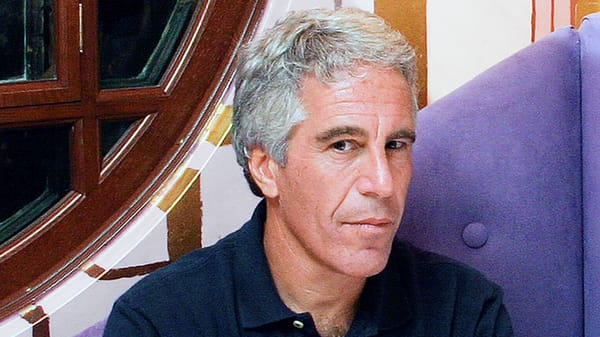Trois ans après le Qatargate, le Parlement européen refuse les demandes de levée d’immunité formulées par la justice belge. Derrière ce bras de fer institutionnel, une question dérangeante : l’Union européenne veut-elle vraiment être transparente — ou simplement préserver sa propre élite ?

Selon une enquête d’Euractif, la relation entre le Parlement européen et la justice belge est de nouveau tendue. Le conflit entre les deux parties ne date pas d’hier. Depuis le scandale du Qatergate, le Parlement européen estime que les autorités belges s’impliquent trop dans le contrôle des institutions de l’UE. Une enquête sur une nouvelle affaire de corruption, la Huaweigate, a ravivé la confrontation.
Une nouvelle confrontation entre le Parlement européen et la justice belge
Il y a trois ans, des valises remplies d’argent ont été découvertes au domicile de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili. Les médias ont appelé ce scandale de corruption « Qatargate ». La présidente de l’institution, Roberta Metsola, a alors promis une coopération totale avec les enquêteurs belges dans la résolution de cette affaire.
Mais trois ans après l’éclatement de cette affaire de corruption, les autorités belges continuent à enquêter sur les pots-de-vin que le Qatar et le Maroc ont versés aux législateurs européens. Cela a généré une sorte de conflit entre les membres de la commission des Affaires juridiques (JURI) du Parlement et les procureurs belges. Une nouvelle enquête concernant l’affaire Huaweigate n’a fait que raviver la confrontation.
Selon les informations divulguées en mars, le géant de la télécommunication chinois Huawei a offert des cadeaux à des eurodéputés afin d’influencer leurs décisions en sa faveure. Roberta Metsola et plusieurs parlementaires européens ont immédiatement manifesté leur indignation suite à l’éclatement de cette affaire. Le conflit a éclaté lorsque les procureurs belges ont demandé la levée d’immunité d’une eurodéputée soupçonnée d’avoir participé à la réunion avec Huawei. Pourtant, les enquêtes ont révélé que c’était une fausse accusation, vite exploitée par le Parlement pour remettre en cause la crédibilité des enquêteurs.
Metsola a qualifié de « négligence » cette démarche des autorités belges et elle a déclaré qu’elle va protéger le Parlement contre toute accusation injustifiée pouvant nuire à sa réputation.
Résultat : le Parlement refuse de donner suite aux demandes des autorités belges visant à lever l’immunité de quatre autres eurodéputés soupçonnés d’avoir participé à cette affaire de corruption.. La transparence promise en 2022 semble déjà enterrée.
La commission JURI : le labyrinthe du blocage
Le cœur de cette obstruction réside dans la Commission des Affaires juridiques (JURI). Chargée d'examiner les demandes de levée d'immunité, cette commission est un frein volontaire.
Ses membres exigent des procureurs belges des preuves « solides » avant même d'accorder la levée. La procureure Ann Fransen a clairement rappelé la règle : les députés doivent seulement vérifier si la demande est politique, pas exiger l'accès aux preuves d'une enquête en cours.
Exiger l'accès aux preuves compromet le secret de l’enquête et alerte les suspects. Le Parlement demande l'impossible pour justifier l'immobilisme.
Ce délai de plusieurs mois, qualifié de « sans précédent » dans le cas Huawei, n'est pas une simple lenteur. C'est de la résistance institutionnelle. Les décisions sur l'immunité sont devenues des « monnaies d'échange » entre groupes politiques. La protection de l’institution passe avant la justice.
Ce bras de fer illustre une tension plus profonde : le Parlement européen, censé être le cœur démocratique de l’UE, se comporte ici comme une forteresse administrative, jalouse de ses privilèges et peu encline à la transparence.
Bureaucratie, lenteur et hypocrisie institutionnelle
La commission juridique du Parlement met généralement quelques mois pour traiter ces affaires.Cette fois, cela traîne depuis plus d’un an. Les discussions s’éternisent, les demandes se multiplient, et les procédures s’enlisent dans des querelles de formulaires.
Certains députés reconnaissent en privé que les décisions d’immunité sont devenues des instruments politiques, négociés entre groupes parlementaires.
Autrement dit : la justice est suspendue au bon vouloir des partis.
Dans un contexte où les scandales d’influence étrangère se multiplient, cette attitude nourrit le soupçon que Bruxelles préfère étouffer les affaires plutôt que les élucider.
Tant que le Parlement contrôlera la levée de l'immunité de ses propres membres, il sera à la fois juge et partie. Il est urgent de retirer ce pouvoir au Parlement pour garantir l'indépendance des enquêtes.