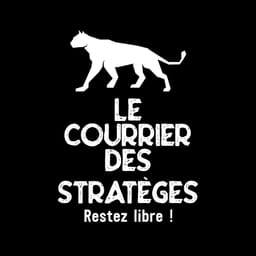Les larmes qui coulent à Marseille ont le goût amer de l'impuissance. Cette semaine encore, une mère, la maman Kessaci, enterrait son fils, une victime collatérale de plus dans cette guerre urbaine que l'État ne semble plus vouloir, ou pouvoir, gagner. Dans les quartiers Nord, le ballet des obsèques rythme désormais le quotidien, sous le regard distant d'une République qui préfère compter ses points de PIB plutôt que ses morts.

Ce drame humain n'est que la partie visible d'un système monstrueux. Un système qui prospère sur l'avachissement collectif et qui s'abreuve aux flux tendus de la mondialisation. Le narcotrafic en France n'est pas une économie souterraine, c'est une industrie mondialisée dont les portes d'entrée sont connues de tous : Le Havre et Marseille.
C'est ici que le réel nous rattrape et que la géographie politique devient troublante. Car enfin, qui trouve-t-on aux manettes de ces infrastructures stratégiques, ces passoires béantes par lesquelles le poison se déverse sur notre territoire ?

Au Havre, premier port à conteneurs de France, règne Édouard Philippe. L'incarnation même de cette bourgeoisie d'État, froide et gestionnaire, l'ancien Premier Ministre d'Emmanuel Macron, celui qui prépare patiemment son ascension future tout en gérant une ville devenue une plaque tournante de la cocaïne. Sous son mandat, local et national, le trafic y a explosé, la corruption des dockers est devenue endémique. Une fatalité, nous dit-on.
À Marseille, le scénario est encore plus cynique. La ville elle-même a échappé à l'emprise macroniste directe, mais l'État, jamais à court d'idées pour garder le contrôle de l'essentiel, a placé ses pions au cœur du réacteur : le Grand Port Maritime. Et qui a-t-on parachuté à la présidence de son conseil de surveillance ? Christophe Castaner. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'ex-"premier flic de France", dont le bilan Place Beauvau fut pour le moins contrasté, se retrouve soudainement aux commandes de l'infrastructure la plus vulnérable au crime organisé du pays.
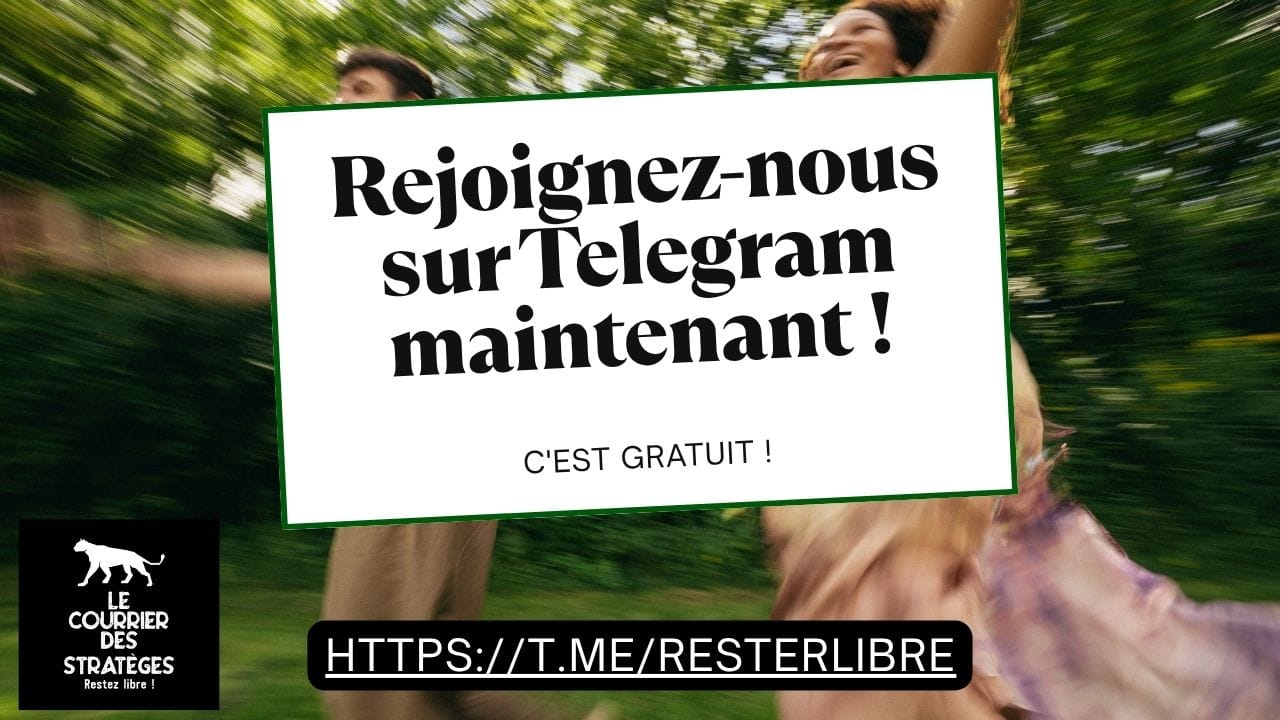
Un hasard, sans doute.
L'explication officielle est rodée : il faudrait des personnalités d'envergure pour tenir ces bastions face à la criminalité. Mais soyons sérieux. Placer ceux qui ont pu échouer à contenir le trafic lorsqu'ils étaient aux affaires régaliennes à la tête des infrastructures qui l'alimentent, cela relève soit de l'incompétence crasse, soit d'un cynisme achevé.
Car cette concentration de figures de premier plan de la Macronie dans les épicentres du narcotrafic interroge. Elle interroge d'autant plus quand on observe, en parallèle, la déliquescence des services censés lutter contre ce fléau. L'OFAST, cet office anti-stupéfiants, semble lui-même miné de l'intérieur, théâtre de luttes intestines et de soupçons de corruption manifestes à Marseille. La boucle est bouclée.

Il ne s'agit pas ici de crier au complot ou d'accuser ces personnalités de tremper directement dans le trafic. La réalité est souvent plus grise, plus systémique. Il s'agit de comprendre que l'oligarchie au pouvoir a parfaitement intégré le narcotrafic comme une donnée structurelle de la mondialisation.
Le Havre et Marseille sont des hubs essentiels pour le commerce légal, pour cette religion du libre-échange que vénère la Macronie. Tant que les conteneurs circulent, tant que les affaires tournent, le reste n'est qu'une variable d'ajustement. Le narcotrafic est, d'une certaine manière, le prix à payer pour rester compétitif dans le grand casino mondial.
Ces poids lourds politiques ne sont pas là pour éradiquer le trafic. Ils sont là pour le gérer. Pour maintenir un semblant d'ordre, pour s'assurer que la violence ne déborde pas trop des quartiers populaires, et surtout, pour garantir que la machine économique continue de fonctionner sans entrave majeure.

Le résultat de cet arrangement tacite, c'est une France à deux vitesses. D'un côté, une élite mondialisée qui contrôle les leviers de commande et sécurise ses propres intérêts. De l'autre, un peuple abandonné à la violence des gangs, qui paie de son sang le cynisme de ceux qui le gouvernent. Les larmes de la mère marseillaise ne pèsent pas lourd face aux milliards du commerce international que ces grands ports brassent. Et cela, visiblement, convient très bien à la Macronie.