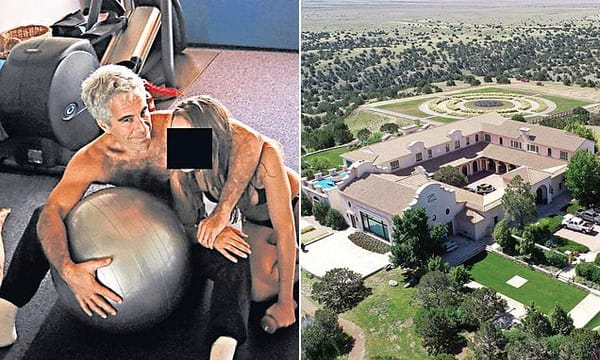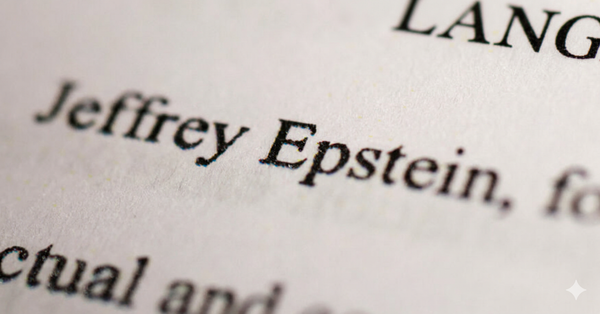Le milliardaire Daniel Kretinsky a placé Marianne sous le contrôle de deux figures majeures du sionisme intransigeant : Frédéric Taddéï et Eve Szeftel. La reprise en main de ce remuant hebdomadaire donne lieu à une motion de défiance contre Eve Szeftel.
Il est des drames feutrés, des agonies silencieuses qui ne font pas la une des journaux qu’elles assassinent pourtant. Ce qui se noue aujourd’hui dans cette rédaction de Marianne, que l’on connut plus vive, plus ardente, n’est pas une simple querelle de journalistes ; c’est le spectacle d’un empoisonnement lent, le drame d’une conscience que l’on étouffe sous l’argent et les commandements du siècle. Nous observons cela, nous autres, depuis nos fenêtres de province ou nos appartements parisiens, avec cette lucidité terrible des témoins impuissants, reconnaissant l’odeur familière du mensonge et de la servitude.
Ce journal fut longtemps, pour beaucoup, une sorte de refuge. On y trouvait, croyait-on, une certaine droiture d’esprit, une liberté qui n’appartenait à aucune chapelle, sinon à celle d’une République exigeante, presque janséniste dans son refus des accommodements. C’était une maison où l’on pouvait encore respirer, loin du marécage des conformismes et des dévotions intéressées. Mais les maisons, comme les âmes, sont à vendre. Et un homme est venu, un de ces nouveaux princes de l’industrie et de la finance dont la puissance s’étend sur l’Europe, et il a acheté les murs, et avec les murs, il a cru pouvoir acheter les consciences qui les habitaient.

Car tel est le péché originel de ce monde des puissants : la croyance que tout s’acquiert, que tout a un prix, et que l’esprit n’est qu’une marchandise plus subtile qu’une autre. Et pour s’assurer de sa nouvelle propriété, pour la plier à ses vues, il y place une intendante, une directrice dont la mission n’est pas de faire un grand journal, mais un journal docile. La révolte gronde alors, non par orgueil, mais par un sursaut de cette dignité qui est le dernier bien des hommes qui n’ont que leur plume. Une motion de défiance, voilà le mot technique, presque froid, pour désigner ce spasme d’une âme qui refuse de se laisser mourir.
Mais quel est donc ce poison ? Quel est ce dogme qu’il faut instiller, cette vérité qu’il faut taire ? Il s’agit, nous dit-on avec les précautions d’usage dans ce milieu où la peur glace les mots, d’un conflit lointain, de cette terre où le sang n’a jamais le temps de sécher. Il s’agit d’Israël. Il est désormais exigé, dans cette presse qui appartient à des milliardaires, que la défense de cet État devienne un impératif catégorique, une sorte d’article de foi qui ne souffre ni la nuance, ni le doute, ni même le simple exposé des faits dans leur terrible complexité.
Ce n’est plus une opinion politique qu’on demande, c’est un acte d’allégeance. Il faut aimer, il faut absoudre, il faut consentir. Il faut surtout étouffer la voix de l’autre, de celui qui souffre de l’autre côté du mur, ou ne la laisser filtrer qu’accompagnée de tant de suspicion qu’elle en devient inaudible. Le journaliste n’est plus celui qui voit et qui raconte, mais celui qui trie le réel pour qu’il se conforme à la consigne. Il doit mutiler la vérité, lui arracher tout ce qui pourrait déranger la quiétude de ses maîtres. Il est prié de commettre ce péché contre l’esprit : le refus de la compassion et de la justice.

Voilà donc le tourment de ces journalistes : choisir entre le pain et la vérité. Car ce système est pervers : l’argent qui possède ces titres est le même qui assure les carrières, qui ouvre les portes, qui fait et défait les réputations dans le petit monde clos de Paris. Refuser la consigne, c’est s’exposer à la mort sociale. L’accepter, c’est consentir à sa propre mort intérieure, à cette petite pourriture de l’âme qui s’installe quand on sait où est le bien et que l’on choisit de faire le mal.
Cette affaire Marianne n’est qu’un symptôme, le frisson d’un corps déjà bien malade. Le mal est plus profond, il ronge une grande partie de cette presse que des fortunes colossales tiennent en laisse. Derrière les postures et les éditoriaux enflammés se cache ce nœud de vipères : la servitude volontaire à des intérêts qui ne sont ni ceux de la France, ni ceux de la vérité. Et le plus grand silence n’est pas celui qu’on impose sur un sujet ou un autre ; c’est le silence qui pèse sur cette servitude même. Le drame d’un journalisme qui a vendu son droit d’aînesse pour un plat de lentilles, et qui n’a même plus la force de nommer sa propre déchéance.