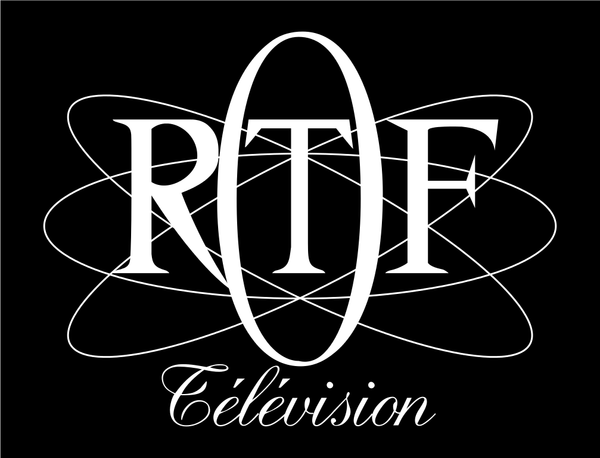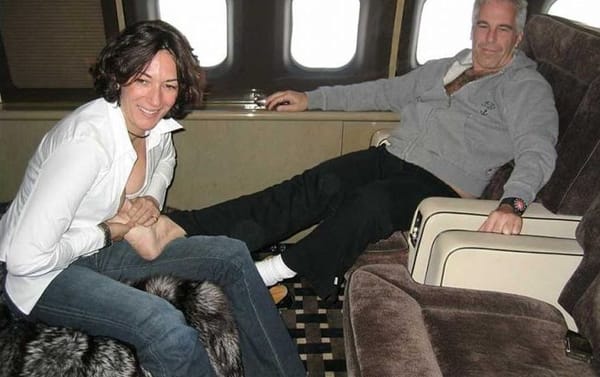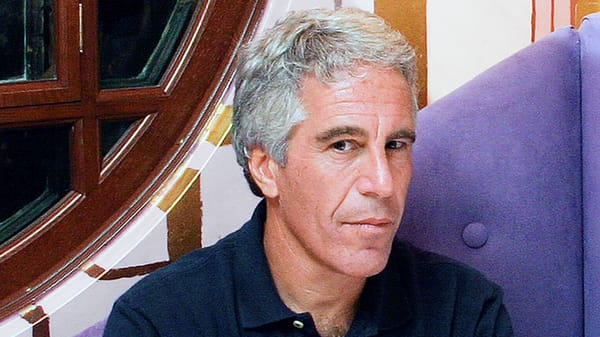Emmanuel Macron a personnellement présidé une réunion avec l’énigmatique Alliance de la Presse d’Information Générale, pour annoncer le déblocage de près de 500 millions € en faveur de titres déjà largement subventionnés. Ce faisant, il se concilie les bonnes grâces des journaux avant sa campagne électorale… et il accorde une aide d’État aux acteurs économiques qui lui vont bien. Pour un grand défenseur de l’Europe, voilà un détournement du droit communautaire qui vaut son pesant de cacahuètes.
Les élections présidentielles se dérouleront dans moins de deux ans. Et Emmanuel Macron vient de présider une réunion avec l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) au cours de laquelle il a décidé de débloquer près de 400 millions € sur deux ans. Y aurait-il, chez le Président de la République, la volonté d’amadouer la presse avant les élections présidentielles pour faciliter sa réélection ? On n’ose l’imaginer.
Toute la question est de savoir si cette décision présidentielle est légale ou non.
Les aides à la presse : une exception française
L’affaire n’étant pas claire dans tous les esprits, il faut d’abord rappeler que, dans les grandes démocraties libérales, les aides à la presse n’existent pas ou presque. Il a fallu attendre la fin 2019 pour que l’Allemagne en accorde (à hauteur de 40 millions €), et ces aides n’existent tout simplement pas en Grande-Bretagne.
Avec un petit milliard d’aides, la France s’offre donc un luxe qui fait tache dans le paysage démocratique. Ajoutons qu’un pays comme la Russie, que Macron adore accuser d’illibéralisme, ne subventionne pas plus la presse que la Grande-Bretagne. Il faudrait en revanche comprendre pourquoi de grands groupes comptent sur l’État pour renflouer les titres qu’ils possèdent, et qu’ils entretiennent comme des danseuses.
483 millions € sur deux ans
Les aides à la presse décidées par Macron fin août s’ajoutent aux 106 millions € déjà attribués en loi de finances rectificative en juillet. En outre, chaque année « ordinaire », l’État accorde 840 millions € de subvention à la presse. Le président Macron peut donc se targuer d’avoir augmenter ses aides de 25% en année pleine (le plan d’aide supplémentaire court jusqu’en 2022…)
Des aides totalement fumeuses
Officiellement, le nouveau plan d’aide doit apporter 50 millions supplémentaires à un fonds d’innovation. On ne pouvait pas faire plus opaque. Les initiés qui savent à peu près comment le ministère de la culture sélectionne les dossiers ont compris qu’il s’agit, bien entendu, de faire financer l’évolution des sites Internet des grands journaux par le contribuable. Bref, de la subvention pure et simple.
Les aides à la presse, un défi au droit communautaire
Sur le principe, les aides à la presse restent toujours très « limite » vis-à-vis du droit de l’Union Européenne, qui interdit de favoriser certains acteurs du marché plutôt que d’autres. Sur ce point, la position de la France a toujours été très tangente par rapport aux principes du marché unique dont Emmanuel Macron et ses sbires se font les défenseurs romantiques.
En 2018, le Sénat avait d’ailleurs débattu de cette question, en rappelant que le taux réduit de TVA accordé aux sociétés de presse en France n’était pas complètement blanc bleu avec les engagements européens de la France. La Commission avait en effet menacé la France de sanctions si elle appliquait la TVA réduite à la presse en ligne, quand la presse papier en bénéficiait. Compte tenu du sujet « Mediapart », le problème était très sensible. Le Sénat écrit donc : « Les ministres de finances de l’Union européenne se sont finalement mis d’accord le 2 octobre 2018 sur un ensemble de mesures concernant le système de TVA dans l’Union, dont l’alignement des taux de TVA qu’ils appliquent aux publications électroniques sur le régime plus favorable dont bénéficient les publications imprimées traditionnelles. Votre rapporteur spécial se félicite de cette évolution et de la fin de l’incertitude concernant la conformité au droit communautaire de cette dépense fiscale d’importance pour le secteur de la presse en ligne. »
On voit ici qu’adopter des mesures pour la presse en général peut poser problème. Mais inversement, aider un type d’acteurs et pas d’autres est contraire au droit de l’Union. Ces ambiguïtés, ces incertitudes, obligent les États membres de l’Union à la prudence.

Macron viole le principe libéral de l’Union
N’en déplaise aux pourfendeurs de l’odieux libéralisme qui nous intoxique, le principe général de l’Union est de prohiber les aides à la presse, et on s’en félicite. Tout le monde connaît l’article 107 § 1 du Traité de Fonctionnement de l’UE qui pose une règle limpide : » Sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent
les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen
de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent
de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » Aider la presse papier sans aider la presse en ligne suppose donc une prise de risque qui se discute mûrement.
Ce qui autorise une exception pour la presse, c’est le souci de préserver le pluralisme des opinions, objectif réputé d’intérêt général, qui rend la Cour de Justice de Luxembourg plutôt tolérante vis-à-vis des aides à la presse.
Mais précisément ! Aider 300 titres, selon des règles opaques, et pas les autres, soulève de nombreuses questions. Là encore, les initiés savent que l’insertion du « Fonds d’innovation » dans le plan d’aide permet de subventionner quelques titres en ligne, grâce auxquels le gouvernement peut prétexter de sa sincérité dans la recherche du pluralisme de la presse. Sauf que… la corde est ténue et finira bien par craquer. Car il ne sera pas éternellement possible d’affirmer contre vents et marées que la préservation des « insiders » avec l’argent du contribuable ne sert pas aussi des visées politiques à l’approche d’une campagne électorale cruciale. Et là, le pluralisme devient synonyme de restriction de la liberté d’expression.
Macron achète-t-il les vois des radicaux de gauche ?
L’APIG, qui a négocié ce nouveau plan avec Emmanuel Macron, est présidée par Jean-Michel Baylet, patron du puissant groupe La Dépêche du Midi. Baylet est en outre l’éminence des radicaux de gauche et un adepte bien connu de la franc-maçonnerie. Bref, une personnalité à choyer précieusement à l’approche des élections présidentielles, où toutes les voix compteront.
L’APIG, l’ennemie d’Internet
L’APIG revendique l’adhésion de 300 titres de presse, qui vont du Figaro jusqu’à la Gazette du Comminges. Tous ces titres ont la particularité d’être édités sur format papier. Aucun organe de presse en ligne n’en est membre. Pour un président qui se revendique de la start-up nation, voilà tout un symbole.
Exposition maximale au risque de contentieux
On le voit, la décision pour ainsi dire dictatoriale, prise par Emmanuel Macron, d’augmenter fortement les aides à la presse papier, n’est pas sans risque juridique. Nous parions même qu’une action de groupe de la presse en ligne contre l’avantage fiscal accordé aux concurrents papier se solderait par une victoire devant la Cour de Luxembourg.
Dans tous les cas, il est évident ici que le prétexte de préserver le pluralisme de la presse cache (mal) le souci d’assurer une réélection en aidant pendant deux ans tous les organes susceptibles de dire du bien du Président. Et, compte tenu du flou des critères d’attribution des aides, on peut imaginer que les médias les plus critiques seront immédiatement exclus du jeu.
La France peut pérorer tant qu’elle veut sur les démocraties illibérales, elle en est devenue une, sans aucun complexe.