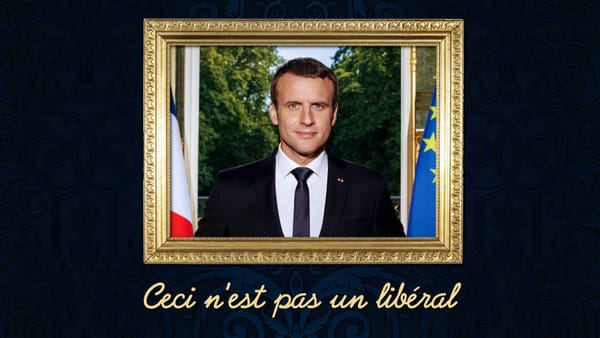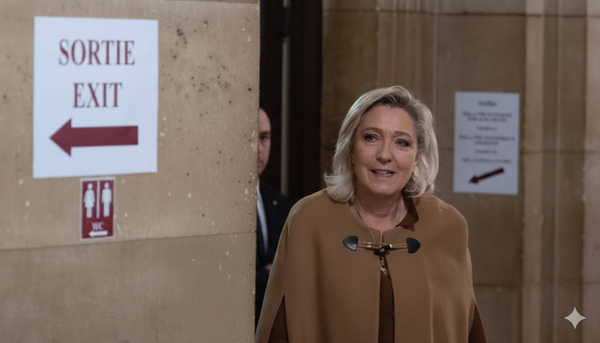Le procès du néo-libéralisme est-il inévitable au sein des droites françaises ? C'est enfoncer une porte ouverte que d'affirmer qu'Emmanuel Macron a cannibalisé la droite. Nous pensons plutôt que la survenue du jeune candidat devenu Président est plus le symptôme que la cause d'un mal qui ne cesse de gagner du terrain depuis la signature du traité de Maastricht. La construction d'un monstre bureaucratique transnational sur des principes néo-libéraux a mis les droites françaises dans une impasse idéologique. Il n'est plus possible d'être Européen sans être accusé de brader les intérêts nationaux. Et il n'est plus possible d'être protectionniste sans faire craindre une sortie brutale de la zone euro. Au fond, les acquis du néo-libéralisme sont le poil à gratter d'une droite qui se cherche et ne parvient toujours pas à se trouver.

Un procès du néo-libéralisme est-il la seule décision salutaire que les droites françaises puissent prendre aujourd’hui ? Le spectacle idéologique qu’elles offrent donne en tout cas le sentiment d’une terrible vacuité et d’une incapacité à définir des lignes d’horizon compatibles avec les attentes des électeurs. Au fond, nos droites sont dans le brouillard et tâtonnent en essayant divers gadgets incertains, comme si elles étaient prisonnières de leurs vieilles lunes et de leurs débats dépassés.
Les droites françaises butent toutes sur la question de l’Europe néo-libérale
Ce qui coince, on le connaît : c’est la problématique de l’Union Européenne, du marché unique issu de Maastricht et des contraintes que l’appartenance de la France à une zone monétaire unique impose. Depuis 40 ans, à l’unisson des élites françaises qui se disent toutes « européennes », une grande partie de la droite a vendu aux Français un éloge sans nuance du marché unique, qui devait régler sans effort tous nos problèmes.
Près de trente ans plus tard, les Français mesurent les dégâts. Politiquement, l’Union Européenne est incapable de régler le moindre problème. On l’a vu avec les achats de vaccins. Économiquement, la France doit subir la concurrence directe de pays plus compétitifs sans avoir la faculté de dévaluer sa monnaie pour se donner de l’oxygène.
La droite allemande (et la gauche allemande aussi, d’ailleurs) l’avait bien compris : dès les années 90, nos voisins germaniques se sont mis en ordre de bataille pour affronter leurs concurrents. Ils ont réformé leur système de protection sociale, leur droit du travail, leurs dépenses publiques, pour ne pas courir le 100 mètres européen avec un fardeau sur le dos.
Les droites françaises n’ont pas eu ce courage, pas plus que les autres forces politiques de ce pays, et butent toutes sur les mêmes impasses. On veut de la monnaie unique, on veut de la liberté de circulation, on veut jouer dans la même cour que l’Allemagne, mais on veut aussi garder des dépenses sociales insoutenables et une ruineuse intervention de l’Etat dans tous les domaines.
Le ralliement à bas bruit des néo-libéraux français au protectionnisme
L’Europe nous a mis à l’heure des choix simples et clairs, mais les droites françaises, faute d’une compréhension idéologique de ce que le néo-libéralisme européen impose, vivent depuis des années comme des poules épouvantées par des couteaux face à la nécessité de s’adapter aux traités qu’elles ont largement proposé de signer.
Ainsi, la fraction néo-libérale de la droite, ce que René Rémond aurait appelé la droite orléaniste, s’est-elle progressivement ralliée au protectionnisme. Certes, il ne s’agit pas d’un protectionnisme assumé à la chinoise. C’est un protectionnisme à bas bruit qui se camoufle derrière des discours pro-européens. On l’a vu (y compris sous la houlette d’Emmanuel Macron), dans le dossier des travailleurs détachés : on veut bien librement circuler en Europe, à condition que les travailleurs polonais ou roumains ne viennent pas concurrencer les nôtres. Et l’on veut bien dénoncer le nationalisme des autres, mais continuer à considérer que, pour notre part, interdire à des salariés polonais de Peugeot de venir travailler pendant trois mois dans une usine du Nord est simplement normal.
Julien Aubert et Jacques Myard se sont exprimés dans nos colonnes sur ces questions de protectionnisme. Pour eux, il ne fait pas de doute que l’application des directives communautaires doit être à géométrie variable selon nos intérêts. Ces deux-là appartiennent beaucoup plus à la droite bonapartiste (pour reprendre les termes de Rémond) qu’à la droite orléaniste, il est vrai.
Mais on pourrait reprendre les positions de Xavier Bertrand, de tradition beaucoup plus néo-libérale, et l’on s’apercevrait qu’il propose les mêmes réflexes ou les mêmes choix. Le président de la région Nord a ainsi fait voter un plan de relance de 1,3 milliard comportant des aides directes aux entreprises. Il est aussi intervenu à plusieurs reprises pour pousser les entreprises nordistes à faire plus de « social ».
On voit bien qu’au fond, tout ce petit monde vit sur le mythe (largement inventé) du « gaullisme social », contre les principes de libre-concurrence auxquels la France a souscrit en adhérant (sur referendum) au traité de Maastricht. Contre la neutralité de l’Etat dans le domaine économique imposé par les traités, on préfère défendre « notre modèle social » (autre invention fantasmagorique et fourre-tout) au prix de coups d’Opinel dans nos engagements européens.
Le ralliement à bas bruit de Marine Le Pen à l’euro et à la BCE
La particularité du ralliement des néo-libéraux au protectionnisme tient à son ambiguïté. On veut le marché unique et, en même temps, comme dirait Macron, le protectionnisme. Cette incapacité à choisir est systémique et concerne toutes les droites françaises (et, d’une certaine manière, toutes les forces politiques françaises). La ralliement de Marine Le Pen à l’euro prouve, s’il en était besoin, que cette hystérie française qui consiste à vouloir une chose et son contraire, contamine toutes les droites.
On n’épiloguera pas ici sur les tirades historiques du Rassemblement National, et avant lui du Front National, concernant la préférence nationale. Marine Le Pen n’a jamais eu de mots assez durs contre la bureaucratie européenne, contre les technocrates de Bruxelles, et autres dénonciations souverainistes.
Mais… elle a finalement, elle aussi, pour se donner une chance d’être élue, entamé la circumgiration hystérique à la mode dans ce pays. Non seulement, elle a renoncé il y a plusieurs années au Frexit, mais elle a même récemment signé, dans le très néo-libéral quotidien de Nicolas Beytout, l’Opinion, une tribune appelant au remboursement de la dette.
De notre point de vue, il s’agit d’un texte extrêmement important, car il montre l’indécision de là où se trouve le centre de gravité des droites. Qu’il soit plus facile et tentant de se déclarer gaulliste social plutôt que libéral n’est pas chose nouvelle. Mais on découvre qu’il est plus facile d’être pour l’euro et contre le Frexit, que l’inverse. La droite légitimiste, comme disait Rémond, est aujourd’hui, semble-t-il, plus encline à rester dans la zone euro, symbole de notre perte de souveraineté, plutôt que d’en sortir.
Comment le confort néo-libéral a pourri les droites
De ces injonctions paradoxales, à la fois souverainistes et européistes, qui polluent tous les discours de droite, d’Emmanuel Macron à Marine Le Pen, on inférera plusieurs convictions.
La première est qu’il manque aujourd’hui aux droites françaises une cortication intellectuelle et idéologique capable d’inventer une alternative à la pensée néo-libérale, telle qu’elle fut formalisée en France à partir du colloque Lippmann de 1938 par des figures comme Raymond Aron. On oublie trop souvent, en effet, que c’est en France que le mot « néo-libéralisme » est apparu, lors de ce colloque de 1938 dont les participants admirent alors que l’on pouvait être néo-libéral et pratiquer une intervention directe de l’Etat dans le domaine de la protection sociale ou de la santé.
Ce modèle d’un libéralisme non manchestérien, c’est-à-dire d’un libéralisme appuyé par un Etat interventionniste, a permis aux droites de vivre dans un confort douillet pendant plusieurs décennies. Il a même très largement inspiré l’Acte Unique européen préparé par Jacques Delors, et, dans une large mesure, le Traité de Maastricht.
Ce que n’ont pas compris ses adeptes à travers l’après-guerre qui a vu l’épanouissement de l’étatisme néo-libéral français, c’est que leur confort idéologique, fait de capitalisme de connivence, de clientélisme politique et de paix sociale achetée à coup de protection, ne passerait pas l’épreuve des autres libéralismes européens. Au fond, le néo-libéralisme français répond à une logique de passager clandestin : on veut bien des avantages de l’euro et du libre-échange quand il permet d’élargir les marchés, mais on n’en veut pas les inconvénients.
Tôt ou tard, on doit pourtant payer son ticket. Et ce moment-là est très désagréable. On en connaît le contenu, auquel la France tente de se dérober : réforme systémique d’une protection sociale obèse et non-concurrentielle, diminution des déficits publics dans un univers de concurrence fiscale entre des Etats ouverts.
Le néo-libéralisme à la sauce française est mort
Pendant des années, en France, on pouvait se déclarer libéral et réclamer plus d’Etat, plus de sécurité sociale monopolistique, plus de subventions aux entreprises, plus de fonctionnaires.
La caricature de cette imposture a probablement été atteinte dans les années Chirac, avec la création du Régime Social des Indépendants, qui a consisté à imposer aux travailleurs indépendants une sécurité sociale inventée sous Vichy pour « protéger » les salariés. S’est alors ouvert une décennie de massacre organisé de l’entreprenariat français, où la sécurité sociale a plongé dans le désespoir des dizaines de milliers de gens qui n’avaient rien demandé. Les auteurs de ce désastre étaient Renaud Dutreil et Philippe Bas, conseillers d’Etat et ministres de « droite libérale ».
La mise en place de la mécanique de Maastricht, et surtout de l’euro, a cornérisé ce néo-libéralisme de soixante-huitard, qui a permis à tant de fonctionnaires de pantoufler grassement dans le privé au nom du New Public Management. On peut même affirmer que la privatisation des grandes banques à la fin des années 80 a transformé Bercy, et spécialement l’Inspection Générale des Finances, en salle de recrutement pour le capitalisme français, à rebours de la logique du marché unique et de la zone monétaire optimale que ces mêmes fonctionnaires promouvaient à Bercy.
Beaucoup de nos inspecteurs généraux ont cru qu’ils incarnaient le summum du capitalisme néo-libéral européen, sûrs de leur supériorité intellectuelle et de leur bon droit à utiliser l’Etat comme une passerelle vers les grandes entreprises lucratives. Ils n’ont toujours pas compris qu’ils en constituaient et en constituent toujours le repoussoir dans l’esprit des signataires du traité de Maastricht.
Ce que le traité nous interdisait, c’était cette confusion des genres, cette manie de croire que les règles sont merveilleuses lorsqu’elles nous profitent, mais insupportables lorsqu’elles nous demandent des efforts ou de la discipline, ou que l’intervention de l’Etat est mauvaise sauf lorsqu’elle protège une caste qui mange à tous les râteliers. C’est ainsi que nous entendons depuis trente ans les hauts fonctionnaires français nous donner des leçons de rigueur, mais n’en appliquer eux-mêmes aucune.
Le décrochage économique français auquel nous assistons en ce moment même chante l’halali de ce néo-libéralisme qui nous mène à l’impasse.
Les droites doivent faire le deuil du néo-libéralisme
Peu de gens l’ont compris à droite, et c’est pour cela que la droite est en perdition. Mais les Français vivent désormais avec plusieurs certitudes acquises.
La première, absolue, est que ce pays crève de sa bureaucratie. La couche de fonctionnaires (que la droite néo-libérale a largement contribué à élever) dont la seule mission est de réécrire à la main des dossiers envoyés par Internet accompagnés de dizaines de justificatifs pour un résultat incertain, cette couche est, à juste titre, identifiée comme parasitaire et devant être éradiquée. La somme de règles en tous genres inventées pour justifier des emplois nécessaires à l’instruction des dossiers, puis à la lutte contre la fraude, est ce dont les Français ne veulent plus. L’Absurdistan est devenu un sujet de détestation.
La deuxième est que les Français veulent des services publics qui fonctionnent. Personne ne comprend plus que nous soyons estourbis par les impôts les plus élevés du monde, et que notre administration soit incapable de délivrer correctement des cartes grises, des masques FFP2 ou des tests salivaires ou de faire respecter l’ordre républicain dans les « quartiers ».
La troisième est que le mélange des genres dans les élites, cette façon de profiter de tous les systèmes en toute impunité, tout en donnant des leçons de morale à la terre entière, est un sujet de détestation extrêmement profond. Sur ce point, Emmanuel Macron a beaucoup fâché les Français, avec sa petite phrase « qu’ils viennent me chercher! » imprudemment prononcée à l’abri d’un palais de la République à l’adresse du petit peuple. Cette phrase visait l’affaire Benalla qui est devenue une sorte de symbole du copinage, du piston et du népotisme.
Au-delà de cette affaire anecdotique, ce que les Français veulent, c’est que leurs élites prennent leur part de justice et en finissent avec le mélange des genres et le jeu de la courte échelle entre amis du service public et des entreprises privées.
Là encore, le recasage d’une Sibeth Ndiaye chez Adecco après son passage au gouvernement, puis son retour à LREM tout en restant à la tête d’une entreprise privée, écoeure beaucoup de Français. Le Président Macron ne l’a pas perçu, mais cette confusion permanente entre intérêts privés et intérêts publics, qui est une marque du néo-libéralisme à la française, est devenu insupportable à une écrasante majorité de gens de ce pays.
Ces trois points font déjà un programme en soi. Supprimer massivement la bureaucratie, redonner de l’efficacité aux services publics, à commencer par la police et la justice, dissoudre le capitalisme de connivence, forment une base programmatique simple et fédératrice.
On relèvera qu’aucun candidat de droite n’en porte les thèmes aujourd’hui.
Retour à un libéralisme manchestérien
Ce qui unit les Français aujourd’hui, très massivement, ce sont au fond ces revendications très conformes à un libéralisme manchestérien, celui où l’Etat se concentre sur ses fonctions régaliennes et éviter de se mêler de domaines où le libre choix des individus doit primer.
Nous revenons ici à notre problématique de base qui concerne le procès du néo-libéralisme. On voit bien combien les droites françaises ont intérêt à l’instruire. Car c’est bien l’abandon, dès les années 30, de la pensée qu’on qualifie de manchestérienne, mais qui fut portée par le Français Frédéric Bastiat, et l’adoption d’un libéralisme étatiste appelé néo-libéralisme, qui est au coeur des désagréments de notre époque.
Il est intéressant de noter que le général de Gaulle, lorsqu’il arrive au pouvoir en 1958, fait tout de suite appel à Jacques Rueff, qui avait, trente ans plus tôt, préparé le plan Poincaré, pour redresser la barre économique du pays. Le plan Rueff garantira quinze ans de prospérité au pays, avant que Giscard, qui était néo-libéral, n’en prépare la ruine.
Qui était Jacques Rueff ? Cet inspecteur général des Finances avait participé au colloque Lippmann de 1938… et il y avait combattu le principe du néo-libéralisme. Rueff était un libéral manchestérien qui préconisait de revenir à une non-intervention de l’Etat en économie.
Beaucoup de « gaullistes sociaux » feraient bien de se souvenir que la prospérité, sous le général de Gaulle, est venue du libéralisme le plus pur qui soit.
Neutralité de la question européenne
Dans cet ensemble, me demandera-t-on en conclusion, que devient la question européenne, qui est au centre de la détestation apparente de beaucoup de Français ?
De notre point de vue, la question européenne est un faux problème.
De deux choses l’une, en effet.
Soit la France fait le choix de rester dans l’Union Européenne, et elle doit en appliquer les règles loyalement. Elle doit diminuer ses déficits. Elle doit accepter l’ouverture à la concurrence dans le domaine du rail ou de l’électricité, ne serait-ce que parce qu’elle en profite largement pour attaquer les marchés étrangers. Elle doit donc se convertir à un libéralisme manchestérien.
Soit la France fait le choix de quitter l’Union Européenne, et elle doit alors affronter seule la concurrence internationale. Elle peut évidemment, à l’avenir, se doter d’une monnaie nationale qu’elle dévaluera lorsque ses entreprises nationales auront des coûts de production trop élevés, du fait d’une protection sociale et d’une fiscalité délirantes. Mais la dévaluation entraînera une augmentation des prix des produits manufacturés à l’étranger et importés sur le sol français. L’abonnement et l’utilisation de Netflix, avec le téléviseur et le téléphone portable qui vont avec, vont coûter beaucoup plus cher.
Sauf à transformer une France souveraine en Venezuela, il faudra donc pratiquer, là encore, du libéralisme manchestérien : diminuer les dépenses publiques, rétablir les équilibres des comptes publics, diminuer la pression fiscale.
Le choix n’est donc pas entre une France européenne néo-libérale et une France souveraine « sociale ». Il est entre une France manchestérienne et une France manchestérienne. Le suel problème que nous avons à régler est de savoir quand les Français le comprendront.