Au Soudan, la famine n’est pas une fatalité, mais le produit d’un État effondré et d’une communauté internationale paralysée. Entre guerres internes et bureaucratie humanitaire, des millions de vies sont sacrifiées sur l’autel de l’inaction politique.
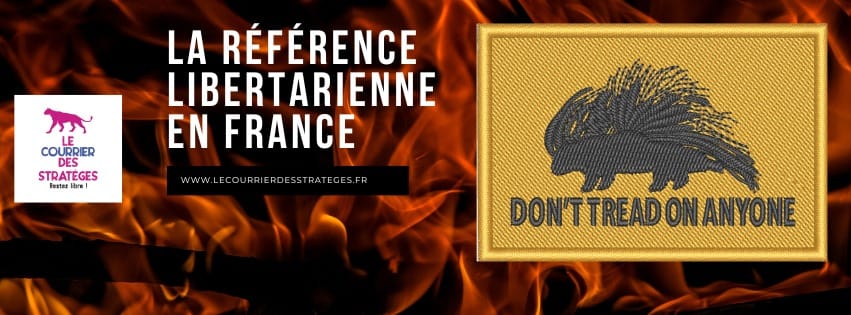
La dernière évaluation du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), un groupe d’experts internationaux ayant pour mission d’évaluer la gravité de l’insécurité alimentaire dans le monde, la famine gagne le terrain dans deux grandes villes du Soudan. Pendant plus d’un an, leurs habitants n’ont pas eu accès à de la nourriture et aux soins médicaux. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu.
Plusieurs régions de Soudan en détresse
Depuis avril 2023, le Soudan s’enfonce dans une guerre fratricide entre l’armée régulière et les Forces de soutien rapide. Derrière les combats, une tragédie plus silencieuse s’installe : la faim. Dans les villes d’El-Fasher et de Kadugli, la famine est désormais confirmée par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC). Vingt autres localités, du Darfour au Kordofan, sont menacées d’ici la fin de l’année.
Les chiffres effraient : plus de 40 000 morts, des millions de déplacés, des familles prisonnières de sièges militaires, privées d’eau et de nourriture. Les ONG dénoncent depuis des mois une crise « évitable ». Pourtant, ni l’État soudanais ni la communauté internationale n’ont agi. Pourquoi ? Parce qu’un État en ruine ne protège plus, et qu’une bureaucratie mondiale sans responsabilité réelle ne sauve jamais.
Dans un communiqué commun, l’Organisation des nations pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance) ont déclaré que les habitants de ces deux villes « ont enduré des mois sans accès fiable à la nourriture ni aux soins médicaux ». Le taux de malnutrition se situe entre 38% et 75% à El Fasher et à environ 30% à Kadougli.
Dans son rapport, l’IPC a indiqué que la famine menace une vingtaine d’autres régions du Darfour et du Kordofan, incluant les camps de déplacés. Si les hostilités persistent, les stocks alimentaires seront totalement épuisés à compter du mois de février. Les habitants de ces régions sont exposés au risque de malnutrition sévère. Il se peut que la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud, soit aussi en détresse en raison de l’accès humanitaire limité et des violences persistantes.
L’IPC a aussi lancé une alerte sur la prolifération de maladies comme le choléra, la rougeole et le paludisme dans les zones assiégées ou les zones de guerre en raison de la destruction des infrastructures de santé, le manque d’assainissement et le non-accès à l’eau potable.

Le mensonge de l’humanitarisme étatisé
En 2023, les organisations humanitaires n'avaient reçu que la moitié des 2,6 milliards de dollars nécessaires pour leurs opérations au Soudan . En 2025, alors que l'ONU lance un appel record de 4,2 milliards de dollars pour le Soudan, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU note que cela représente à peine 0,50 dollar par jour et par personne dans le besoin.
Le Soudan est aujourd'hui confronté à la pire crise de déplacement au monde, avec plus de 12 millions de personnes déplacées . Plus de 30 millions de Soudanais, soit les deux tiers de la population, ont besoin d'une aide humanitaire
Chaque rapport des Nations Unies ou de l’Union africaine se conclut par les mêmes mots : “il faut agir maintenant”. Mais agir comment, quand l’action humanitaire dépend d’appels de fonds, de réunions interminables et de sanctions géopolitiques contradictoires ?
La famine du Soudan démontre la faillite structurelle de l’humanitarisme centralisé. Ce ne sont pas les ONG locales ni les communautés autonomes qui manquent de volonté, c’est le système international qui les étouffe sous des conditions et des interdictions absurdes. Les camions d’aide sont bloqués, les financements détournés, les populations dépendantes d’un État incapable de garantir le minimum vital.
La famine soudanaise n’est pas une “catastrophe naturelle”, mais une conséquence politique : celle d’un État qui s’est arrogé tous les pouvoirs et a tout détruit , les institutions, la confiance, la responsabilité individuelle.










