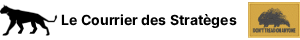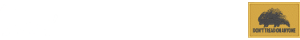La dette publique est-elle une invention ou une création des néo-libéraux qui cherchent à enrichir quelques riches créanciers ? Cette théorie un tantinet complotiste se répand dans les milieux « souverainistes » qui imaginent que l’indépendance de la France la mettrait magiquement à l’abri du besoin de rééquilibrer les comptes publics. Nous pensons au contraire que la dette publique résulte d’un compromis tacite entre la technostructure publique et quelques grandes fortunes pour préserver un capitalisme de connivence dont les uns et les autres tirent profit.
La dette publique serait-elle une invention des néo-libéraux ? Cette idée étrange est très répandue dans les milieux de la « réinformation », qui la présentent comme l’explication du marasme dans lequel nous vivons aujourd’hui. Il paraissait salutaire de s’appesantir un peu sur cette idée, pour en démonter le mécanisme, car, selon nous, elle dresse une impasse délibérée sur le rôle essentiel que joue la technostructure publique dans le capitalisme de connivence rebaptisé hâtivement néo-libéralisme par ce vaste fourre-tout qu’est devenu le souverainisme.
Dette publique, créances privées
Il est un fait que ce qu’on nomme d’ordinaire la dette publique est d’abord une somme de créances privées, sur la détention de laquelle règne une grande opacité. Le ministère des Finances ne publie d’ailleurs pas la liste des créanciers de l’État, ce qui contribue à nourrir de nombreux fantasmes sur le sujet.
Mais le principe d’un financement de l’action publique par le recours à une épargne privée rémunérée attise l’accusation de « néo-libéralisme » : de méchants capitalistes tapis dans l’ombre imposent des règles qui obligent à payer les riches pour financer les hôpitaux. Cette simplification, qui fait l’impasse sur la quasi-gratuité des emprunts souverains aujourd’hui, s’est répandue un peu partout. Je la lis par exemple sous la plume d’Éric Juillot, qui publie sur le blog de mon ami Olivier Berruyer, un texte édifiant sur le sujet.
L’auteur explique en substance que « la contre-révolution néolibérale a mis à bas ce système, et a restauré la contrainte artificielle du marché au profit des rentiers et des spéculateurs du monde entier, le tout sans aucune consultation démocratique (traité de Maastricht excepté) ».
Autrement dit, le financement de la dette par les marchés et non par la Banque de France serait le produit d’un diktat néo-libéral à l’origine d’un dispositif qui enrichit encore plus les riches, et appauvrit encore plus les pauvres. Au passage, le fait que les Français aient très majoritairement accepté ce système par referendum est significativement minoré, comme si un referendum n’était rien, et comme si, au fond, on n’avait pas consulté les Français sur le traité de Maastricht. On voit là, dans le beau story-telling qui nous est proposé, un premier arrangement gênant avec la réalité.
Car on peut bien nous expliquer qu’il existe une dictature bruxelloise aujourd’hui sur les finances publiques. Cette dictature dispose tout de même d’un mandat clair et clairement confié par le peuple français en 1992. Mais comme ce rappel ne colle pas avec la victimisation qu’on aime pratiquer, on le met entre parenthèses.
"La seconde phase, au cours des années 1990, voit la dette publique de la France s’envoler. En quelques années décisives, les dirigeants français apportent la preuve de leur conversion sans retour aux canons de l’ordre néolibéral, indépendamment de toute considération relevant de l’intérêt national et de la justice sociale."
Eric Juillot, les Crises
L’oubli de ce que signifie la création monétaire par la Banque de France
On comprend la théorie générale qui sous-tend ce discours. Elle est très bien connue des habitués de la question : ah! le bon temps où le gouvernement pouvait emprunter directement auprès de la Banque de France. À l’époque, au moins, la dette publique ne coûtait rien…
Outre que ce raisonnement fait l’impasse sur le fait que la France emprunte aujourd’hui sur les marchés à des taux quasi-nuls, voire nuls, voire négatifs, les défenseurs de la souscription directe de l’État auprès de la Banque de France oublient de dire que le système qu’ils proposent est un véritable pousse-à-la-dette, qui comporte une conséquence un peu désagréable : rapidement l’inflation monétaire que cette planche à billets qui ne dit pas son nom produit pèse sur le niveau de vie du pays.
Par le passé, la France a pratiqué ce système : les assignats n’ont pas fonctionné autrement durant la révolution, et ils ont ruiné l’économie… et les classes moyennes de l’époque. C’est l’envers du décor que les souverainistes oublient d’évoquer : leur proposition consiste à emprunter en levant un impôt sur tous les Français appelé la dévaluation monétaire. On verra combien de temps les partisans de l’emprunt direct à la Banque de France pourront expliquer que, grâce à leur brillant système, le téléphone portable double ou triple son prix en France tous les six mois, parce que le franc ou le sesterce ne vaut plus rien…
Le silence gêné des souverainistes sur le rôle de la technostructure publique
Mais ce qui retient l’attention dans le papier d’Eric Juillot, c’est le paradoxe qui ne semble pas l’étonner, consistant à expliquer que le néo-libéralisme fonctionne grâce à la dépense publique. Dans mon idée un peu naïve (mais je reconnais mes limites intellectuelles face aux gens bien plus brillants qui m’expliquent le contraire de ce que je croyais), le néo-libéralisme fonctionnait par une limitation du rôle de l’État. C’est pourquoi un grand méchant capitaliste néo-libéral comme le patron de la BNP, Michel Pébereau, avait écrit, en 2005, un rapport recommandant de juguler les dettes publiques.
Mais en fait non, je vais sur Les Crises, et je comprends que le néo-libéralisme, ce n’est pas la théorie de Jacques Rueff qui, en 1959, conjurait la dette publique et rétablissait l’équilibre budgétaire. C’est au contraire son extension et son expansion permanente voulue par les riches.
Comme cette théorie est un peu compliquée à comprendre, Éric Juillot nous livre une considération qui éclaire son propos : « Paradoxalement, c’est la technostructure qui est à la manœuvre au cours des années 1980 pour imposer cette évolution funeste. Passion technocratique, modernisme effréné, conservatisme antidémocratique et avidité : tels sont les principaux déterminants de ce changement ».
Donc je résume, le néo-libéralisme, c’est un système économique où des fonctionnaires creusent les dépenses publiques pour enrichir les capitalistes. Mais quelle est la motivation de ces fonctionnaires ? Éric Juillot peut-il expliquer pourquoi ces hauts fonctionnaires, qui ont fait les plus grandes écoles de France, font le jeu des capitalistes qui vivent sur le dos du pays ? Visiblement, son explication tient en deux mots : paradoxe, et passion.
C’est un peu court, jeune homme, et pas très éclairant.
Les quatre dernières décennies ont vu se produire en France une spoliation d’ampleur historique. Sur le plan politique, elle a pris la forme d’une dépossession démocratique ; sur le plan économique, elle s’est traduite par un transfert de richesse au profit des plus aisés. Cette spoliation a été rendue possible par la contre-révolution néolibérale des années 1980, dans le cadre de laquelle les structures du capitalisme financier mondialisé ont été mises en place en France. Au cœur de ces structures, un marché de la dette publique crée ex nihilo, indispensable aussi bien à la pérennité fonctionnelle d’une économie financiarisée qu’à un État affaissé, tenu d’étendre la protection sociale à tous ceux, nombreux, que cette économie précarisait.
Eric Juillot, les Crises
Technostructure et capitalisme de connivence
L’analyse d’Éric Juillot aurait sans doute gagné en sortant de ce pipeautage contemporain que recouvre le mot « néo-libéralisme », en réalité vide de sens, pour mieux saisir, mieux analyser factuellement, le lien organique qui entremêle les intérêts de quelques capitalistes et ceux de la technostructure au pouvoir. Car partout, nous voyons une collusion entre la haute administration et le management des grandes entreprises qui constituent le noyau dur du capitalisme français.
Il n’entre pas dans nos intentions ici de détailler ce point que nous évoquons régulièrement dans nos colonnes. Mais il est un fait qu’en France encore plus que dans de nombreux pays industrialisés, la haute fonction publique a mis l’État au service d’une caste, et réciproquement, une caste s’est mise au service de l’État. Il suffit de lire le parcours d’un Xavier Niel pour comprendre que l’intéressé n’aurait jamais fait fortune sans bénéficier de l’attribution de licences sur les réseaux de téléphonie et de diffusion numérique en tous genres. Ces licences ont été attribuées par l’État.
Il est un exemple parmi d’autres qui montre comment la connivence entre l’État et les grandes entreprises est constitutive du capitalisme français. On peut certes appeler ce capitalisme de connivence « néo-libéralisme » parce qu’on a envie de l’appeler comme cela. Mais le problème dans la France actuelle tient à une omniprésence de l’État dans le capital, et non à son absence. Et c’est factuellement le contraire du néo-libéralisme.
À moins bien sûr de rêver d’un système où toute l’économie serait nationalisée, mais il faut alors que les défenseurs de ces théories fassent clairement leur coming out marxiste-léniniste.
La dette publique est le prix que la haute fonction publique fait payer au pays
Dans ce capitalisme de connivence où les liens entre la technostructure publique (que nous appelons souvent gouvernement profond) et les détenteurs du grand capital sont difficiles à démêler, les Éric Juillot et autres pensent que l’État est la solution, alors qu’il est le problème. En réalité, depuis les années 90, une technostructure issue de ce qu’on a appelé la deuxième gauche, dont Pierre Moscovici est un bel exemple, a considéré que la modernisation du pays indispensable à la mise en place du traité de Maastricht, consistait à transformer l’État en terrain de jeu personnel ou en chasse gardée.
D’où ces idées selon lesquelles on pouvait gérer l’État « comme dans le privé ». Bien entendu, il s’agissait d’une mise en scène orchestrée par des fonctionnaires qui rêvaient des salaires du secteur privé, sans la prise de risque qui l’accompagne. Ces hauts fonctionnaires se sont déguisés en chefs d’entreprise comme Emmanuel Macron se déguise en pilote d’avion. Ils se sont donnés des frissons, ils ont fait des discours sur la réforme de l’État (ils ont même parfois écrit des livres sur le sujet), mais ils ont conservé la sécurité de l’emploi et ont bien pris garde à ne prendre aucun risque personnel et particulièrement aucun risque patrimonial dans cette affaire.
Ces apprentis sorciers ont creusé la dette. Depuis trente ans, ils font obstacle à toute politique libérale : ils refusent de baisser la dépense publique, et ils refusent de supprimer un statut protecteur pour les fonctionnaires, qui les met à l’abri de toute responsabilité individuelle.
Je veux bien que cette doctrine étatiste soit rebaptisée néo-libérale. Mais penser que la solution à ce trop d’État ruineux passe par encore plus d’État est la ruse suprême de la raison utilisée par ce capitalisme de connivence pour continuer son expansion permanente.
Car, avec tous ces souverainistes qui veulent toujours plus d’État, le mal empirera et ne sera pas attaqué dans ses racines. Il sera au contraire fortifié. Et voici comment la lutte contre le néo-libéralisme consolidera le capitalisme de connivence et la gabegie de dépense publique ordonnée par des hauts fonctionnaires. Et voici comment des Français sincères, qui rêvent d’une société plus équitable seront plumés pour enrichir encore tous les donneurs de leçons de solidarité.