Croire qu’on peut réduire le déficit public en augmentant les impôts relève du réflexe maladif : seule la réduction de la dépense publique peut, dans la France de 2025, y parvenir.
L'État moderne est en effet un pompier-pyromane: face à l'incendie structurel des finances publiques, le premier réflexe, pavlovien, de la caste au pouvoir est de brandir le spectre d’un impôt supplémentaire.Chaque nouveau déficit, chaque alerte de la Cour des Comptes, pourtant acquise à la doxa socialiste, est invariablement suivie par l'antienne d’un« prélèvement exceptionnel », d’un « rattrapage fiscal » ou d’une « contribution solidaire » (sans parler de l’invention de la « contribution volontaire obligatoire », sic !). C'est un scénario tragiquement prévisible, et historiquement voué à l'échec.
L'histoire économique, et singulièrement celle de la France de ces quarante dernières années, est formelle : le chemin de la consolidation budgétaire, à l’instar de celle impulsée par le Général de Gaulle en 1958, est rarement pavé de hausses d'impôts. Il repose presque toujours sur une réduction courageuse et structurelle de la dépense publique. Persister dans la voie de la pression fiscale accrue, exercice dans lequel semble exceller l’actuelle Assemblée jusqu’à la « sorcellerie fiscale » (le mot est de Roland Lescure, le locataire de Bercy), c'est non seulement mépriser les leçons du passé, mais c'est surtout punir la seule source de richesse du pays : l'initiative privée, l'investissement et le travail des Français. La hausse d'impôt n'est pas une solution ; elle est une punition et, pire, l’accélérateur – probablement salutaire – de notre inévitable chute.
L’Illusion fiscale : quand l’impôt tue l’impôt, détruisant la croissance
Le pari des gouvernements est d'une simplicité effarante : augmenter les taux marginaux, élargir l'assiette, et par un simple coup de baguette législative, voir les recettes combler le gouffre de leurs prodigieuses prodigalités : après l’argent magique, l’impôt magique ! Ce pari est une chimère de technocrate, car il ignore l'économie réelle au profit de la comptabilité théorique.
L'effet Laffer est une loi, pas une opinion
Le concept de la courbe de Laffer (on devrait d’ailleurs parler « des courbes »…), que Jordan Bardella est parvenu, accordons-lui cela,à exposer tout à fait clairement, n'est pas une fantaisie de penseur ultra-libéral : c'est une réalité empirique qui définit un seuil fiscal de rupture : au-delà d'un certain niveau – que l’État français a allègrement dépassé depuis des décennies – l'impôt devient un facteur récessif et l'augmentation des taux fiscaux ne fait alors plus mécaniquement grimper les recettes, car les acteurs économiques réagissent rationnellement à l'abus d'autorité.
1) Arbitrage et évasion fiscale : les entrepreneurs, les investisseurs et les individus les plus productifs réduisent leur effort, délocalisant leurs capitaux ou leur activité, et optimisant agressivement leur situation fiscale. Ils se réfugient dans l'épargne plutôt que de prendre des risques pour que l'État en récolte la quasi-totalité du bénéfice !
2) Erosion de l’effet de base: le choc fiscal ralentit l'économie, réduisant les bénéfices, faisant baisser les salaires et, partant, l'assiette taxable globale ; l’augmentation du taux se retrouve appliquée à une base de plus en plus étroite, si bien qu’au lieu de sauver les finances publiques, la hausse d'impôt finit d’achever la croissance (qui devrait déjà s’élever en France à moins de 0,8% en 2025), et par conséquent, mine les recettes futures, y compris la TVA et l'impôt sur les sociétés ! Champion mon frère !
Le cas édifiant de l'échec fiscal français (2012-2013)
L'exemple le plus flagrant (et récent) de l'échec de cette stratégie est la tentative d'« austérité fiscale » menée sous François Hollande au début des années 2010. La création de la tristement célèbre « taxe à 75% » sur les revenus supérieurs à 1 M€, et dont Arnaud Montebourg a révélé qu’elle n’était pour les socialistes eux-mêmesqu’une sirène pour attirer les électeurs de Mélenchon, conjuguée aux hausses de la fiscalité sur le capital, a été un fiasco plus que retentissant :
1) 60 000 départs de contribuables fortunés ont été enregistrés entre 2011 et 2015, selon l’INSEE.
2) Le produit escompté de la taxe à 75% (420 M€ par an) a été largement inférieur aux attentes (moins de 260 M€) : l’argent n’était plus là, ou avait migré !
3) La croissance économique a stagné (0,2% en 2013 !)et le déficit public est resté obstinément élevé (4,8% du PIB) : la hausse des impôts a freiné l’activité et n'a pas réussi à combler le déficit, prouvant qu'il est impossible de taxer une économie qui ne crée plus de richesses.
L'État, dans son arrogance comptable et sa « présomption fatale » (Hayek)a la fâcheuse tendance d’oublier qu'il ne produit rien : il ne fait que prélever sur un flux. Or, si ce flux se tarit par l'excès de prélèvements obligatoires (46% du PIB en France), tout le système s'effondre.
Vouloir réduire le déficit par l'impôt, c'est tenter d'éteindre un feu en y jetant de l’huile, au prix d'un déficit en capitaux privés qui étrangle et l'investissement et l'emploi. C'est l'essence même de l'effet d'éviction, orchestré non par le marché, mais par le bureaucrate omnipotent de Bercy ou du Palais-Bourbon.
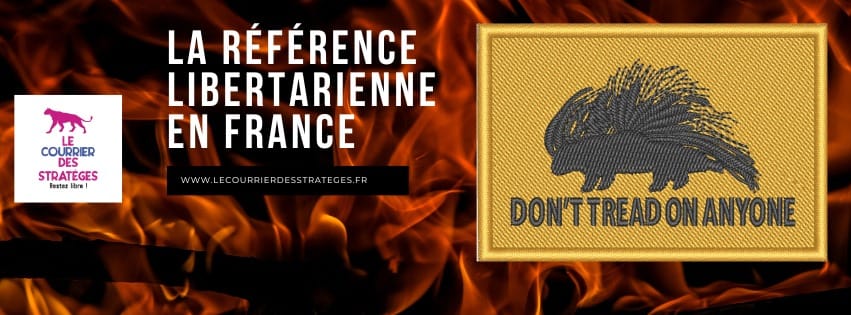
Le nœud gordien : la dépense publique, ce cancer incompressible
Si la hausse d'impôt est une fausse solution, c'est que la question n'est pas celle du financement, mais celle de la légitimité de la dépense publique. Au fond, le déficit est simplement le coût de l'extension illégitime du rôle de l'État au-delà de ses fonctions régaliennes fondamentales : c'est le prix de la servitude et de l'irresponsabilité.
Le mal structurel : l'effet cliquet et les rentiers de l'État-Providence
Les dépenses publiques sont structurellement en croissance pour des raisons politiques et bureaucratiques qui se renforcent mutuellement :
1) L’effet cliquet inversé : une dépense créée est une dépense qui ne disparaît jamais. Elle engendre des bénéficiaires, des fonctionnaires, des syndicats et des groupes d'intérêts (le fameux « capitalisme de connivence ») qui se constituent en véritables rentiers de l'État-providence. Chaque subvention, chaque poste de fonctionnaire, chaque programme social devient un droit acquis inamovible, protégé farouchement par ses lobbies. Le politique s'assure ainsi une clientèle électorale captive.
2) L'inflation normative et la gésine d’une nomenklatura : l'État, par sa nature bureaucratique, génère sans cesse de nouvelles réglementations et de nouvelles normes, qui exigent à leur tour de nouvelles administrations, de nouveaux contrôleurs, et donc, de nouvelles dépenses. Nous sommes face à une nomenklatura administrative qui n'a aucun intérêt à l'équilibre budgétaire. Bien au contraire, le déficit et la dette sont les leviers qui justifient son existence et son pouvoir, et qui lui permettent de se croire indispensable. Rien de très nouveau pour qui a lu L’acteur et le système de Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977).
La faillite de la redistribution : du service public au transfert social-clientéliste
L'immense majorité de la dépense publique contemporaine n'est plus dédiée à la sécurité, à la justice ou aux infrastructures vitales : elle est consacrée à aux mécanismes, complexes, inefficaces et clientélistes de la redistribution.
L'État est devenu un gigantesque hub de transferts sociaux, une machine inefficace qui capte annuellement environ 57% du PIB,pour le disperser de manière opaque et… partisane ! Le résultat est double : une bureaucratie pléthorique et dispendieuse pour gérer ces transferts, et surtout, la destruction du signal-prix et de l'incitation au travail et à l'épargne.
Le véritable courage politique n'est pas de demander un énième effort aux contribuables français déjà essorés, mais de s'attaquer à la racine du problème : démanteler ces structures de dépenses superflues qui ne font qu'entretenir la dépendance et le gaspillage. C’est le travail qu’a entrepris Javier Milei en Argentine dès la fin 2023 et qui lui a valu de gagner haut la main les législatives de mi-mandat qui viennent d’avoir lieu.








