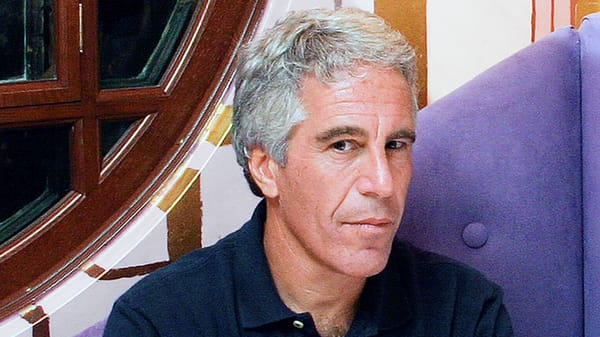Au cœur du tumulte géopolitique déclenché par l'invasion de l'Ukraine, une proposition radicale du chancelier Merz menace de redéfinir les règles de la guerre économique : la confiscation des avoirs souverains russes gelés. Présentée comme un impératif moral pour financer la reconstruction ukrainienne, cette mesure constitue en réalité une rupture avec un principe fondateur des démocraties libérales : l'inviolabilité du droit de propriété.
Au-delà de la simple sanction, il s'agit d'une expropriation étatique qui, en l'absence d'un cadre juridique incontestable, risque de substituer l'arbitraire politique à l'État de droit. La question n'est donc pas seulement de savoir si cette action est une "provocation" contre la Russie, mais si, en cherchant à punir un adversaire, l'Occident n'est pas en train de saborder les fondements mêmes de l'ordre juridique et économique qui garantit sa prospérité et sa stabilité, un ordre où la protection de la propriété privée et étatique est la pierre angulaire de la confiance et de la liberté.
Un précédent juridique aux conséquences incalculables
L'idée de confisquer les actifs de la Banque centrale de Russie se heurte à un pilier du droit international : l'immunité souveraine, qui protège les biens d'un État contre la saisie par un autre. Il est essentiel de distinguer le gel, mesure temporaire et réversible qui bloque l'accès aux actifs, de la confiscation, qui est une expropriation permanente. Franchir cette ligne revient à créer une brèche dans le bouclier juridique qui préserve les relations internationales de la loi du plus fort.
Les partisans de la mesure tentent de la justifier en la qualifiant de "contre-mesure" légale, un outil permettant à un État lésé de répondre à un acte illégal. Cependant, cet argument est ténu. Les contre-mesures doivent être, par nature, temporaires et proportionnelles, visant à ramener l'État fautif à la raison. La confiscation est, elle, définitive. De plus, le droit des États tiers (comme les pays du G7) à prendre de telles mesures pour le compte de l'Ukraine n'est pas solidement établi, ouvrant la porte à des accusations d'instrumentalisation du droit à des fins politiques. Sans un mandat clair de l'ONU, impossible à obtenir en raison du veto russe, la confiscation apparaîtrait comme un acte de puissance discrétionnaire.
Face à cette impasse, une solution de compromis a émergé : la saisie non pas du capital, mais des "bénéfices exceptionnels" générés par les avoirs gelés. Le G7 a ainsi décidé d'utiliser ces futurs profits pour garantir un prêt massif à l'Ukraine. Bien que présentée comme juridiquement moins risquée, cette manœuvre est qualifiée de "vol" par la Russie et reste une atteinte au droit de propriété. Elle ne résout pas le problème de fond : en touchant aux fruits d'une propriété, même sans saisir le capital, on affaiblit le principe de sa sanctuarisation. Des initiatives nationales, comme le REPO Act américain, autorisent une confiscation directe, mais créent une situation périlleuse où un acte légal au niveau national est potentiellement illégal au niveau international, sapant la prévisibilité de l'État de droit mondial.
L'onde de choc : quand la confiance s'effondre
L'ensemble de l'architecture financière mondiale, et par extension l'économie de marché, repose sur un pilier immatériel : la confiance. La confiance qu'un actif déposé aujourd'hui sera encore là demain, indépendamment des vents politiques. La confiscation des avoirs souverains russes pulvériserait cette confiance, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour l'Occident.
Le statut du dollar et de l'euro comme monnaies de réserve mondiales serait directement menacé. Si les banques centrales du monde entier, de Riyad à Brasilia, en viennent à considérer que leurs réserves peuvent être saisies sur décision politique, l'incitation à se détourner des devises occidentales deviendra irrésistible. Il ne s'agit pas d'un risque d'effondrement immédiat, mais d'une érosion lente et certaine de l'hégémonie financière occidentale.

Cette politique serait un "cadeau pour Pékin". La Chine, qui cherche depuis longtemps à promouvoir le yuan comme alternative au dollar, se verrait offrir sur un plateau son meilleur argument. Elle pourrait se présenter comme un gardien plus fiable de la souveraineté et de la propriété, accélérant les efforts de dédollarisation menés par les BRICS. Paradoxalement, une mesure punitive de l'Occident pourrait réaliser l'un des objectifs stratégiques majeurs de ses adversaires : la fragmentation de l'ordre financier mondial.
Pour l'Europe, le risque est encore plus direct. La majorité des avoirs russes est détenue par Euroclear, une institution financière basée en Belgique. Toute mesure de confiscation exposerait la zone euro à des litiges sans fin, à des représailles ciblées et à une instabilité systémique. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs exprimé de vives inquiétudes, craignant une fuite des capitaux et une perte de confiance des investisseurs internationaux, qui pourraient juger les places financières européennes trop risquées.
Le calcul géopolitique et le coût de l'arbitraire
Le débat sur la confiscation a révélé une fracture au sein de l'alliance occidentale. D'un côté, les "faucons" (États-Unis, Royaume-Uni, pays baltes) privilégient une approche punitive, considérant que la Russie doit payer à tout prix. De l'autre, les "pragmatistes" (France, Allemagne, Belgique) s'inquiètent de la destruction des normes juridiques et financières qui pourrait en résulter. Cette division reflète une tension fondamentale entre l'émotion d'une juste colère et la raison stratégique qui commande de ne pas détruire l'ordre international pour le défendre.
La réaction de la Russie a été sans équivoque : toute saisie sera considérée comme un "vol" et entraînera des représailles "sévères". Moscou ne peut pas déstabiliser le système financier mondial, mais il peut saisir les milliards d'actifs occidentaux encore présents sur son territoire, transformant des entreprises européennes et américaines en "otages" économiques. Ce cycle de représailles marquerait une nouvelle étape dans la dégradation des relations internationales, où la sécurité juridique des investissements serait la première victime.