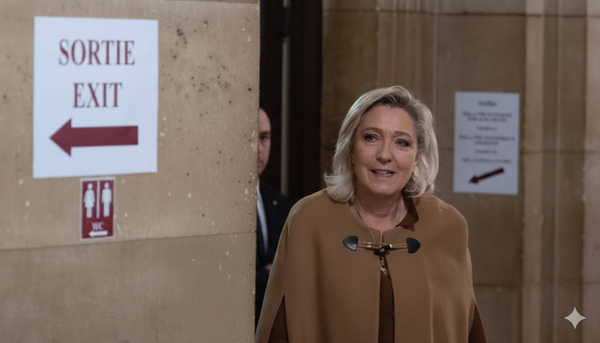Il faut une certaine dose de courage, ou peut-être d’inconscience, pour observer le spectacle offert par l’Assemblée nationale lors de l’examen du budget 2026 et y voir autre chose qu’une vaste comédie du pouvoir. Sous les dehors d’une « co-construction » démocratique, vantée par un exécutif privé de sa majorité et de son arme fétiche du 49.3, se joue en réalité une pièce bien plus ancienne : celle de la redistribution des dépouilles d’un État obèse, dont personne, absolument personne, n’envisage sérieusement de réduire la taille.

Le premier acte, le rejet de la partie recettes en commission, fut une parfaite illustration de cette posture. Une alliance de circonstance, des Insoumis au Rassemblement National, s’est formée pour signifier son mécontentement. Mais quel était le fond du désaccord? Une critique de la dépense publique galopante? Une remise en cause de la structure même de notre fiscalité confiscatoire? Nullement. Il s’agissait d’un simple jeu de rôle, une manière pour chaque faction de marquer son territoire avant le grand marchandage dans l’hémicycle. Le but n’était pas de proposer une alternative crédible à la trajectoire budgétaire insoutenable de la France, mais de s’assurer une meilleure place à la table des négociations pour le partage du gâteau.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit. La « co-construction » n’est pas un dialogue vertueux sur la meilleure façon de gérer les deniers publics ; c’est un souk parlementaire où chaque groupe vient échanger son soutien contre une niche fiscale, une subvention pour son électorat, ou une nouvelle taxe punitive pour l’adversaire idéologique. Le résultat de la première journée de débats en séance publique en est la preuve éclatante.
L’événement majeur, présenté comme une victoire historique de la « justice fiscale », est l’adoption de l’amendement n°1467 pérennisant la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR). Analysons froidement ce qui s’est passé. Une mesure, initialement temporaire, devient permanente. D’un point de vue libertarien, c’est la chronique d’un hold-up annoncé. L’État, sous prétexte de lutter contre « l’optimisation fiscale » – ce réflexe sain de tout individu cherchant à protéger le fruit de son travail d’une spoliation excessive –, grave dans le marbre un impôt supplémentaire.
L’argumentaire des promoteurs de cet amendement est un cas d’école de la rhétorique étatiste. On fustige les contribuables qui, face à une taxe temporaire, ont le bon sens de différer leurs revenus. Au lieu de s’interroger sur le caractère dissuasif et contre-productif de l’impôt lui-même, on choisit de le rendre permanent pour piéger le contribuable. C’est une logique de prédateur, pas de gestionnaire. On ne cherche pas à encourager la création de richesse, mais à maximiser la ponction sur la richesse existante. Cette pérennisation envoie un signal désastreux : en France, le succès est suspect et doit être taxé jusqu’à ce que la jalousie soit satisfaite. Peu importe que cela décourage l’investissement, l’innovation et incite les talents et les capitaux à chercher des cieux plus cléments. L’essentiel est de satisfaire une idéologie égalitariste qui préfère l’égalité dans la pauvreté à la prospérité dans l’inégalité.

Ce qui est encore plus révélateur, c’est ce qui n’est pas débattu. Sur les milliers d’amendements déposés , combien proposent de supprimer des agences publiques redondantes, d’abroger des pans entiers de réglementations qui étouffent nos entreprises, ou de tailler drastiquement dans les dépenses de fonctionnement de l’État? La réponse est proche de zéro. Le débat se concentre sur la marge, jamais sur la structure. On discute de l’ajustement des tranches de l’impôt sur le revenu, mais pas de la nécessité d’un impôt à taux unique, simple et faible, qui libérerait l’énergie créatrice. On débat de crédits d’impôt pour l’achat de vélos, mais pas de la suppression des subventions qui faussent le marché.