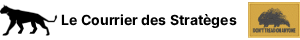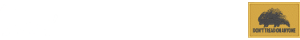L'Histoire ne repasse pas les plats, dit-on, mais elle a parfois un sens cruel de l'ironie. Quarante-sept ans presque jour pour jour après le départ du Shah, l'hiver téhéranais a de nouveau cette odeur âcre de pneus brûlés et de révolte. Mais ne nous y trompons pas : ce qui se joue en ce début d'année 2026 sur le plateau iranien n'est pas une simple réplique des séismes passés. C'est un effondrement.

C'est le bruit sourd d'un système qui, après avoir été méthodiquement désossé par une guerre perdue en juin dernier, se fracasse aujourd'hui sur la réalité comptable de sa propre faillite. Sur ce point, le Courrier présente ses excuses pour avoir, sous la plume d'Edouard Husson aux mois de juin et de juillet, répercuté sans nuance et le minimum d'esprit critique qui sied à des personnes lucides, la propagande iranienne qui affirmait le contraire et promettait la chute de Netanyahou.

Alors que j'écris ces lignes, en ce jeudi 8 janvier, l'Iran retient son souffle. Le Prince Reza Pahlavi, depuis son exil, a donné rendez-vous à l'Histoire ce soir à 20 heures, appelant à une coordination nationale des slogans. Au même moment, une grève générale paralyse le Kurdistan iranien. Le régime, acculé, oscille entre la menace d'une répression terminale et la peur panique de provoquer l'intervention américaine promise par Donald Trump.
Comment en sommes-nous arrivés là? Pour comprendre la tectonique de ce soulèvement, il faut dépasser l'écume des événements et plonger dans les trois abîmes qui sont en train d'engloutir la République Islamique : la ruine économique, l'humiliation militaire et, fait nouveau et documenté, une guerre hybride étrangère d'une sophistication inédite.
L'arithmétique du désespoir
Il faut d'abord parler d'argent. Pas de macro-économie théorique, mais de la violence du quotidien. Imaginez un pays où votre monnaie fond littéralement dans votre poche le temps de traverser la rue. C'est l'Iran de janvier 2026.
Le dollar s'échange aujourd'hui à 1 460 000 rials sur le marché libre. Pour saisir le vertige de ce chiffre, rappelons qu'en 1979, il en valait 70. Cette dépréciation n'est pas une statistique ; c'est une sentence de mort sociale. Elle signifie que le salaire d'un professeur ou d'un ouvrier ne suffit plus à acheter le pain et le fromage de la semaine.

Le détonateur de cette explosion, ironiquement, a été tiré par le président "réformateur" Masoud Pezeshkian. Élu sur des promesses de redressement, il s'est retrouvé gestionnaire de la banqueroute. Fin décembre, les caisses étant vides, il a dû supprimer le taux de change préférentiel (le fameux dollar subventionné) pour presque toutes les importations, ne sanctuarisant que les médicaments vitaux et le blé.
Le résultat a été immédiat et brutal : les prix ont doublé en une nuit. C'est ce qui a poussé le Grand Bazar de Téhéran à baisser le rideau le 28 décembre. Quand le Bazar, ce poumon conservateur et historique de la société iranienne, se met en grève, ce n'est jamais par idéologie libérale. C'est parce que le commerce est devenu mathématiquement impossible. Les marchands ne peuvent plus fixer de prix, car le coût de remplacement de leur stock augmente plus vite qu'ils ne peuvent vendre.

Cette "grève des tiroirs-caisses" s'est métamorphosée en insurrection politique en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'en Iran, l'économie est politique. Quand le peuple scande "Mort au Dictateur" aujourd'hui, il ne réclame pas seulement la liberté de vote, il réclame le droit de ne pas mourir de faim au nom d'une idéologie impériale qui a ruiné le pays. Le slogan "Pas Gaza, Pas le Liban, je sacrifie ma vie pour l'Iran" n'a jamais résonné avec une telle fureur. Les Iraniens, affamés, refusent désormais de financer les guerres du Guide Suprême.


L'ombre de la guerre de douze jours
Ce soulèvement ne peut être compris sans le spectre de juin 2025. La "Guerre de Douze Jours" entre Israël, les États-Unis et l'Iran a été le moment de bascule.
Le régime iranien a longtemps tenu sur deux piliers : la répression intérieure et la dissuasion extérieure (son programme nucléaire et ses milices régionales). En juin dernier, le second pilier a beaucoup souffert, n'en déplaise aux influenceurs pro-iraniens. Les frappes chirurgicales israéliennes et américaines n'ont pas seulement détruit les centrifugeuses de Fordow et Natanz grâce aux bombes anti-bunker GBU-57 ; elles ont brisé le mythe de la puissance perse.
Le bilan est considérable. Des estimations proches de services américains chiffrent le coût global de ce conflit pour l'Iran à 3 000 milliards de dollars si l'on inclut la destruction des terminaux pétroliers et le manque à gagner futur. L'armée iranienne a été humiliée, ses défenses antiaériennes aveuglées, et sa riposte vers la base d'Al-Udeid ou vers Israël a déçu tous ceux qui s'attendaient à une riposte destructrice.
Aujourd'hui, quand le Conseil de Défense iranien menace de "frapper préventivement" ou promet une "réponse décisive" aux ingérences actuelles, personne ne tremble. Le Roi est nu. Les manifestants le savent. Les forces de sécurité le savent. Cette perte de crédibilité militaire agit comme un dissolvant sur la peur. Comment craindre un régime qui n'a pas su protéger son propre ciel?
La main de l'étranger : fantasme ou réalité?
C'est ici que l'analyse doit se faire chirurgicale. Le régime crie au complot étranger, comme il le fait depuis quarante ans. L'Occident, par réflexe, crie à la spontanéité absolue du mouvement. La vérité, comme souvent, est plus sombre et plus complexe.
Existe-t-il des preuves fiables d'une ingérence? La réponse est oui. Et elle est double.