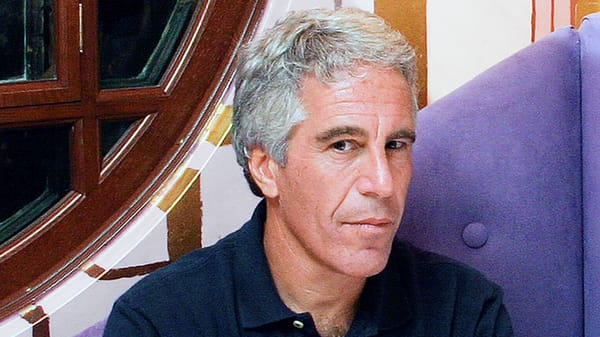Selon le dernier rapport de l'OMS, un enfant européen sur quatre est en surpoids. Derrière ce constat se cache une faillite collective : celle des politiques publiques incapables de freiner la malbouffe industrielle et la sédentarité : deux fléaux alimentés par le confort bureaucratique et la passivité parentale.
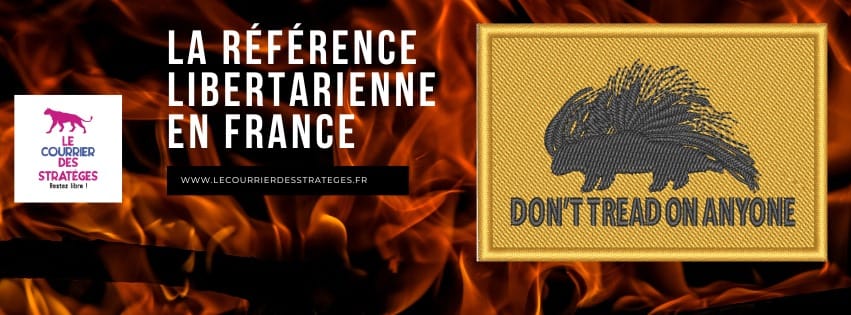
Loin d'être un simple problème de santé publique,le surpoids des enfants révèle les failles de l'interventionnisme étatique. Il souligne l'échec des campagnes de prévention paternalistes, le poids insidieux des subventions agroalimentaires et la négligence de la responsabilité individuelle et familiale.
Des chiffres qui dénoncent l'échec des politiques publiques
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier un rapport édifiant : 25 % des enfants de 7 à 9 ans présentent un excès de poids, dont 11 % sont déjà obèses. Ce constat, loin d’être une surprise, illustre la persistance d’un problème que les autorités connaissent depuis des décennies sans jamais le résoudre.
Les campagnes de prévention, souvent ponctuelles et moralisatrices, se heurtent à une réalité économique et culturelle : les familles sont incitées à consommer des produits ultra-transformés, moins chers et omniprésents.
Pendant ce temps, les décideurs politiques se contentent d’annoncer des « plans nutrition santé » dont les effets sont invisibles sur le terrain. Critiquer uniquement le manque d'exercice (40 % des enfants utilisant un moyen motorisé pour l'école) ou la surconsommation de sucreries (41 % plus de trois fois par semaine) est insuffisant. Il faut pointer les distorsions du marché créées par l'État.
Malbouffe subventionnée, éducation ignorée
La Politique Agricole Commune (PAC) européenne, par ses subventions massives, a historiquement favorisé la production de masse, souvent au détriment de la qualité nutritionnelle. Elle maintient artificiellement bas les prix de certains produits transformés, riches en calories bon marché (sucre, huiles végétales, céréales raffinées), et par conséquent, rend la "malbouffe" structurellement plus accessible et compétitive que les aliments frais et de qualité.
Le marché ne fonctionne pas librement ; il est faussé par les interventions publiques qui rendent les fruits et légumes frais (consommés quotidiennement par seulement 46 % et 32 % des enfants, respectivement) relativement plus chers et moins pratiques.
Le paradoxe le plus frappant de l'étude : deux tiers des parents d'enfants en surpoids les perçoivent comme ayant un poids normal. Ce chiffre ne révèle pas seulement un problème de perception sanitaire, mais un effondrement du principe de responsabilité parentale.

Le déni parental, symptôme d'une société déresponsabilisée
Dans une société où l'on attend systématiquement que les pouvoirs publics règlent les problèmes les plus intimes, la vigilance familiale s'émousse. Pourquoi les parents assumeraient-ils pleinement leur rôle d'éducateurs alimentaires quand une multitude d'agences et de programmes publics prétendent le faire à leur place ?
Le rapport évoque aussi un « double fardeau » de la malnutrition, où obésité et sous-alimentation coexistent, reflet des fractures sociales. Or, les politiques publiques uniformes, comme les taxes sur les sodas ou les subventions généralisées, frappent indistinctement et manquent leur cible. Elles pénalisent financièrement les plus modestes sans leur offrir de véritables alternatives.
Le fait que les enfants de familles moins favorisées marchent ou fassent plus de vélo pour aller à l'école est un indice : les solutions émergent souvent des comportements individuels et non des plans bureaucratiques. La véritable injustice est l'incapacité du système à permettre l'accès à une diversité de solutions adaptées aux contextes familiaux.
L'effort pour "protéger la santé et le bien-être des enfants", comme le suggère le Dr Gundo Weiler de l'OMS, doit reposer sur la conviction que les individus (et les familles) sont les mieux placés pour prendre des décisions les concernant, à condition qu'ils en assument la pleine responsabilité. La solution n'est pas plus de réglementation et d'impôts, mais moins de subventions et un retour au principe de l'autonomie responsable.