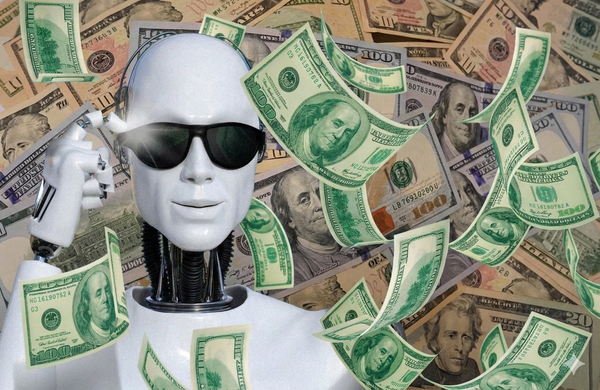Le rapport d'information du Sénat , rédigé par Jean-Marie Mizzon rapporteur spécial de la mission « Participation de la France au budget de l'Union européenne » et examiné le 8 octobre 2025, met en lumière l'explosion des engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne (UE), qui exposent son budget à des risques. De 2019 à 2024, ces engagements – principalement des prêts et garanties non provisionnés – ont quadruplé, atteignant potentiellement 640 milliards d'euros d'ici 2027. Ce document révèle non seulement une mauvaise gestion bureaucratique, mais une véritable agression contre la liberté individuelle : l'UE, en s'endettant massivement pour des assistances à l'Ukraine et aux États membres, transfère les risques aux contribuables sans leur consentement, favorisant une socialisation des pertes au profit d'une élite technocratique.
La commission des finances a examiné, le mercredi°8°octobre°2025, le rapport de M. Jean-Marie Mizzon, , à la suite de son contrôle budgétaire sur les engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne. Le rapport met en lumière une réalité alarmante : une expansion massive, rapide et opaque de l'endettement collectif. Les engagements, ou "passifs éventuels", représentent des obligations financières potentielles qui ont presque quadruplé entre 2019 et 2024, avec une projection de 640 milliards d'euros d'ici 2027.
L’expansion incontrôlée du risque budgétaire européen
Selon le rapport, entre 2019 et 2024, les engagements extrabudgétaires de l’Union ont quadruplé, passant de 160 à 640 milliards d’euros projetés d’ici 2027. Ces engagements couvrent des prêts, garanties et dispositifs d’assistance (SURE, FRR, SAFE, etc.) destinés aux États membres et à des pays tiers.
Ce système contourne les procédures budgétaires classiques : Bruxelles s’endette en son nom, mais la responsabilité financière retombe sur les États, donc sur les contribuables. C’est le principe même de la dépense sans contrôle.
Le plan de relance post-Covid et la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) ont ouvert la porte à une logique dangereuse : l’UE emprunte sur les marchés comme un État fédéral, sans disposer d’un véritable contrôle démocratique.
Sous couvert de solidarité, chaque crise devient un prétexte pour étendre la dette commune — hier la pandémie, aujourd’hui l’Ukraine, demain la défense (programme SAFE).
En offrant des taux d'intérêt compétitifs sur la base du crédit collectif, l'UE récompense l'irresponsabilité budgétaire des États membres les moins disciplinés, qui ont "intérêt à recourir aux instruments conçus par l'UE pour s'endetter".
La France, en tant que deuxième contributeur net au budget de l'UE, est exposée à ce risque de défaut qui, à moyen terme, est jugé élevé pour les finances publiques des États les plus endettés d'ici 2035.
Cette dérive traduit une dépossession : les États perdent la maîtrise de leur politique budgétaire, tandis que l’Union avance aveuglement vers une centralisation financière irréversible.

Le soutien à l'Ukraine : des prêts risqués qui socialisent les pertes
Le rapport souligne que l'assistance à l'Ukraine représente 90 % des prêts à des pays tiers, avec 80,4 milliards d'euros engagés depuis 2014, dont 52,5 milliards décaissés au 16 juin 2025. Les montants ont explosé : de 4,1 milliards avant 2022 à 33 milliards en 2024, via des mécanismes comme l'assistance macrofinancière (AMF) et la facilité pour l'Ukraine.
Initialement provisionnés à 9 %, ces prêts ont vu leur couverture grimper à 70 % en 2022, avant un revirement en 2023 où le provisionnement est abandonné, transférant les risques aux États membres via la "marge de manœuvre".
Depuis 2024, les institutions européennes financent l’Ukraine en exploitant les revenus — et bientôt le capital — des avoirs russes gelés. Ce projet de “prêt de réparation” de 140 milliards d’euros remet en cause le droit de propriété et mine la confiance dans les places financières européennes.
Sous prétexte de morale géopolitique, l’Union ouvre la voie à la spoliation économique et fragilise la sécurité juridique du continent.
Pourquoi les contribuables français devraient-ils porter le fardeau d'un défaut ukrainien potentiel, estimé par le FMI à plus de 10 milliards par an ? Cela socialise les pertes : les États membres, y compris la France, absorbent les risques sans bénéfice direct, au lieu de laisser des initiatives privées ou bilatérales volontaires gérer l'aide.
Le rapporteur note un manque de transparence ; nous en tant que libertarien, on exigerait un audit complet et une fin des subventions forcées.

La France, contribuable et garant de dernier ressort
Deuxième contributeur net de l’Union, la France se retrouve exposée aux risques de défaut de plusieurs États très endettés (Italie, Espagne, Pologne).
En cas de faillite d’un instrument européen, les États devront augmenter leur contribution nationale — une hausse d’impôt différée imposée sans débat parlementaire. Pour un pays déjà surendetté, cette solidarité imposée équivaut à un transfert de souveraineté budgétaire déguisé.
Aucun de ces engagements n’a été validé directement par les citoyens. Le Parlement européen n’a qu’un rôle consultatif, les Parlements nationaux sont tenus à l’écart, et la Commission européenne agit en gestionnaire autonome de la dette commune. C’est la négation même du consentement à l’impôt, principe fondateur de toute démocratie libérale.
Ce rapport n'est pas seulement un constat comptable ; c'est un signal d'alarme sur l'incohérence fiscale de l'Union européenne. L'explosion des engagements extrabudgétaires marque l'échec d'une politique qui cherche à répondre aux crises par l'endettement collectif et l'opacité.