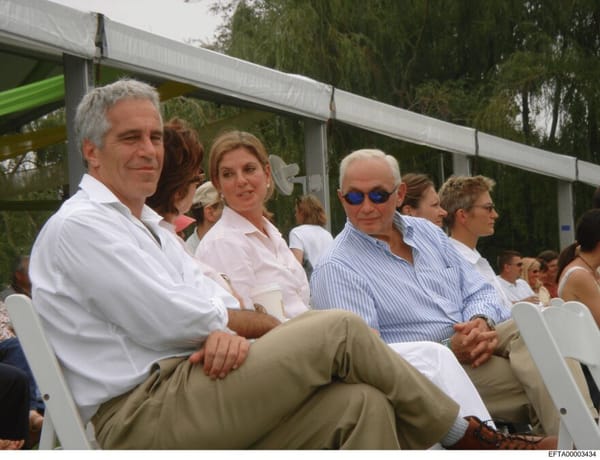Le constat de l'Insee est accablant : les privations matérielles des enfants augmentent. La réponse étatique, elle, reste un échec. Le fardeau fiscal et réglementaire pèse sur les familles, étouffant leur pouvoir d'achat et leur autonomie.
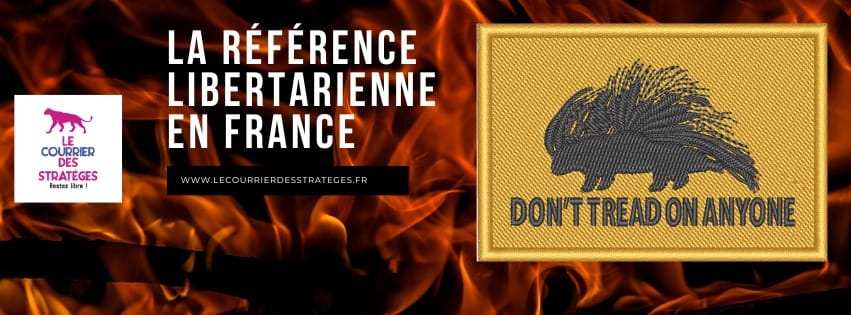
Les chiffres publiés par l’Insee jeudi 13 novembre dessinent un paysage social inquiétant. En 2024, 11,2 % des mineurs n’ont pas pu partir en vacances et près d’un million d’enfants cumulent au moins trois privations matérielles. Le réflexe immédiat sera d’exiger plus d’intervention étatique, plus de prestations sociales, plus de dispositifs d’aide.
Vacances, alimentation, logement : des privations révélatrices d’un système sous contrainte étatique
L'Insee est formelle : en 2024, plus d’un enfant sur dix n’a pas pu partir en vacances, et un sur trois subit au moins une privation matérielle. La "crise inflationniste" été le résultat direct d'une politique de planche à billets et d'une dette publique exponentielle, orchestrée par l'État et les banques centrales.
L’inflation est pourtant une taxe insidieuse, créée par les politiques monétaires accommodantes des banques centrales. En injectant des masses de liquidités dans l’économie pour financer les déficits publics, elles ont dévalué la monnaie et rogné le pouvoir d’achat des ménages.
Les plus fragiles, ceux qui n’ont pas d’actifs pour se protéger, en sont les premières victimes. Le budget « loisirs » et « vacances » est le premier sacrifié sur l’autel de cette mauvaise gestion.
L'État, en vivant systématiquement au-dessus de ses moyens, a déclenché la crise qu’il prétend aujourd’hui combattre.
L'interventionnisme contre les besoins essentiels
L'étude de l'INSEE met en lumière une précarité matérielle croissante : manque de vêtements neufs (6,2%), chaussures de rechange (3,1%), et même une difficulté à se procurer une alimentation équilibrée. De même, 11% des mineurs vivent dans des foyers contraints de choisir entre se chauffer et payer les factures.
Le problème est systémique. Un marché libre permet, par la concurrence et la productivité, d'abaisser les prix réels des biens de consommation. Or, en France, l'État impose un fardeau réglementaire, fiscal et parafiscal considérable sur la production, le logement et l'énergie. Chaque nouvelle norme, chaque taxe prélevée pour financer les dépenses sociales se répercute in fine sur le coût de la vie.
Les privations matérielles ne sont pas la preuve de l'échec du marché, mais de l'échec de la bureaucratie à laisser le marché fonctionner. Si les prix de l'énergie et des denrées alimentaires sont hors de portée pour certaines familles, c'est que la production est alourdie par des impôts et des réglementations complexes, ce qui entrave la création de richesse et de solutions abordables.

Le mythe de l'action collective face à la responsabilité individuelle
Selon l'INSEE, près d'un million d'enfants cumulent plusieurs privations, dont l'impossibilité de participer à des activités extrascolaires ou de recevoir des amis. Il est tentant d'appeler l'État à intervenir davantage pour "réparer" cette situation. Cependant, une perspective libertarienne rejette l'idée qu'un problème d'ordre économique et individuel doive être résolu par une action collective coercitive.
L'Insee pointe des écarts importants selon le profil familial, notamment les familles monoparentales (16,3 % de privations cumulées contre 6,9 %). Ces statistiques révèlent des défis propres à l'organisation familiale et aux choix de vie, qui relèvent de la responsabilité individuelle et de la solidarité volontaire (associations, mécénat privé), et non d'une redistribution forcée et inefficace pilotée par l'État.
Accuser la "main invisible" du marché de ces privations revient à ignorer la "main lourde" de l'État qui entrave les mécanismes de création de richesse et d'accessibilité.
La véritable solution ne réside donc pas dans l’aggravation d’un système défaillant, mais dans son démantèlement. Il faut alléger massivement la fiscalité qui pèse sur les salaires et la consommation pour redonner du souffle au pouvoir d’achat des ménages.
Il faut libérer le marché du travail des entraves réglementaires qui freinent l'embauche et l'initiative individuelle. Il faut cesser de considérer les familles comme des assistés potentiels, mais comme les premiers acteurs de leur propre prospérité. La charité volontaire et les réseaux de proximité sont bien plus à même d’apporter une aide ciblée et humaine qu’une administration anonyme.