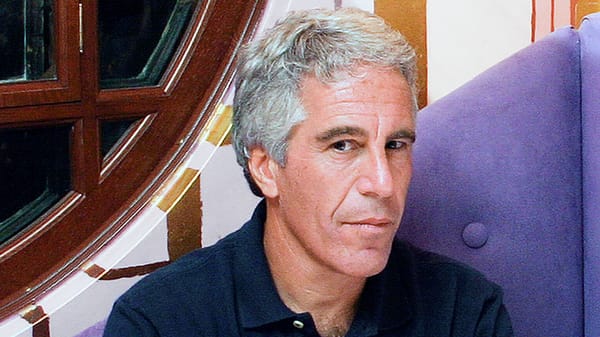1 538 832 élèves étudiaient le français au lycée général dans l'Union européenne en 2022, selon les données d'Eurostat. L'Espagne comptait le plus d'apprenants avec 261 381 élèves, suivie par l'Allemagne (260 262), la Roumanie (244 704), l'Italie (194 135) et la Belgique (130 807). Le français arrive derrière l'espagnol qui comptait un peu plus de 2 millions d'apprenants, soit 27 % des lycées de l'Union européenne. L'anglais demeure indétrônable avec plus de 90% des lycées de filière générale étudiant cette langue. C'est l'occasion de rappeler le recul de l'influence française en Europe depuis la signature du Traité de Rome.

Lors de la fondation de la Communauté Économique Européenne (CEE) en 1957, la France occupait une position centrale, voire hégémonique. Le projet européen était largement conçu par des personnalités françaises (Jean Monnet, Robert Schuman), son architecture institutionnelle s'inspirait du modèle administratif français, et le français s'imposait comme la langue de travail exclusive. Six décennies plus tard, le paysage a radicalement changé. La France évolue désormais dans une Union élargie où son poids politique est dilué, son modèle économique concurrencé et sa langue marginalisée.
I. La dilution géopolitique et la perte de centralité
Le passage d'une Europe des 6 à une Union des 27 a mécaniquement réduit le poids relatif de la France et modifié les équilibres internes, mettant fin à la centralité française.
- L'impact des élargissements : chaque vague d'adhésion a introduit de nouvelles dynamiques. L'entrée du Royaume-Uni (1973) a introduit un contrepoids majeur, porteur d'une vision plus atlantiste et libre-échangiste. L'élargissement massif à l'Est (2004-2007) a déplacé le centre de gravité de l'Union. Ces nouveaux membres, souvent plus libéraux économiquement et tournés vers les États-Unis pour leur sécurité, sont moins sensibles aux thèses traditionnelles françaises, comme celle de "l'Europe puissance".
- Le déséquilibre du moteur franco-allemand : la réunification de l'Allemagne (1990) a consolidé sa position de première puissance démographique et économique du continent. Le couple franco-allemand, moteur historique de l'intégration, s'est déséquilibré au profit de Berlin, dont l'influence s'est accrue grâce à ses liens étroits avec l'Europe centrale et orientale.
- Perte de crédibilité politique : des événements comme le rejet par la France du Traité Constitutionnel Européen en 2005 ont durablement entamé sa crédibilité comme force motrice du projet. Dans une Europe élargie, la capacité de la France à dicter l'agenda s'est réduite face à l'émergence de coalitions régionales (Groupe de Visegrád, Ligue Hanséatique).
II. Le recul du modèle économique français face au paradigme libéral
L'influence française s'est également érodée sur le plan idéologique. Le modèle initial de la CEE, marqué par le dirigisme à la française (incarné par la Politique Agricole Commune ou les grands projets industriels), a progressivement cédé le pas à une vision centrée sur le marché et la concurrence.
- Le triomphe de la concurrence : l'Acte Unique (1986) et le Traité de Maastricht (1992), bien que portés par des Français comme Jacques Delors, ont consacré la primauté du marché unique et de la libre concurrence. Cette orientation, poussée initialement par le Royaume-Uni et soutenue par les pays du Nord, s'est imposée comme la doctrine dominante.
- La marginalisation du "colbertisme" : le modèle français, basé sur les services publics, un État stratège et une politique industrielle interventionniste, s'est retrouvé constamment sur la défensive face aux règles européennes limitant les aides d'État et favorisant la dérégulation.
- Divergence économique : les difficultés économiques chroniques de la France (déficits, désindustrialisation, faible croissance) par rapport à l'Allemagne et aux pays dits "frugaux" ont affaibli sa capacité à peser sur la gouvernance de la zone euro.
III. L'effondrement linguistique et la perte d'influence conceptuelle
Le symptôme le plus visible de ce déclin est la marginalisation de la langue française, qui entraîne une perte d'influence culturelle et normative.
- De l'hégémonie francophone au "Globish" : si le français dominait sans partage jusqu'aux années 1980, les élargissements successifs, en particulier à l'Est où l'anglais était déjà la première langue étrangère, ont imposé l'anglais comme lingua franca par pragmatisme. Aujourd'hui, plus de 85 % des documents originaux de la Commission sont rédigés en anglais. Le français est devenu une langue de traduction plutôt qu'une langue de conception.
- L'érosion de l'influence normative : la langue n'est pas neutre ; elle véhicule une vision du monde et un cadre juridique. Lorsque les textes européens sont pensés et négociés en anglais, ce sont les concepts et les normes anglo-saxonnes qui prévalent (ex: compliance). L'influence de la tradition juridique continentale (droit civil), dont la France est un pilier, s'est réduite au profit d'une approche inspirée de la Common Law.
Depuis 1957, l'Europe a changé de taille, de langue et de modèle économique. La France, qui avait initialement façonné l'Europe à son image, se retrouve aujourd'hui dans une Union où ses vecteurs traditionnels d'influence sont affaiblis. Ce déclin relatif est le résultat combiné d'une dilution mécanique due aux élargissements et d'un changement de paradigme idéologique et linguistique qui s'est éloigné du modèle français.