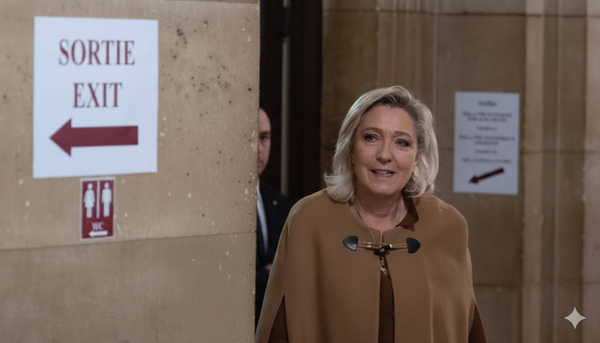Avec son projet pharaonique de salle de bal financée par les géants de la tech, Donald Trump poursuit sa mue de la fonction présidentielle : moins chef d’État que PDG de l’Amérique. Son modèle ? Un pouvoir privatisé et sponsorisé .

Sous couvert de patriotisme économique et de modernisation, Donald Trump fait glisser la Maison-Blanche vers une logique d’entreprise privée où l’accès, la loyauté et le financement remplacent l’intérêt général.
Un bal à 200 millions : la privatisation symbolique du pouvoir
Le 15 octobre dernier, le président a convié les géants de la tech à dîner à la Maison-Blanche pour financer son dernier caprice architectural : une salle de bal monumentale de 8.000 m², inspirée de Mar-a-Lago.
Officiellement, il s’agit de « moderniser » la résidence présidentielle. Officieusement, le projet est financé en partie par les contributions de dirigeants d’Amazon, Google, Microsoft, Meta ou Palantir.
Bien que le financement soit officiellement "privé", l'acte d'amasser 200 millions de dollars auprès d'entreprises de la tech juste après un dîner avec le président est une évidence de l'achat d'influence.
Trump, tout sourire, aurait lancé :
« Certains d’entre vous ont été vraiment, vraiment généreux ».
Une phrase anodine, mais lourde de sens : l'administration Trump se transforme en club privé, où la générosité s’achète en influence.
Richard W. Painter, ex-conseiller de la Maison-Blanche, résume l’enjeu :
« On paie pour avoir accès, pas seulement aux jardins de la Maison-Blanche, mais au président lui-même ».
Autrement dit : bienvenue dans la politique à guichet payant.

Trump, le PDG de l’État : esthétique du pouvoir et clientélisme assumé
Le projet de salle de bal s’ajoute à une série de transformations symboliques — drapeau géant, décorations dorées, Rose Garden remodelé — qui traduisent une conception très personnelle du pouvoir.
Chez Trump, la présidence devient branding, et la Maison-Blanche, un produit de luxe estampillé « Trump Organization ».
Cette confusion entre l’État et l’entreprise illustre un glissement inquiétant : le pouvoir exécutif fonctionne désormais selon les règles du marché, où l’influence se mesure à la taille du chèque.
Derrière la façade dorée, c’est la dérive d’un capitalisme politique : celui qui confond liberté d’entreprendre et droit d’acheter l’État.
Pour rappel, en septembre dernier, Donald Trump a signé un décret imposant l’augmentation des frais de dossier du visa H-1B à 100.000 dollars. Une somme astronomique pour un permis de travail pourtant essentiel aux ingénieurs, chercheurs et programmeurs étrangers travaillant chez les géants de la tech US.
Officiellement, la mesure viserait à « protéger les travailleurs américains » et à « réduire la dépendance aux talents étrangers ». En réalité, elle transforme l’immigration de compétences en luxe fiscal réservé aux multinationales capables d’en absorber le coût.
Ces deux facettes de la politique de Trump, l'interventionnisme rigide sur le marché du travail et le "capitalisme de connivence"pour ses projets personnels, convergent vers la même triste conclusion : l'administration Trump, malgré son discours pro-business, est anti-libérale.