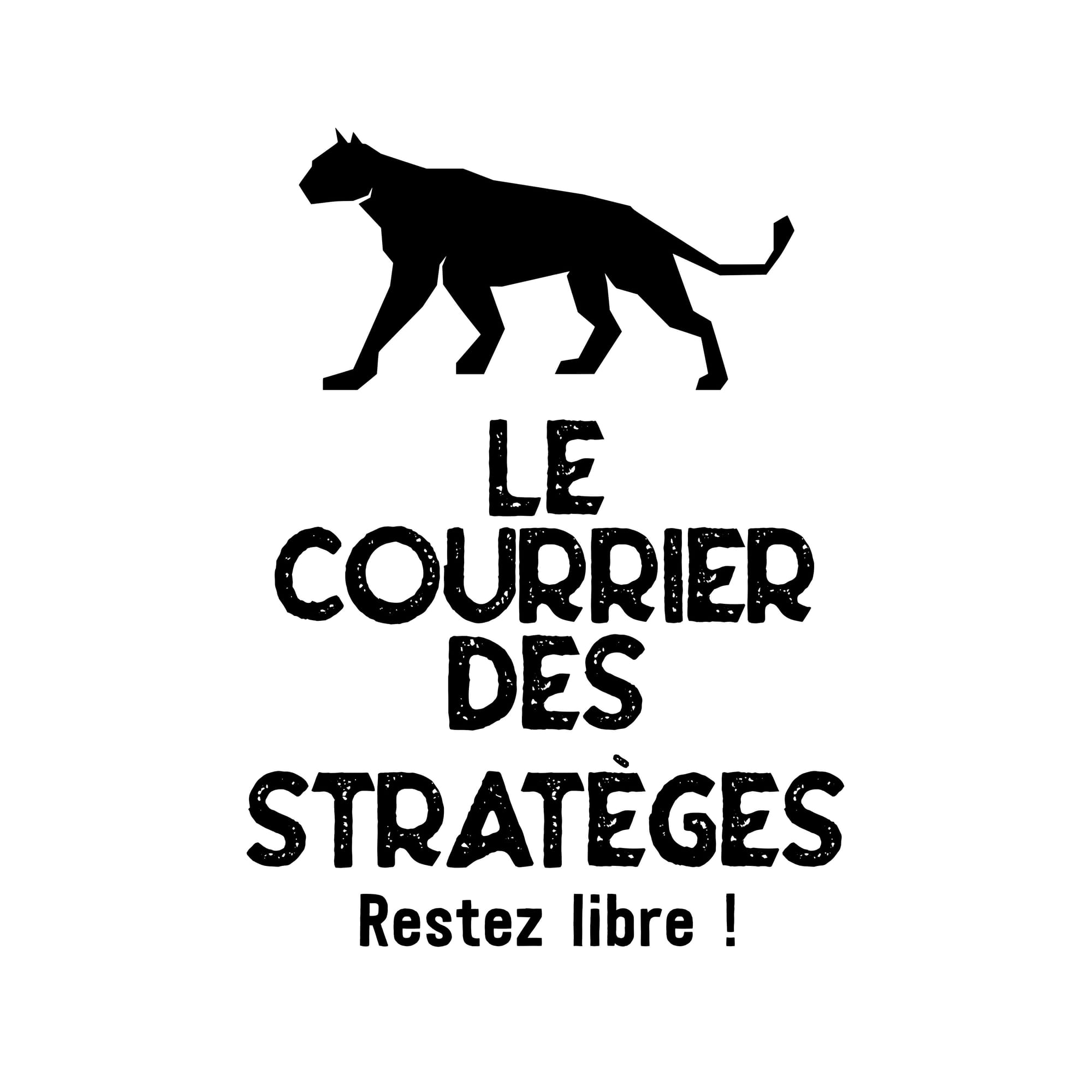Trump a officiellement lancé la CIA sur les traces de Maduro, au Venezuela. C'est l'occasion de donner une perspective historique aux opérations secrètes qui défraient tant la chronique de l'imperium américain depuis des années.

Trump vient de confirmer publiquement avoir autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela, une annonce inhabituelle pour des actions covert, marquant une escalade significative. Cette autorisation, donnée via un "presidential finding" secret, permet à la CIA d'effectuer des opérations potentiellement meurtrières au Venezuela et dans les Caraïbes, visant Maduro et son gouvernement, soit de manière autonome, soit en soutien à des actions militaires plus larges.
Les raisons invoquées incluent des accusations contre Maduro d'être un "narcoterroriste" qui tirerait profit du trafic de drogue, de contrôler le gang Tren de Aragua (désigné comme organisation terroriste par les États-Unis), et de "vider les prisons" vénézuéliennes pour envoyer des criminels aux États-Unis.
Trump a mis fin aux négociations diplomatiques avec Maduro début octobre 2025, et offre 50 millions de dollars pour des informations menant à son arrestation. Cette stratégie, élaborée avec le secrétaire d'État Marco Rubio et le directeur de la CIA John Ratcliffe, vise à forcer Maduro à quitter le pouvoir.
Demain, vous retrouverez dans les colonnes du Courrier, pour les abonnés :
- Pourquoi les épargnants doivent quitter la France ?
- Emigrer en Italie : la taxation du capital sous Meloni...
- Comment acheter de l'argent-métal : un guide pratique
- La fiscalité de l'argent-métal
En parallèle, les États-Unis préparent des options militaires, incluant des frappes potentielles à l'intérieur du Venezuela, avec un déploiement de 10 000 troupes en Porto Rico, des navires de guerre et un sous-marin dans les Caraïbes. Trump a indiqué que les États-Unis contrôlent la mer et envisagent désormais des actions terrestres.
Ces méthodes de cow-boy pleinement assumées posent une fois de plus la question du rôle de la CIA dans l'imperium américain. Instrument privilégié d'intervention directe à l'étranger, la CIA voit son rôle évoluer avec Donald Trump. Mais, contrairement à ce que croit le public français, ces opérations sont tout sauf laissées au hasard. A la différence des opérations menées par les services français, elles sont même très encadrées.
Voici une brève histoire des opérations secrètes de la CIA.
Les covert actions, de quoi s'agit-il ?
L'action clandestine (covert action), conçue comme la "troisième option" de la politique étrangère américaine, se situe dans l'espace stratégique ambigu entre la diplomatie traditionnelle et la guerre ouverte. Cet instrument de puissance, manié principalement par la Central Intelligence Agency (CIA), permet à l'exécutif américain d'influencer les événements mondiaux sans en assumer publiquement la responsabilité, préservant ainsi une marge de manœuvre politique et diplomatique.
Sa doctrine, loin d'être un corpus statique, a connu des transformations profondes, dictées par les impératifs géopolitiques successifs et les crises politiques internes qui ont secoué les États-Unis. Des jungles du Guatemala aux montagnes d'Afghanistan, la nature, les objectifs et le cadre juridique de l'action clandestine ont été constamment redéfinis.

Dans cette perspective, la politique de l'administration Trump à l'égard du Venezuela ne constitue pas une simple continuation de cette histoire, mais une rupture doctrinale significative. Cette rupture se caractérise par trois éléments fondamentaux : l'abandon délibéré du principe cardinal de "déni plausible" au profit d'une coercition publique ; la fusion des logiques de contre-narcotiques et de contre-terrorisme pour créer un nouveau prétexte juridique à l'usage de la force ; et une privatisation chaotique de l'action de l'État qui a brouillé les frontières entre les opérations officielles, les initiatives privées et les aventures mercenaires.
La doctrine de l'action clandestine : le titre 50
Pour comprendre l'évolution et les ruptures de la doctrine des opérations clandestines, il est impératif de commencer par ses fondations conceptuelles et légales. Loin d'être une licence pour des actions arbitraires, l'action clandestine est une pratique définie et encadrée par le droit américain, dont les contours ont été façonnés par des décennies de lutte de pouvoir entre le Congrès et l'Exécutif. Cette section établit ce cadre, qui est la référence à l'aune de laquelle les pratiques ultérieures doivent être jugées.
La doctrine moderne de l'action clandestine est ancrée dans une série de lois qui en définissent la nature, les conditions d'autorisation et les mécanismes de contrôle.
Définition juridique
Le fondement légal de l'action clandestine se trouve dans le Titre 50 du Code des États-Unis, qui régit le renseignement et la sécurité nationale. La section 3093(e) définit une covert action comme "une activité ou des activités du gouvernement des États-Unis visant à influencer les conditions politiques, économiques ou militaires à l'étranger, où il est prévu que le rôle du gouvernement des États-Unis ne sera pas apparent ou reconnu publiquement".
Cette définition est cruciale non seulement pour ce qu'elle inclut, mais aussi pour ce qu'elle exclut explicitement. Ne sont pas considérées comme des actions clandestines : les activités de collecte de renseignement, le contre-espionnage traditionnel, les activités diplomatiques ou militaires traditionnelles, et les activités traditionnelles d'application de la loi. Cette distinction est fondamentale car elle sépare les opérations d'influence secrètes des autres fonctions de l'État, chacune étant soumise à des régimes d'autorisation et de supervision différents.
L'autorisation présidentielle (Presidential Finding)
Le pivot du contrôle légal est l'exigence d'une autorisation présidentielle formelle. Le Président ne peut autoriser une action clandestine que s'il détermine, par écrit, qu'elle est "nécessaire pour soutenir des objectifs de politique étrangère identifiables des États-Unis et qu'elle est importante pour la sécurité nationale". Ce document, connu sous le nom de Presidential Finding ou de Memorandum of Notification (MON), doit être signé par le Président avant que l'opération ne soit lancée et que les fonds ne soient dépensés.
Cette exigence est l'héritage direct de l'amendement Hughes-Ryan de 1974, une législation post-Watergate conçue pour mettre fin à la pratique de la "déniabilité plausible" (plausible deniability) pour le Président lui-même. Avant 1974, la Maison Blanche pouvait nier avoir connaissance des opérations de la CIA, attribuant la responsabilité à l'agence. L'amendement Hughes-Ryan a rendu le Président directement et légalement responsable de chaque opération, éliminant toute ambiguïté sur la chaîne de commandement.
La supervision parlementaire
Une fois qu'un Finding est signé, l'Exécutif a l'obligation légale d'en informer le Congrès. La loi stipule que les comités de renseignement de la Chambre des représentants (HPSCI) et du Sénat (SSCI) doivent être tenus "pleinement et actuellement informés" de toutes les actions clandestines. En principe, cette notification doit avoir lieu avant le début de l'opération.
Cependant, la loi prévoit une exception pour des "circonstances extraordinaires affectant les intérêts vitaux des États-Unis". Dans de tels cas, le Président peut limiter la notification préalable à un groupe restreint de huit leaders du Congrès : le Président et le chef de la minorité de la Chambre, le chef de la majorité et de la minorité du Sénat, et les présidents et membres de rang de l'HPSCI et du SSCI, un groupe informellement connu sous le nom de "Gang of Eight". Même dans ce cas, le Président doit informer les comités complets "en temps opportun" (in a timely fashion). La définition de ce "temps opportun" a été une source de friction constante entre la Maison Blanche et le Capitole, les présidents ayant parfois attendu des jours, voire des semaines, avant de notifier le Congrès, au grand dam des législateurs.
Interdictions spécifiques
Enfin, le cadre juridique impose une limite absolue : "Aucune action clandestine ne peut être menée dans le but d'influencer les processus politiques, l'opinion publique, les politiques ou les médias des États-Unis". Cette disposition vise à empêcher que les outils de la guerre secrète à l'étranger ne soient retournés contre le processus démocratique américain.
Ce cadre juridique n'est pas une construction théorique, mais le produit d'un conflit institutionnel permanent. Il est le résultat d'une lutte de pouvoir continue entre un Congrès cherchant à exercer son pouvoir de contrôle et de financement, et un Exécutif cherchant à préserver sa prérogative en matière de politique étrangère et de sécurité nationale. L'ère pré-1974 était caractérisée par ce que certains ont appelé une "négligence bienveillante" de la part du Congrès, qui préférait ne pas savoir pour ne pas avoir à assumer de responsabilités.
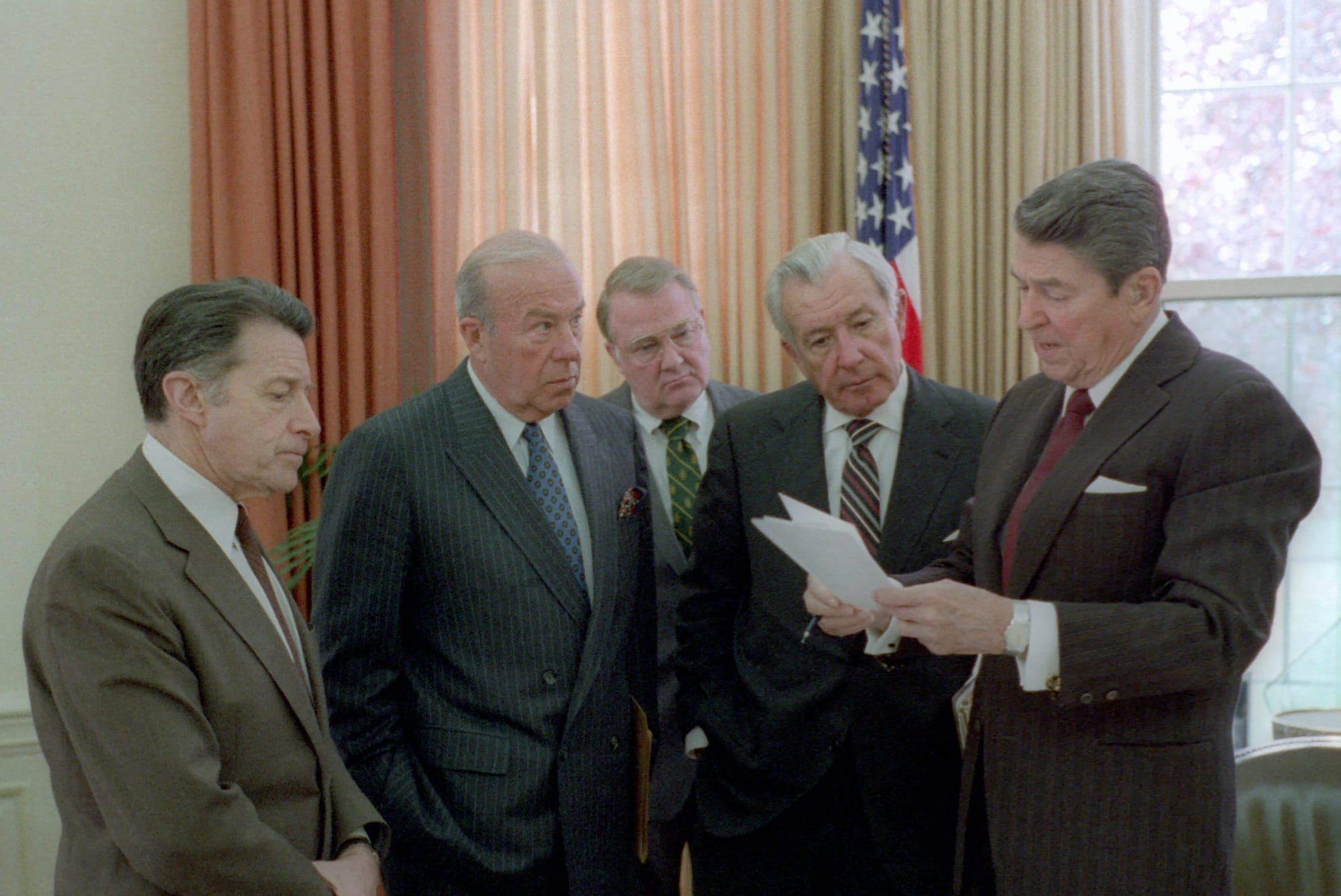
Les révélations explosives des années 1970 sur les opérations de la CIA au Chili, les complots d'assassinat (les "family jewels") et le scandale du Watergate ont créé une crise de confiance profonde, forçant le Congrès à agir. L'amendement Hughes-Ryan a été la première étape, imposant le Presidential Finding. Plus tard, lorsque l'administration Reagan a utilisé des tierces parties et des financements secrets pour contourner les interdictions du Congrès dans l'affaire Iran-Contra, le Congrès a de nouveau réagi en renforçant les exigences de notification dans l'Intelligence Oversight Act de 1980 et l'Intelligence Authorization Act de 1991. Chaque loi est ainsi une cicatrice laissée par un scandale, un rappel que la doctrine légale est constamment contestée et redéfinie par la pratique et la confrontation politique.
Modalités opérationnelles et logique stratégique
Au-delà du cadre légal, la doctrine de l'action clandestine repose sur des principes opérationnels et une logique stratégique qui en définissent l'utilité en tant qu'instrument de politique étrangère.
Le cœur de la doctrine est le concept de "déni plausible". L'objectif n'est pas seulement de mener une opération en secret, mais de la planifier et de l'exécuter "de manière à dissimuler l'identité du commanditaire ou à permettre un déni plausible de sa part". Cela signifie que même si l'opération est découverte, il ne doit y avoir aucune preuve irréfutable liant l'action au gouvernement américain. Ce principe distingue fondamentalement une opération covert (clandestine quant au commanditaire) d'une opération clandestine (clandestine quant à l'action elle-même). Une opération des forces spéciales militaires peut être clandestine – menée en secret pour préserver l'effet de surprise – mais elle est généralement reconnue par les États-Unis après coup, comme le raid contre Oussama ben Laden. Une action clandestine, en revanche, est conçue pour être désavouée si elle est exposée. Ce déni permet au gouvernement américain d'atteindre ses objectifs sans en assumer les coûts diplomatiques, politiques ou de réputation.
Typologie des opérations
Les actions clandestines sont menées par la Direction des Opérations de la CIA, et plus spécifiquement par son unité d'élite, le Special Activities Center (SAC). Elles couvrent un large spectre d'activités, qui peuvent être regroupées en trois catégories principales :
- Action politique et influence : c'est la forme la plus courante d'action clandestine. Elle inclut le soutien financier secret à des partis politiques ou à des candidats, la diffusion de propagande (dite "noire" lorsqu'elle est faussement attribuée à un autre acteur, ou "grise" lorsque son origine est ambiguë), la désinformation, la manipulation des médias étrangers, et la subversion d'agents d'influence (journalistes, fonctionnaires, leaders syndicaux) pour orienter les décisions politiques dans un sens favorable aux intérêts américains.
- Guerre économique : moins fréquente, cette catégorie comprend des actions visant à déstabiliser l'économie d'un pays hostile, par le sabotage d'infrastructures clés ou la manipulation des marchés.
- Opérations paramilitaires : ce sont les actions les plus risquées et les plus controversées. Elles englobent la formation, le financement, l'armement et parfois la direction de forces insurgées ou de guérillas pour renverser un gouvernement ou déstabiliser un régime. Elles peuvent également inclure des actions directes comme des raids, des sabotages, des démolitions et, dans les cas les plus extrêmes, des assassinats ciblés.
La "Troisième Option"
Le nom non officiel du SAC, "Tertia Optio" (la troisième option), résume parfaitement la logique stratégique de l'action clandestine. Elle est conçue comme une alternative lorsque la diplomatie s'avère inefficace ou insuffisante, et qu'une intervention militaire ouverte est jugée trop coûteuse, trop risquée politiquement, ou susceptible de déclencher une guerre plus large. Elle offre au Président et au Conseil de Sécurité Nationale (NSC) une gamme d'options graduées pour poursuivre les intérêts américains dans des environnements complexes et hostiles, avec un risque et une visibilité contrôlés.
Cependant, la distinction juridique claire entre les opérations d'influence secrètes de la CIA (régies par le Titre 50) et les activités militaires du Département de la Défense (DOD) (régies par le Titre 10) masque une zone grise que l'Exécutif a souvent exploitée. Alors que le Titre 50 impose un Presidential Finding et une supervision stricte par les comités de renseignement, le Titre 10 a des exigences de notification différentes, relevant des comités des forces armées, qui peuvent être perçues comme moins contraignantes.

La frontière entre une "activité militaire traditionnelle" menée discrètement et une opération d'influence politique est souvent floue. Par exemple, une opération des Forces Spéciales visant à "préparer l'environnement de combat" en formant des forces locales peut avoir des effets politiques identiques à une opération paramilitaire de la CIA. Après le 11 septembre, l'intégration croissante des opérations de la CIA et des Forces Spéciales a exacerbé ce flou, créant des défis de supervision pour le Congrès. Cette ambiguïté offre à l'Exécutif la possibilité de choisir le cadre juridique qui lui semble le plus avantageux, lui permettant potentiellement de contourner les contraintes les plus strictes associées aux actions clandestines de la CIA.
Évolution de l'action clandestine, de la Guerre Froide à la guerre contre le terrorisme
La doctrine de l'action clandestine, bien que fondée sur des principes juridiques et opérationnels constants, n'a jamais été appliquée dans un vide. Sa pratique a été profondément façonnée par le contexte géopolitique. Comment cette doctrine s'est-elle adaptée et transformée à travers deux époques radicalement différentes : la Guerre Froide, où elle était un instrument de compétition entre superpuissances, et l'ère post-11 Septembre, où elle est devenue l'arme principale d'une guerre mondiale contre des réseaux non-étatiques ?
La naissance de l'action clandestine est indissociable de l'aube de la Guerre Froide. Face à la perception d'une "guerre psychologique" et d'une subversion menées par l'Union Soviétique, l'administration Truman a cherché des moyens de riposter sans déclencher un conflit militaire direct. La directive NSC 4-A de décembre 1947 a autorisé les premières opérations de guerre psychologique, suivie par la directive NSC 10/2 de juin 1948, qui a élargi le mandat de la CIA pour inclure un éventail plus large d'activités : "propagande, guerre économique, action directe préventive, y compris le sabotage... la subversion contre les États hostiles, y compris l'aide aux mouvements de résistance clandestins, aux guérillas".
Ces opérations sont devenues l'outil privilégié pour mettre en œuvre les deux grandes stratégies américaines de l'époque : le containment (endiguer l'expansion de l'influence communiste), tel que formulé par George F. Kennan, et le rollback (refouler activement le communisme et renverser les régimes alliés à Moscou), une approche plus agressive prônée par des figures comme John Foster Dulles.
Les "succès" fondateurs
Deux opérations au début des années 1950 ont cimenté la place de l'action clandestine dans l'arsenal de la politique étrangère américaine et ont façonné la perception de son efficacité pour des décennies.