L'examen du Projet de loi de finances (PLF) pour 2026 s'est ouvert dans un climat parlementaire d'une complexité rare, marqué par une succession d'événements qui redéfinissent en profondeur les rapports de force entre l'exécutif et le législatif. La trajectoire de ce texte budgétaire est d'ores et déjà singulière et conditionne la nature même des débats en séance publique.
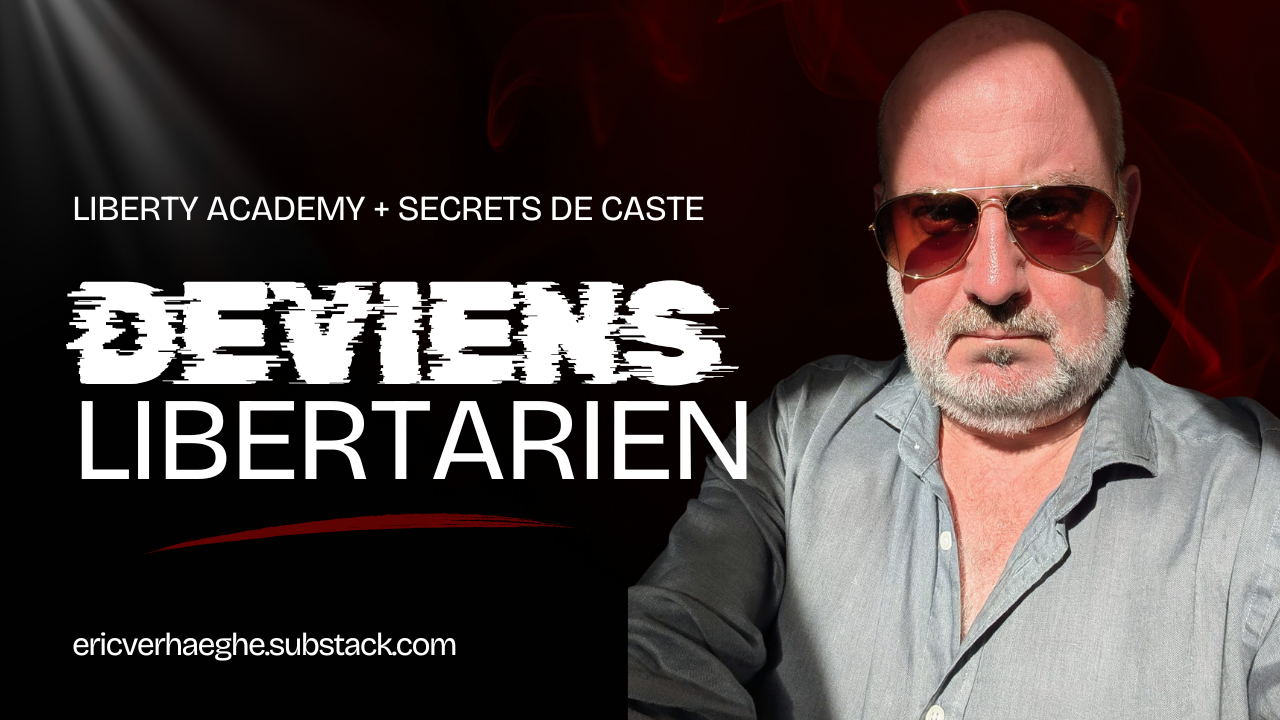
Le point de départ : le rejet en Commission des finances
Le premier acte de cette séquence s'est joué en Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Au terme de trois jours d'examen intense, du 20 au 23 octobre 2025, la première partie du PLF 2026, consacrée aux recettes, a été massivement rejetée par 37 voix contre 11. Ce vote a cristallisé une opposition quasi unanime, rassemblant l'ensemble des groupes parlementaires à l'exception du groupe présidentiel. Le Rapporteur général, M. Philippe Juvin (Droite républicaine), a justifié cette position en dénonçant une « perte de crédibilité budgétaire » et un équilibre jugé « intenable à court terme ». Ce rejet n'est pas un simple incident de parcours ; il constitue un acte politique fort, signifiant une défiance collective envers la trajectoire budgétaire proposée par le Gouvernement.
La conséquence procédurale : le retour au texte initial du Gouvernement
Conformément à l'article 42 de la Constitution, ce rejet en commission a une conséquence procédurale majeure : l'ensemble des travaux de la commission, y compris les nombreux amendements qui y avaient été adoptés, sont devenus caducs. Par conséquent, la discussion qui s'est ouverte en séance publique le 24 octobre 2025 ne s'est pas fondée sur un texte amendé et préparé par la commission, mais sur le texte original déposé par le Gouvernement (n° 1906) le 14 octobre 2025.

Cette situation a créé un paradoxe notable. Bien que juridiquement annulés, les amendements adoptés en commission n'ont pas disparu du paysage politique. Ils ont constitué une sorte de "répétition générale", révélant les lignes de fracture et les possibles points de convergence entre les différents groupes. Ces "amendements fantômes" ont formé un réservoir de propositions destinées à être redéposées et redébattues dans l'hémicycle, transformant ainsi la stratégie législative des oppositions et informant le Gouvernement des batailles à venir.
Le facteur politique déterminant : l'absence de recours à l'article 49.3
Le contexte politique a été rendu encore plus exceptionnel par la décision du Premier ministre, M. Sébastien Lecornu, de ne pas recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget sans vote. Dans un Parlement sans majorité absolue, cette décision contraint le Gouvernement à un exercice de négociation permanente pour construire des majorités d'idées, article par article et amendement par amendement.
La conjonction du rejet en commission et du non-recours au 49.3 a ainsi transformé le processus budgétaire en une "co-construction" législative contrainte. L'exécutif, privé de ses outils constitutionnels les plus puissants, est forcé de trouver des compromis et de céder du terrain pour faire avancer son texte. Chaque vote devient un test de sa capacité à forger des alliances de circonstance. Ce cadre explique comment des amendements portés par des oppositions, y compris les plus radicales, ont pu être adoptés dès la première journée de débat, le Gouvernement devant faire des concessions pour éviter l'effondrement de l'architecture générale de son budget.
Cette synthèse dresse la liste exhaustive et propose une analyse détaillée des amendements adoptés et rejetés lors de la séance publique du 24 octobre 2025, sur la base des scrutins publics officiels. Il convient de noter que le débat sur la première partie du PLF 2026 se poursuit, avec un vote solennel programmé pour le 4 novembre 2025. La présente analyse constitue donc un instantané de la première journée de discussion, une étape déjà riche d'enseignements sur les dynamiques à l'œuvre.
Liste des amendements adoptés et rejetés (séance du 24 octobre 2025)
La première journée d'examen en séance publique a été particulièrement dense, avec l'examen de l'article 2 du projet de loi, relatif à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Sur les 3 677 amendements déposés pour l'ensemble de cette première partie, plusieurs ont fait l'objet d'un scrutin public, révélant les premiers rapports de force dans l'hémicycle.
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des scrutins publics intervenus le 24 octobre 2025.
Scrutins publics sur la première partie du PLF 2026 (séance du 24 octobre 2025)
Source des données : Assemblée nationale, Scrutins publics de la 17e législature.
Analyse approfondie des amendements substantiels adoptés
L'adoption de trois scrutins majeurs lors de cette première séance modifie substantiellement la portée de l'article 2 et illustre la nouvelle donne parlementaire.
1. Pérennisation de la Contribution sur les Hauts Revenus (CDHR)
L'adoption de l'amendement n°1467, porté par Mme Claire Lejeune et le groupe La France Insoumise-Nouveau Front Populaire, constitue l'événement politique majeur de cette journée.
- Contenu et portée juridique : cet amendement vise à rendre permanente la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR), qui avait été introduite à titre temporaire par la loi de finances pour 2025. Ce dispositif assure une imposition minimale de 20% pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple.
- Justification et implications budgétaires : selon ses auteurs, le caractère temporaire de la CDHR a incité les contribuables concernés à des stratégies d'optimisation, notamment en reportant la réalisation de plus-values, ce qui a réduit son rendement. Alors que le Gouvernement escomptait 2 milliards d'euros de recettes, des études l'évaluent à seulement 1,2 milliard d'euros. La pérennisation de la mesure vise donc à mettre fin à ces comportements d'évitement fiscal, à sécuriser cette recette et à renforcer la progressivité de l'impôt dans un contexte d'inégalités croissantes.
- Analyse politique : L'adoption de cet amendement par 220 voix contre 108 est une défaite significative pour le Gouvernement. Le score indique qu'une large coalition, allant bien au-delà des seuls groupes de gauche, s'est formée pour soutenir cette mesure. Il s'agit d'une victoire idéologique pour les partisans d'une fiscalité plus redistributive et d'une brèche dans la ligne politique maintenue par l'exécutif depuis 2017, qui refusait toute augmentation de la pression fiscale sur les plus hauts revenus. Ce vote est la démonstration la plus tangible de la "co-construction" forcée et de la perte de contrôle du Gouvernement sur le narratif fiscal.








