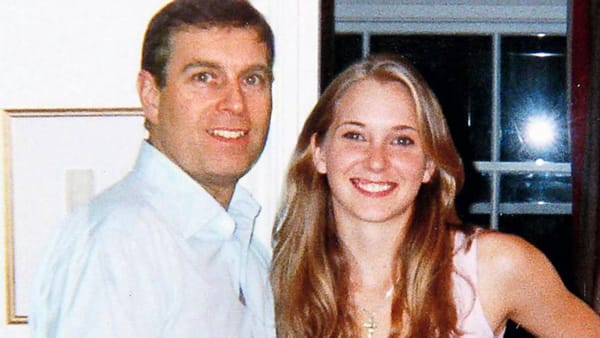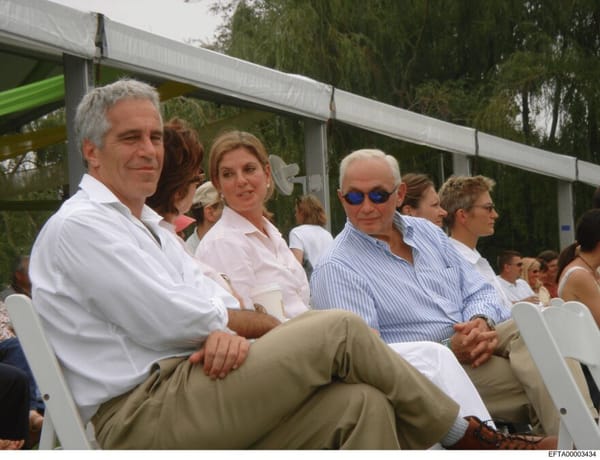Il fut un temps où la Suisse était une démocratie libérale. L'identité numérique vient pourtant d'y être adoptée par une votation. Voilà qui fait réfléchir aux risques du RIC...
Ce 28 septembre 2025, les citoyens suisses étaient appelés à trancher une question fondamentale pour l'avenir numérique du pays : l'adoption d'une nouvelle loi sur l'identité électronique (e-ID). Ce vote, rendu nécessaire par le lancement d'un référendum, est la deuxième tentative de l'État de mettre en place une "carte d'identité numérique" après l'échec d'un premier projet en 2021. À l'époque, le rejet avait été cinglant, motivé par la crainte de voir des entreprises privées gérer une infrastructure aussi sensible. Aujourd'hui, le gouvernement revient avec une copie corrigée, promettant une solution entièrement étatique.
Finalement, le "oui" l'a emporté par 50,4%.
Ce scrutin met en lumière un paradoxe fascinant au cœur de la démocratie directe. Le référendum, cet outil de souveraineté populaire souvent brandi par les partisans du Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) comme un rempart contre les dérives étatiques et corporatistes, ouvre la voie à la surveillance généralisée.
Une solution étatique pour rétablir la confiance
Le projet de loi soumis au vote se veut une réponse directe aux critiques de 2021. Le Conseil fédéral et le Parlement soutiennent que cette nouvelle e-ID, émise et gérée par la Confédération, offrirait toutes les garanties de sécurité et de protection des données. Gratuite et facultative, elle permettrait de simplifier la vie des citoyens en leur offrant un moyen sûr de prouver leur identité en ligne, que ce soit pour commander un document officiel ou pour justifier de leur âge lors d'un achat. Pour ses promoteurs, cette loi est une étape indispensable pour que la Suisse ne prenne pas de retard dans la transition numérique.
Le paradoxe du référendum : un outil à double tranchant
C'est ici que le paradoxe se noue. Les opposants, qui ont initié le référendum, craignent que le caractère "facultatif" de l'e-ID ne soit qu'une illusion temporaire et que son usage se généralise au point de devenir incontournable. Leur crainte est légitime : la loi prévoit que l'infrastructure étatique puisse être utilisée par des entreprises privées pour leurs propres moyens d'identification, comme une carte de membre. En Suisse, se prépare un vaste système de surveillance.
Ce faisant, même une e-ID gérée par l'État peut devenir la clé d'entrée d'un écosystème commercial, centralisant les interactions numériques des citoyens et créant une base de données d'une valeur inestimable pour le marketing ciblé. L'État, en voulant bien faire, devient le facilitateur d'un système qui nourrit le capitalisme de surveillance.
Le référendum, outil démocratique par excellence, place donc les citoyens devant un choix cornélien. S'ils rejettent la loi par méfiance envers l'État, ils laissent le champ libre aux géants de la tech qui, eux, n'ont pas besoin de l'aval populaire pour imposer leurs propres solutions d'identité numérique, souvent bien moins régulées. S'ils l'acceptent, ils consentent à la création d'une infrastructure centralisée qui, bien qu'étatique, pourrait être détournée pour servir des intérêts commerciaux.
On sait maintenant de quel côté la balance a penché. Ceci démontre que les outils comme le référendum, s'ils donnent le pouvoir au peuple, ne le protègent pas magiquement des choix complexes et des conséquences potentiellement indésirables de la modernité.