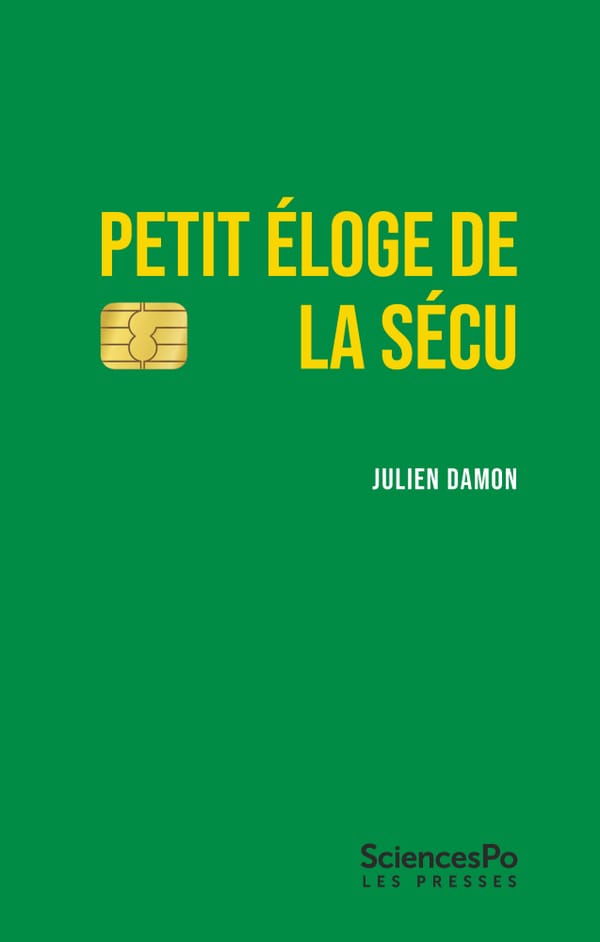Le budget 2026, qui comporte près de 400 pages (beaucoup trop pour être discuté correctement d'ici à la fin de l'année), permet provisoirement de repousser le spectre de la censure. Mais à quel prix ? Les étatistes de tous les partis devraient s'unir pour sauver artificiellement un régime à bout de souffle, qui a besoin d'air libre pour relancer le pays.

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026 se présente comme un exercice de responsabilité, une étape nécessaire sur le chemin escarpé du redressement des comptes publics. L'objectif affiché – maîtriser la dépense pour réduire un déficit abyssal – est, en surface, une ambition que peu de défenseurs de la discipline budgétaire pourraient critiquer. Pourtant, l'analyse des moyens employés révèle une stratégie qui, loin d'incarner une cure de rigueur courageuse et transparente, s'apparente à une "austérité furtive".
Du point de vue libertarien, si la réduction de la taille et du poids de l'État est un but louable, la méthode employée ici est profondément viciée et insuffisante. Elle repose sur l'illusion fiscale, la centralisation du pouvoir et une ingénierie sociale et économique qui trahit une méfiance fondamentale envers la liberté individuelle et l'autonomie des acteurs économiques. Ce budget n'est pas celui d'un État qui se retire, mais celui d'un État qui se reconfigure pour devenir plus opaque, plus interventionniste et, en définitive, plus puissant.
La taxation par l'invisible : le refus du débat démocratique
Le premier pilier de cette austérité furtive réside dans sa manière de générer des recettes. Plutôt que d'assumer une hausse d'impôt franche, qui forcerait un débat public sur le poids de l'État, le gouvernement privilégie des mécanismes insidieux. Le plus emblématique est le gel du barème de l'impôt sur le revenu. En apparence, il ne s'agit pas d'une augmentation. En réalité, dans un contexte d'inflation, même modérée (+1,3 % prévu pour 2026), c'est une hausse d'impôt déguisée et non consentie. Ce "traînage fiscal" fait mécaniquement basculer des contribuables dans des tranches supérieures ou les rend imposables, confisquant une partie de leur pouvoir d'achat sans qu'aucune loi n'ait explicitement validé cette ponction supplémentaire.
Pour un libertarien, l'impôt est une forme de coercition légale ; une taxation invisible est une tromperie qui mine le consentement à l'impôt et la transparence démocratique.
Cette même logique de complexification et d'opacité se retrouve dans la réforme de l'abattement fiscal pour les retraités. Remplacer un abattement proportionnel par un forfait est présenté comme une mesure de redistribution. En réalité, c'est une manœuvre complexe qui pénalise l'épargne et la prévoyance des classes moyennes et supérieures, tout en rendant le système fiscal encore plus illisible. Au lieu de simplifier et d'alléger, l'État choisit de micro-gérer les situations individuelles par des ajustements techniques, renforçant son rôle d'ingénieur social omniscient.
La création de nouvelles taxes ciblées, comme celle sur les holdings patrimoniales, procède du même esprit. Plutôt que de s'interroger sur le niveau global de prélèvement, l'État s'érige en juge de la "bonne" et de la "mauvaise" allocation du capital, pénalisant le "capital dormant". C'est une intrusion inacceptable dans les décisions privées de gestion de patrimoine, qui postule que les bureaucrates sauraient mieux que les individus comment utiliser leurs propres actifs.
Le jeu de bonneteau des dépenses : réallouer n'est pas réduire
Le second volet de la stratégie est une maîtrise des dépenses en trompe-l'œil. Le PLF 2026 se targue d'une baisse des crédits des ministères (hors missions prioritaires) et d'une rationalisation des opérateurs de l'État. Si la recherche d'efficience est toujours souhaitable, ces "économies" masquent une réalité plus inquiétante : il ne s'agit pas d'une réduction du périmètre de l'État, mais d'une réallocation massive de ses ressources vers ses fonctions les plus coercitives.

Les budgets sanctuarisés et massivement augmentés sont ceux de la Défense (+6,7 Md€), de l'Intérieur (+0,6 Md€) et de la Justice (+0,2 Md€). Ces secteurs, qui incarnent le monopole de la violence légitime, voient leurs effectifs et leurs moyens croître de manière spectaculaire. Pendant ce temps, les coupes s'opèrent sur des postes moins visibles : l'aide publique au développement, les budgets de fonctionnement des agences, certaines aides aux entreprises. Ce n'est pas un État qui se désengage, mais un État qui se recentre sur ses prérogatives régaliennes et sécuritaires. La réduction nette de 3 119 équivalents temps plein (ETP), toutes administrations confondues, est une goutte d'eau qui cache la création de milliers de postes dans les ministères de la force publique.
D'un point de vue libertarien, cette évolution est alarmante. Elle ne traduit pas une volonté de libérer la société civile du poids de l'administration, mais de renforcer les instruments de contrôle et de surveillance de cette même société. L'austérité ne sert pas à rendre le pouvoir aux individus, mais à le consolider au cœur de l'appareil d'État.
La centralisation rampante : l'érosion de l'autonomie locale
Peut-être l'aspect le plus dommageable de cette stratégie est-il son impact sur les collectivités territoriales. Présentées comme des partenaires de l'effort national, elles sont en réalité les victimes d'une recentralisation financière qui ne dit pas son nom. Le dispositif "DILICO 2" en est l'exemple parfait. Qualifié pudiquement de "lissage conjoncturel", il s'agit d'une "épargne forcée" de 2 milliards d'euros prélevée sur les collectivités jugées "trop" dynamiques. Pire encore, la restitution de ces fonds est conditionnée au respect d'une norme nationale d'évolution des dépenses. C'est un chantage institutionnalisé : l'État confisque les fruits de la bonne gestion locale pour ne les rendre qu'aux élus qui se conformeront à ses diktats budgétaires.
Cette attaque contre l'autonomie financière est complétée par la "rebudgétisation" de la fraction de TVA des régions. Une ressource fiscale dynamique, évoluant avec l'activité économique et offrant une prévisibilité, est remplacée par une dotation statique, gelée à son niveau de 2025 et dépendante du bon vouloir annuel du Parlement et du gouvernement. C'est un transfert de risque et de pouvoir de la périphérie vers le centre. L'État affaiblit l'autonomie des échelons locaux, les rendant plus dépendants des transferts nationaux et donc plus dociles. Pour une pensée qui valorise la subsidiarité et la gouvernance locale comme remparts contre l'arbitraire du pouvoir central, cette tendance est une régression majeure. Elle vide de sa substance le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Une vision dirigiste de l'économie
Enfin, derrière ces manœuvres budgétaires se cache une vision profondément dirigiste de l'économie. Le gouvernement ne se contente pas de fixer un cadre ; il cherche à orienter les comportements par un enchevêtrement complexe de taxes et d'aides. La suppression accélérée de la CVAE est, certes, une mesure bienvenue, car elle allège le fardeau des impôts de production qui pénalisent la compétitivité. Cependant, elle s'inscrit dans un tableau plus large où l'État, simultanément, proroge une surtaxe sur les grandes entreprises et invente une taxe sur les holdings.
Face aux dérives de l'étatisme qui vous "protège", armez-vous intellectuellement pour préparer un monde libre. Rejoignez la Liberty Academy : un programme d'un an qui va vous muscler le cerveau et vous libérer !
Ce n'est pas une politique de libération de l'économie, mais une politique de "fléchage" du capital. L'État décide quels investissements sont "productifs" (et donc méritent un allègement de la CVAE) et quels capitaux sont "dormants" (et donc doivent être taxés). Il choisit de pénaliser les plateformes de e-commerce extra-européennes via une taxe sur les petits colis, se posant en protecteur des acteurs nationaux. Il recentre les aides comme MaPrimeRénov' ou le Compte Personnel de Formation, substituant ses propres priorités aux choix des individus et des entreprises. Chaque mesure, prise isolément, peut se parer d'une justification technique. Mais leur somme dessine le portrait d'un État qui ne fait pas confiance au marché et à la liberté contractuelle pour allouer efficacement les ressources.
En conclusion, le Projet de Loi de Finances pour 2026, sous ses dehors de rigueur gestionnaire, est une occasion manquée. Une véritable consolidation budgétaire, d'inspiration libertarienne, aurait impliqué des choix clairs et courageux : une réduction transparente et massive du périmètre des interventions de l'État, une baisse généralisée des impôts pour tous plutôt qu'un maquis de taxes ciblées, et un renforcement de l'autonomie financière des individus et des collectivités. Au lieu de cela, le gouvernement a opté pour la facilité de l'opacité et de la complexité. L'"austérité furtive" n'est pas une cure de minceur pour l'État ; c'est un régime qui vise à le rendre plus musclé dans ses fonctions régaliennes, plus intelligent dans sa capacité à lever l'impôt sans le dire, et plus habile dans sa manière de contrôler les échelons inférieurs du pouvoir. C'est, en somme, une consolidation des comptes publics qui se fait au prix d'une consolidation du pouvoir de l'État lui-même.