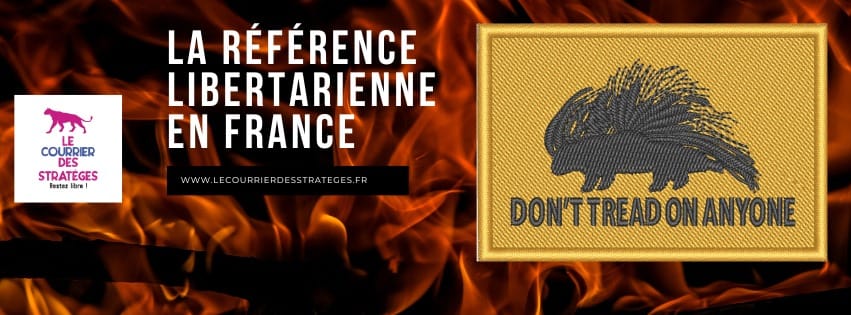La crise des semi-conducteurs refait surface, mais cette fois sans pandémie. Sous fond de tensions entre la Chine, l’Europe et les États-Unis, les constructeurs automobiles européens cherchent désespérément à éviter la paralysie. Une dépendance stratégique qui illustre les failles d’un continent désindustrialisé.

L'industrie automobile européenne se retrouve une nouvelle fois au bord de la rupture d'approvisionnement en semi-conducteurs. Cependant, la cause n'est plus la pandémie, mais une série d'actions étatiques unilatérales : le blocage des exportations par la Chine en riposte à la mise à l'écart d'un dirigeant de Nexperia par les Pays-Bas, encouragés par les États-Unis. Cette crise n'est pas un accident économique, mais la conséquence directe et prévisible de l'ingérence politique dans les affaires d'entreprises. Elle illustre, de manière cruelle, le coût de la dépendance et la dangerosité de subordonner le libre-échange aux caprices géopolitiques.
Le retour d’une crise, mais sans COVID
Trois ans après la crise du Covid, les chaînes de production automobile se retrouvent de nouveau menacées. Cette fois, ce n’est pas un virus, mais un blocus chinois.
Depuis octobre 2025, les usines du fabricant Nexperia, propriété du groupe chinois Wingtech, ont suspendu leurs exportations vers l’Europe. À l’origine du conflit : la décision des autorités néerlandaises d’écarter le dirigeant chinois Zhang Xuezheng de la direction de Nexperia, pour le remplacer par une personnalité indépendante.
Pékin a répliqué immédiatement en imposant un blocus des exportations de puces, paralysant ainsi une partie de la production automobile européenne.
L’analyste Patrick Hummel, de la banque suisse UBS, estime que Nexperia fournit près de 40 % des composants électroniques de base utilisés par les constructeurs. Une proportion colossale qui suffit à geler des lignes entières de production.
Les constructeurs à la manœuvre pour éviter le blackout
Face à cette tempête, les constructeurs tentent d’anticiper la pénurie.
Le patron de Volkswagen, Oliver Blume, a voulu se montrer rassurant sur Bild : « À court terme, nous sommes approvisionnés ». Mais même le géant allemand n’exclut pas d’éventuels arrêts temporaires si la situation s’aggrave.
Chez Valeo, la riposte est plus méthodique. L’équipementier français affirme avoir trouvé des puces de remplacement pour 95 % de ses composants. Un exploit logistique, mais fragile, car chaque nouveau fournisseur doit passer par un long processus de certification.
En revanche, Bosch se montre plus inquiet : sans assouplissement des restrictions d’exportation, « des ajustements temporaires de la production ne peuvent être exclus ». Autrement dit, le spectre des chaînes d’usine à l’arrêt plane à nouveau sur l’Europe industrielle.
Vers un appauvrissement généralisé
Le véritable danger de cette crise n'est pas la pénurie elle-même, mais la normalisation de l'usage de la force étatique pour dicter les règles du commerce international.
La réponse de certains, comme la mention par Volkswagen de la possibilité d'un programme de réduction du temps de travail soutenu par l'État (Kurzarbeit), est la cerise sur le gâteau de l'interventionnisme.
En cas de blocage de production causé par une crise géopolitique, l'État ne devrait pas se substituer aux ajustements naturels du marché. Utiliser l'argent public pour masquer les conséquences d'une crise qu'il a, au moins indirectement, contribué à créer, revient à socialiser les pertes des choix politiques.
Cette crise est un signal pour tous ceux qui croient aux bienfaits du libre-échange. L'industrie automobile européenne est l'otage des régulateurs et des tacticiens géopolitiques qui placent leurs calculs de pouvoir au-dessus du bien-être des consommateurs et de la stabilité des marchés.
Seul un retour à une stricte limitation de l'intervention étatique dans le commerce international pourra garantir la résilience et la prospérité à long terme de l'industrie.