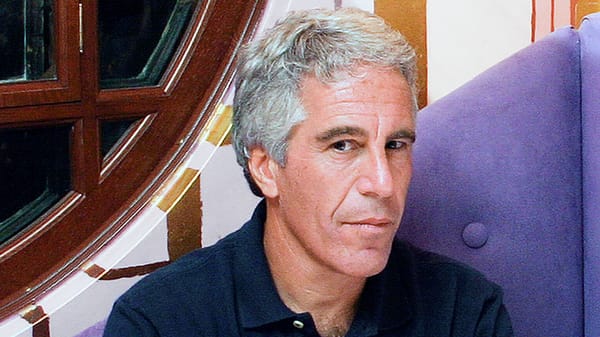Rejetée en commission, la taxe Zucman visait à imposer un impôt minimum de 2% aux ultra-riches. Mais derrière le discours de “justice fiscale”, cette mesure aurait surtout pénalisé l’investissement, la création d’entreprises et la compétitivité française.

L’Assemblée nationale a rejeté la fameuse “taxe Zucman”, une proposition défendue par les groupes de gauche et soutenue par l’économiste Gabriel Zucman. Présentée comme une mesure de “justice fiscale” pour faire contribuer davantage les grandes fortunes, cette taxe aurait imposé un impôt minimum de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, y compris les biens professionnels.
Mais sous couvert d’équité, cette mesure cache une logique profondément punitive et contre-productive. En ciblant les grandes fortunes, c’est tout l’écosystème entrepreneurial français qui risquait d’en payer le prix.
Rejet de la taxe Zucman
La première journée d’examen du budget 2026 par les députés de la commission des Finances de l’Assemblée s’est déroulée le lundi 20 octobre 2025. Les élus ont examiné plusieurs amendements. La taxe Zucman préconisée par l’économiste Gabriel Zucman en faisait partie. A l’issue d’un débat vif, cet impôt pour les riches a été finalement rejeté en commission. Cette décision a beaucoup déçu les quatre groupes de gauche qui ont défendu farouchement ce dispositif fiscal visant à faire payer aux contribuables les plus riches un impôt minimum de 2%.
La députée du groupe La France Insoumise (LFI), Mathilde Feld a déclaré que « c’est une taxe de justice fiscale (…) pour éviter que nos sociétés deviennent des sociétés totalement inégalitaires ». Mais le rapporteur général Philippe Juvin (LR) ne voit pas les choses de cet angle. Pour lui, la taxe Zucman est une sorte de « repoussoir pour les nouveaux entrepreneurs » qui envisagent de s’installer en France.
Selon Jean-Philippe Tanchy (RN), cette mesure risque de provoquer « une vague de désindustrialisation ». Notons que le parcours de la taxe Zucman n’est pas encore terminé. Même si elle a été rejetée en commission, elle pourrait encore être adoptée lors du débat dans l’hémicycle, en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu. L’économiste Zucman a déclaré sur X que supprimer définitivement ce dispositif signifie « défendre le droit des milliardaires à payer zéro ».
L’illusion de la “justice fiscale”
La gauche brandit le slogan de “justice fiscale”, mais il s’agit surtout d’un écran idéologique masquant l’échec de la dépense publique.
Les députés de gauche ont exprimé leurs désarrois face au rejet d’une série d’amendements visant les contribuables les plus fortunés. Les élus ont également supprimé la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales détenant au moins 5 millions d’euros d’actifs. « On a déjà compris. La taxe Zucman c’est non (…) l’impôt sur les grandes transmissions, c’est non. Le retour de l’ISF, c’est non », a déclaré François Ruffin du groupe écologiste.
La gauche a toutefois réussi à faire adopter « l’exil tax » permettant de lutter contre l’évasion fiscale des entrepreneurs et le retour de la contribution différentielle sur les hauts revenus qui vise à imposer au moins 20% de taxe foyers ayant des revenus excédant les 250.000 euros par an). Une coalition de la gauche a également obtenu la suppression de certaines « mesures clivantes » comme la taxation des indemnités journalières pour affection longue durée et la fin de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.
A partir de jeudi, la commission des Affaires sociales va examiner le projet de budget de la sécurité sociale. Notons que le gouvernement vise à réduire le déficit public « sous 5% » pour 2026. Il est disposé à réviser certaines dépenses et à faire des compromis pour réaliser des économies. Les députés travaillent sous pression actuellement, car ils sont tenus de respecter le délai constitutionnel pour l’adoption du budget. Si ce délai est dépassé, le gouvernement peut opter pour la voie par ordonnance.
Le vrai défi fiscal de la France n'est pas de trouver de nouvelles manières de taxer ceux qui créent de la richesse, mais de maîtriser la dépense publique et de réduire le fardeau fiscal global qui étouffe les ménages et les entreprises.
Ce rejet n'est pas un manque de justice ; c'est un acte de saine prudence économique.Le rejet de la taxe Zucman n’est pas une défaite de la “justice fiscale”, mais une victoire du bon sens.