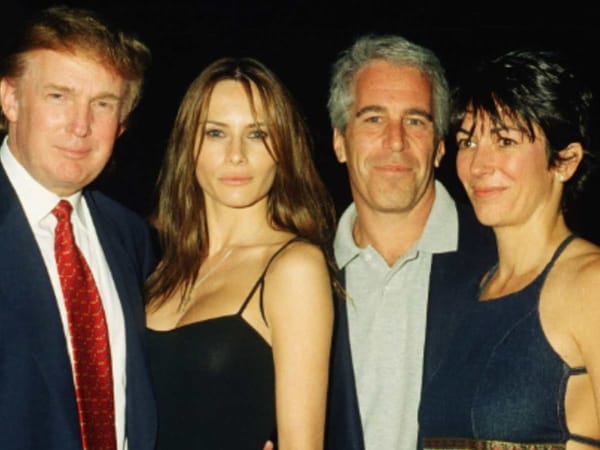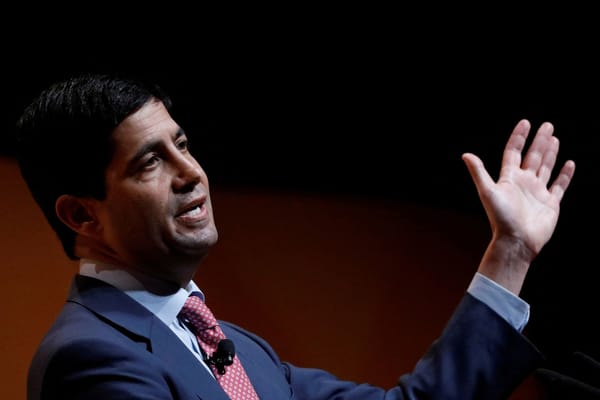Les mesures protectionnistes de Trump ont un immense bienfait : elles permettent de démasquer brutalement ceux qui jouaient sur la corde libertarienne depuis plusieurs années, et qui se découvrent aujourd’hui partisans d’un protectionnisme sans nuance… Nous avons déjà consacré une capsule à ce sujet ce week-end. C’est l’occasion, pour Arthur Cyclops, de nous rappeler quelles étaient les positions de l’un des fondateurs du libertarisme, le député français Frédéric Bastiat.
Les arguments de Frédéric Bastiat contre le protectionnisme
Frédéric Bastiat (1801-1850), économiste et écrivain français, est l’une des figures les plus emblématiques du libéralisme économique et un critique virulent du protectionnisme. À son époque, le protectionnisme était largement défendu en France, notamment par des industriels et des politiciens qui voyaient dans les barrières tarifaires un moyen de protéger les industries nationales contre la concurrence étrangère, en particulier celle du Royaume-Uni, alors en pleine révolution industrielle. Bastiat, dans des œuvres comme Sophismes économiques (1845-1848) et Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas (1850), a développé une série d’arguments pour démontrer que le protectionnisme était non seulement inefficace économiquement, mais aussi nuisible à la société dans son ensemble. Voici une analyse détaillée de ses principaux arguments :
1. Le protectionnisme favorise les producteurs au détriment des consommateurs
Bastiat soutenait que les tarifs douaniers, en augmentant le prix des biens importés, enrichissaient artificiellement certains producteurs locaux tout en appauvrissant les consommateurs. Dans son célèbre essai satirique Pétition des fabricants de chandelles (Sophismes économiques), il imagine les fabricants de chandelles demandant au gouvernement de bloquer la lumière du soleil, un « concurrent déloyal » qui fournit gratuitement de la lumière. Cette reductio ad absurdum montre que protéger une industrie spécifique revient à sacrifier le bien-être général pour les intérêts d’une minorité. Pour Bastiat, le libre-échange permettait aux consommateurs d’accéder à des biens moins chers et de meilleure qualité, augmentant ainsi leur pouvoir d’achat et leur niveau de vie.
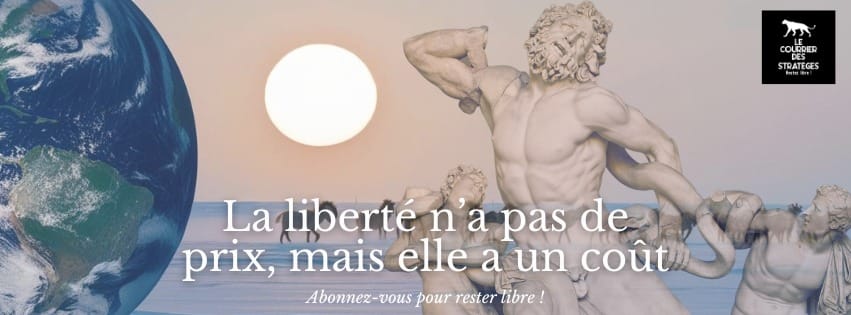
2. La distinction entre « ce qu’on voit » et « ce qu’on ne voit pas »
Un des concepts fondamentaux de Bastiat, introduit dans Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, est l’idée que les politiques protectionnistes se concentrent sur des effets visibles (comme la préservation d’emplois dans une industrie protégée) tout en ignorant les effets invisibles (la destruction d’emplois ailleurs ou la perte de richesse globale). Par exemple, protéger une industrie textile française par des tarifs peut sembler sauver des emplois dans ce secteur, mais cela augmente les coûts pour les consommateurs et réduit les opportunités dans d’autres secteurs qui dépendent de matières premières importées. Bastiat utilisait cette logique pour montrer que le protectionnisme créait une illusion de prospérité tout en engendrant une perte nette pour l’économie.
3. Le protectionnisme perturbe l’harmonie économique naturelle
Dans Harmonies économiques (1850), Bastiat défendait l’idée que le marché libre, basé sur la propriété privée et l’échange volontaire, créait une harmonie naturelle entre les intérêts individuels et collectifs. Le protectionnisme, en introduisant des interventions étatiques, perturbait cet équilibre en favorisant certains groupes au détriment d’autres, engendrant des conflits d’intérêts artificiels. Il comparait souvent les tarifs à une forme de « pillage légal », où l’État utilisait son pouvoir pour redistribuer la richesse au profit de quelques privilégiés, une idée qu’il développait également dans La Loi (1850).
4. Le protectionnisme mène à des inefficacités économiques
Bastiat argumentait que les barrières commerciales empêchaient les nations de se spécialiser dans les domaines où elles étaient les plus efficaces, un principe proche de la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Dans Sophismes économiques, il ridiculisait l’idée qu’une nation devait produire tout elle-même, soulignant que le commerce international permettait à chaque pays de tirer parti de ses ressources et compétences spécifiques. Par exemple, il dénonçait l’absurdité de protéger des industries françaises peu compétitives alors que des importations moins coûteuses auraient libéré des ressources pour d’autres secteurs plus productifs.
5. Le protectionnisme comme source de tensions internationales
Enfin, Bastiat voyait dans le protectionnisme une menace pour la paix. Il estimait que le commerce libre favorisait la coopération entre les nations, tandis que les barrières tarifaires engendraient des rivalités et des conflits. Cette idée, résumée dans la maxime souvent attribuée à Bastiat (bien que non littérale) « Quand les marchandises ne franchissent pas les frontières, les armées le font », reflète sa conviction que le libre-échange était un vecteur d’harmonie globale.
Quelques ouvrages ou articles à consulter
Pour approfondir cette analyse, n’hésitez pas à vous référer à quelques oeuvres de Frédéric Bastiat :
- Sophismes économiques (1845-1848) : Disponible en français ou en traduction anglaise (par exemple, chez Liberty Fund). Cet ouvrage regroupe ses essais satiriques, dont la Pétition des fabricants de chandelles, qui illustre brillamment ses arguments contre le protectionnisme.
- Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas (1850) : Un texte clé où Bastiat expose son concept d’effets visibles et invisibles, avec des exemples comme le « mythe de la vitre cassée ».
- Harmonies économiques (1850) : Publié partiellement de son vivant, ce livre développe sa vision d’une économie harmonieuse sans intervention étatique.
- La Loi (1850) : Bien que centré sur la justice et le rôle de l’État, il critique le protectionnisme comme une forme de pillage légal.
Mais aussi :
- Robert Leroux, Lire Bastiat : Science économique et libéralisme (Hermann, 2008) : Une analyse moderne des idées de Bastiat, avec un focus sur son opposition au protectionnisme.
- Murray Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought (1995) : Rothbard loue Bastiat pour sa clarté et son influence sur les idées libertariennes, notamment contre le protectionnisme.
- The Collected Works of Frédéric Bastiat (Liberty Fund, 2011-2017), édité par Jacques de Guenin : Une compilation exhaustive en six volumes, offrant un accès complet à ses écrits en anglais.
Influence de Bastiat sur la science économique post-1850
Bien que Bastiat soit mort jeune en 1850 et n’ait pas développé de théorie économique entièrement nouvelle, son influence sur la science économique et la pensée politique a été significative, notamment après sa mort. Voici quelques aspects clés :
- Précurseur de l’école autrichienne :
- Bastiat a influencé des figures comme Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, membres de l’école autrichienne. Son accent sur les conséquences invisibles des politiques économiques préfigure le concept d’ »ordre spontané » de Hayek. Par exemple, dans La Route de la servitude (1944), Hayek reprend implicitement l’idée que les interventions étatiques, comme le protectionnisme, engendrent des effets imprévus et néfastes.
- Son concept d’opportunité coûtée, introduit dans Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, bien que non nommé ainsi, a été formalisé plus tard par l’économiste autrichien Friedrich von Wieser, montrant une continuité avec les idées de Bastiat.
- Impact sur la pédagogie économique :
- La clarté et l’humour de Bastiat ont fait de ses écrits des outils pédagogiques durables. La Pétition des fabricants de chandelles est encore citée dans des manuels comme Economics de Paul Samuelson, soulignant son rôle dans la vulgarisation des idées économiques. Henry Hazlitt, dans Economics in One Lesson (1946), s’inspire directement de Bastiat pour expliquer les effets cachés des politiques publiques.
- Défense du libre-échange :
- Bastiat a inspiré le mouvement pour le libre-échange au-delà de la France, notamment via son admiration pour Richard Cobden et la Ligue contre les lois sur les céréales en Angleterre. Ses idées ont résonné dans les débats sur la globalisation aux 19e et 20e siècles, influençant des économistes et des politiques favorables à l’ouverture des marchés.
- Critique de l’interventionnisme :
- Sa vision du « pillage légal » a trouvé un écho chez les libertariens modernes, comme Murray Rothbard, qui voyait en Bastiat un pionnier de la critique systématique de l’État. Cette perspective a nourri les débats sur le rôle de l’État dans l’économie, notamment aux États-Unis au 20e siècle.
Cependant, son influence théorique directe reste limitée dans les cercles académiques mainstream, où il est parfois réduit à un pamphlétaire brillant plutôt qu’à un théoricien systématique. Joseph Schumpeter, par exemple, reconnaissait son talent mais doutait de sa profondeur analytique. Pourtant, dans les cercles libéraux et autrichiens, Bastiat reste une référence incontournable pour sa capacité à articuler des principes économiques fondamentaux avec une clarté intemporelle.
En conclusion, les arguments de Bastiat contre le protectionnisme reposaient sur une défense des consommateurs, une analyse des effets invisibles, une vision harmonieuse du marché, et une critique des inefficacités et tensions qu’il générait. Ses écrits, accessibles via ses œuvres originales et des études modernes, ont marqué la science économique en influençant les idées de liberté économique et en offrant des outils pédagogiques durables, même si son legs théorique reste plus diffus que celui de Ricardo ou Smith.