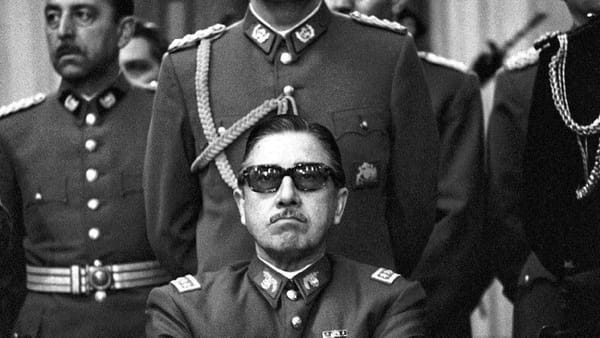Alors que 100 000 Français seraient contraints de financer les frais de parents maltraitants ou absents, la proposition de loi visant à se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent "défaillant" divise le Sénat. Derrière le combat des victimes, un affrontement entre justice morale et tradition juridique.

Peut-on être forcé de subvenir aux besoins d’un parent qui vous a détruit ?
C’est à cette question sensible que le Sénat tente de répondre avec la proposition de loi déposée par le sénateur Xavier Iacovelli, visant à permettre aux enfants victimes de se libérer de leur obligation alimentaire envers un parent défaillant. Portée par des collectifs de victimes, cette réforme s’attaque à un pilier du Code civil : la solidarité familiale. Mais le rapport de la sénatrice Marie Mercier juge le texte juridiquement « dangereux » et inopportun.
Une rupture avec deux siècles de droit civil
Depuis 1804, les articles 203 et 205 du Code civil établissent des devoirs réciproques entre parents et descendants : les parents doivent nourrir et élever leurs enfants (article 203), et, en retour, les enfants « doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » (article 205). Cette obligation est un devoir d'assistance matérielle, non morale.
La proposition de loi défendue par Xavier Iacovelli entendait instaurer une procédure de « décharge » de l’obligation alimentaire par simple acte notarié, sans justification ni contrôle judiciaire. Ce dispositif, ouvert aux 18-30 ans, aurait permis à un enfant de rompre unilatéralement son obligation de subvenir aux besoins d’un parent considéré comme « défaillant ».
Le parent concerné disposerait alors de six mois pour contester cette décision, à charge pour lui de prouver sa « bienveillance » passée. En contrepartie, l’enfant perdrait ses droits successoraux.
Mais pour la rapporteuse Marie Mercier (Les Républicains), ce texte bouleverse un principe fondamental : la réciprocité de la solidarité familiale. Dans son rapport sénatorial (n°38, 2025), elle souligne que cette réforme « introduirait une rupture majeure dans le droit civil français », et que le droit actuel — notamment l’article 207 du Code civil — permet déjà au juge de décharger un enfant de cette obligation en cas de manquements graves du parent.
La sénatrice redoute aussi un « effet d’aubaine », où certains enfants pourraient utiliser la loi pour rompre les liens pour des raisons affectives ou patrimoniales, au détriment de la solidarité nationale qui financerait alors les EHPAD.
Le paternalisme bureaucratique contre la liberté individuelle
Le rapport de la Sénatrice Marie Mercier et le rejet de la Commission des Lois révèlent la véritable nature de la résistance de l'État : le maintien du contrôle et la protection du budget.Le Sénat s'oppose au mécanisme d'auto-décharge pour deux raisons principales :
1. L’idéologie de la solidarité forcée
Les critiques institutionnelles insistent sur la nécessité du « contrôle juridictionnel » (le JAF). Ce recours obligatoire à la justice n’est rien d’autre qu’un paternalisme d'État qui refuse de faire confiance au jugement de l’individu. Selon cette vision, l'enfant n'est pas apte à décider seul de ses liens et de ses finances ; seul le Juge, représentant du Léviathan, peut valider sa liberté. C'est une négation de la maturité et de l'autonomie.
2. L’"effet d'aubaine" : la peur du coût
Le cœur de la contestation réside dans la peur de l’« effet d'aubaine » (le risque d'abus) et du transfert de charge sur la Solidarité Nationale. En clair : si les enfants ne sont plus forcés de payer, c’est l’État (donc le contribuable) qui devra assumer la pleine charge des frais d'hébergement.
Le Sénat ne défend pas un principe éthique supérieur. Il défend une ligne budgétaire. Le rejet de la PPL est un aveu : l'obligation alimentaire est maintenue parce qu'elle est un outil d’optimisation fiscale pour la puissance publique, un moyen de minorer le coût réel du système de protection sociale. La « solidarité familiale » n'est qu'un euphémisme pour désigner la privatisation forcée d’un coût public.
Un texte entre justice morale et désordre juridique
Pour ses défenseurs, cette loi répare une injustice profonde : le système actuel impose à la victime de prouver les violences ou les carences parentales, souvent des décennies après les faits.
Mais pour la commission des lois du Sénat, le texte introduit des notions floues (« parent défaillant », « bienveillance ») et renverse la charge de la preuve, instaurant une présomption de culpabilité parentale contraire aux principes du procès équitable.
De plus, la procédure notariale, sans contrôle judiciaire, ferait peser sur les notaires un rôle quasi juridictionnel, alors que le rapport Mercier rappelle que le juge aux affaires familiales reste le garant naturel de ces arbitrages intimes.
Enfin, le texte priverait l’enfant de toute part d’héritage — une sanction jugée disproportionnée par les juristes entendus, qui parlent d’une « double peine inversée ».
La commission des lois, suivant les conclusions de la sénatrice Mercier, a rejeté la proposition au motif qu’elle serait à la fois juridiquement fragile et socialement risquée. Mais le débat dépasse le droit : il interroge la société française sur la nature même du lien familial. Peut-on obliger un enfant à aimer, à pardonner, à payer ?