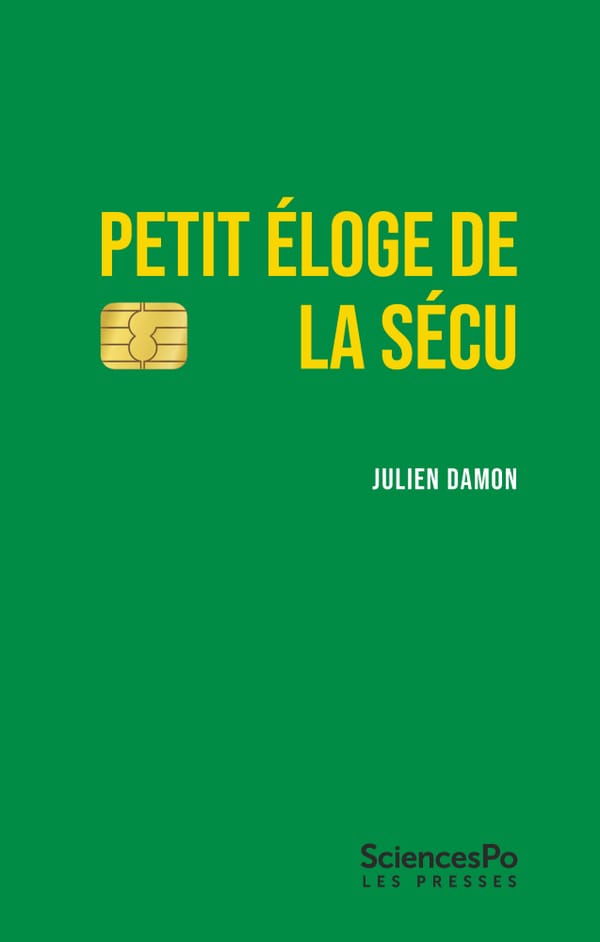En 2023, le Courrier avait pris des risques en annonçant qu'Emmanuel Macron ne disposait pas de la légitimité nécessaire pour faire passer la réforme des retraites qu'il proposait. Quelques 49-3, une dissolution et plusieurs Premiers Ministres plus tard, notre annonce se vérifie.

L'épisode de la réforme des retraites de 2023 restera dans les annales non comme une crise sociale, mais comme le moment de vérité d'un système politique à bout de souffle. Ce ne fut pas une bataille pour ou contre deux années de travail supplémentaires ; ce fut la mise à nu d'une rupture de contrat fondamentale entre la caste dirigeante et le pays réel, qui débouche aujourd'hui sur une instabilité ministérielle chronique, une crise institutionnelle, et une suspension jusqu'en 2027 au moins.
Loin d'être un simple ajustement paramétrique, cette séquence a révélé la nature profonde de la Cinquième République sous Macron : une monarchie technocratique qui, privée de légitimité populaire, n'a plus que la force constitutionnelle pour imposer sa volonté.
Ce qui s'est joué n'est rien de moins que la faillite du consentement. L'affaire des retraites a démontré qu'un pouvoir légalement constitué peut agir en opposition frontale avec la quasi-totalité du corps social, des syndicats et même d'une majorité de ses propres électeurs, sans autre justification que sa propre survie. C'est le symptôme d'une crise de la représentation si profonde qu'elle confine à la crise de régime.
Le prétexte économique : un système coûteux, trop coûteux
Toute cette affaire a été construite sur une affirmation fondatrice : l'urgence d'un déficit insoutenable. Le gouvernement a brandi les rapports du Conseil d'Orientation des Retraites (COR) comme un totem, en sélectionnant les projections les plus alarmistes pour justifier une réforme "inéluctable". Pourtant, le président du COR lui-même a publiquement démenti cette lecture apocalyptique, affirmant que les dépenses "ne dérapent pas" et sont globalement stabilisées en part de PIB.

La vérité est que le "déficit" n'a jamais été la cause, mais le prétexte. Au coeur du pouvoir a sévi l'avachissement de la volonté, le recours à la facilité. Alors que le Courrier a régulièrement proposé de faire bouger les lignes en adoptant une réforme à la néerlandaise ou à l'allemande, consistant à laisser à chaque Français le libre choix de son régime parmi les dizaines de caisses existantes, ce qui aurait évité la crise sociale, l'obsession du jardin à la française (une seule caisse, un seul régime pour tout le monde) a triomphé. Il faut ratiboiser le fonctionnement trop "girondin" de la société française et le réduire à une grande machine uniforme, sauf pour les fonctionnaires, bien entendu, qui doivent garder leurs privilèges.
Cette vision monolithique de la société a préparé un désastre majeur, dont nous comptons encore les points.
Le coup de force légal : le 49.3 comme aveu de faiblesse
La méthode employée en son temps pour faire passer la loi est encore plus révélatrice que son contenu. Le gouvernement a délibérément choisi un parcours parlementaire conçu pour étouffer le débat : un projet de loi de finances rectificatif, permettant de limiter drastiquement le temps de parole via l'article 47-1. Face à une opposition qui, par une obstruction stérile de milliers d'amendements, a parfaitement joué le rôle de l'idiot utile, l'exécutif a pu dérouler sa stratégie de contournement.

L'apothéose de ce déni démocratique fut le recours à l'article 49.3. Incapable de trouver une majorité, même en comptant sur une droite républicaine en pleine décomposition, le gouvernement a préféré engager sa responsabilité plutôt que de risquer un vote. Cet acte, bien que constitutionnel, a été un suicide politique. Il a signifié au pays tout entier que la représentation nationale n'était plus qu'une chambre d'enregistrement, un décor que l'on peut ignorer lorsque le monarque présidentiel a décidé. Le fait que la motion de censure qui a suivi ait échoué à seulement neuf voix près n'a fait que confirmer l'illégitimité profonde d'une loi adoptée sans l'onction du vote.
Le 49.3 n'est pas un outil de stabilité ; c'est l'arme nucléaire d'un pouvoir qui a perdu la bataille du consentement et qui ne peut plus gouverner que par la contrainte. C'est la signature d'une "pratique solitaire du pouvoir"qui a transformé le parlementarisme en une simple formalité.
Le mandat inexistant : le péché originel de 2022
Cette crise de légitimité plonge ses racines dans l'élection présidentielle de 2022. La réélection d'Emmanuel Macron n'a été qu'un trompe-l'œil. Obtenue sur fond d'abstention record et grâce à un "vote de barrage" massif contre l'extrême droite, elle ne lui a conféré aucun mandat positif pour une réforme aussi clivante. Le Président a été élu contre Marine Le Pen, pas pour le report de l'âge de la retraite.
Ignorer cette réalité relève d'une arrogance politique qui a directement mené à la confrontation. En considérant son élection comme un chèque en blanc, l'exécutif a confondu la légalité de son pouvoir avec sa légitimité. Or, la légitimité n'est pas un acquis, c'est une confiance qui se mérite et s'entretient. En gouvernant comme s'il disposait d'une majorité d'adhésion qu'il n'a jamais eue, Emmanuel Macron a scié la branche sur laquelle il était assis.

La crise des retraites est la conséquence directe de ce péché originel : un pouvoir qui agit sans mandat clair est condamné à la brutalité pour imposer ses vues.
La société contre l'État : une double impasse
Face à ce pouvoir vertical, la société s'est unie comme rarement. Les mobilisations, d'une ampleur historique, ont rassemblé des millions de Français sous une bannière intersyndicale unanime. L'opinion publique, de manière constante, a massivement rejeté la réforme. Nous avons assisté à la reconstitution d'un "pays réel" opposé au "pays légal".
Cependant, il ne faut pas idéaliser cette opposition. Les syndicats, en se focalisant exclusivement sur le retrait de la réforme, ont montré leur propre enfermement idéologique. En refusant d'ouvrir le débat sur de véritables alternatives structurelles – comme l'introduction d'une part de capitalisation ou la remise en cause du monopole de la répartition –, ils ont prouvé qu'ils n'étaient que les gardiens d'un système étatiste à bout de souffle. Leur combat n'était pas celui de la liberté individuelle, mais celui de la préservation d'un corporatisme qui a fait la preuve de son inefficacité.

Le pays s'est donc retrouvé piégé entre un État autoritaire et des corps intermédiaires conservateurs, tous deux incapables de proposer une vision d'avenir pour l'individu.
La victoire du cynisme et la montée des extrêmes
Les suites de la crise ont été désastreuses pour le pouvoir. La tentative de "cent jours d'apaisement" s'est transformée en une tournée de "casserolades", symbole d'un divorce consommé avec le peuple. Loin de restaurer l'autorité, la séquence a durablement ruiné la confiance et installé un climat de défiance généralisée.

Politiquement, le grand gagnant de cette faillite est le Rassemblement National. En adoptant une posture d'opposition institutionnelle, loin de l'obstruction chaotique de La France Insoumise, le parti de Marine Le Pen a su capter la colère populaire tout en se drapant d'une nouvelle crédibilité. La crise des retraites a été un formidable accélérateur de sa "normalisation". En brutalisant le pays, le macronisme a offert au RN son meilleur argument : celui d'être la seule alternative à un système perçu comme méprisant et déconnecté. Les résultats des élections qui ont suivi ne sont que la traduction logique de ce réalignement.
La nécessaire révolution de la Liberté
La crise des retraites de 2023 a été le diagnostic implacable d'une démocratie malade. Malade de son hyper-présidentialisme, qui permet à un seul homme de décider contre tous. Malade de la faiblesse de son Parlement, réduit à un rôle de figuration. Malade de la déconnexion de sa caste dirigeante, qui confond la détention légale du pouvoir et le consentement populaire.
Face à cette impasse, les appels à une VIe République ne sont qu'un emplâtre sur une jambe de bois, une tentative de remplacer une forme d'étatisme par une autre. La véritable crise n'est pas celle des institutions, mais celle de la philosophie qui les anime : une philosophie étatiste, centralisatrice et collectiviste qui nie la souveraineté de l'individu.
La seule sortie par le haut ne viendra pas d'un nouveau bricolage constitutionnel, mais d'une véritable révolution libertarienne. Il est temps de rendre aux Français la maîtrise de leur destin, en commençant par leur retraite. Cela passe par la liberté de choix, l'introduction massive de la capitalisation, et la fin du monopole d'un système par répartition qui n'est qu'une pyramide de Ponzi légalisée.
La crise de 2023 n'était pas la fin de l'histoire. C'était un avertissement. Si nous ne répondons pas à cette soif de respect et de liberté par une refondation de notre contrat social autour de la responsabilité individuelle, alors la prochaine crise n'emportera pas seulement une réforme, mais le régime tout entier.