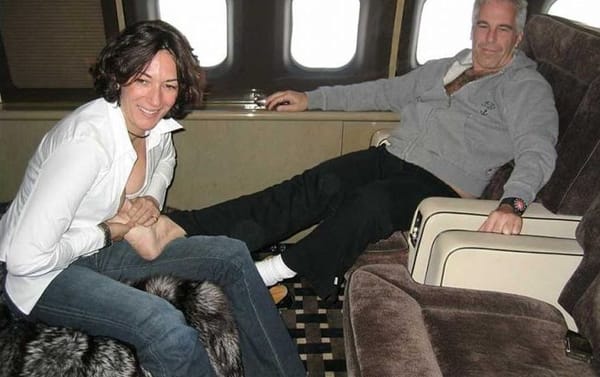Visiblement, la situation aux États-Unis est en train de dégénérer en une forme de guerre civile dont la gravité n’est pas encore mesurable. Peut-être sera-t-elle passagère, peut-être obligera-t-elle à une réaction beaucoup plus vigoureuse de la Maison Blanche. L’explosion du chômage avec la pandémie pose le problème de la solidité de nos démocraties face à la crise.
Il aura suffi de deux mois de pandémie aux États-Unis pour que les 20 millions de chômeurs (et les autres), soudain privés de couverture sociale, de salaires et parfois de voiture, faute de pouvoir la rembourser, pour que les « minorités » ne déchirent le pays. Comme nous l’avons si souvent vu en France, tout est parti d’une bavure policière dont un Afro-Américain a été victime… pour dégénérer en affrontement dans l’ensemble du pays.
Une bavure déchire les États-Unis
Tout a commencé le 25 mai, à Minneapolis, dans le Minnesota, au nord-est des États-Unis (donc loin du « racisme » du sud), lorsqu’un policier a étouffé un Afro-Américain de 46 ans, Georges Floyd, lors d’une interpellation trop musclée sur la voie publique. Dès le lendemain, des émeutes éclatent dans la ville. Entretemps, la responsable de la police de Minneapolis avait licencié les 4 policiers impliqués dans l’interpellation, pour faute.
Le lendemain, des émeutes éclatent un peu partout aux États-Unis, y compris dans des villes réputées pour leur « vivre ensemble » comme Los Angeles. Très rapidement, la situation semble s’enkyster, avec un Donald Trump qui publie des tweets relativement violents (censurés par Twitter) appelant à une réponse ferme, au besoin à une intervention militaire pour rétablir l’ordre.
On apprend d’ailleurs que l’armée est désormais mise en alerte pour reprendre la ville en main. Aux États-Unis, cette décision semble bien évidemment une rupture dans l’histoire d’un pays épargné par les guerres sur son sol depuis plus de cent ans… qui ne va pas sans rappeler le tension des années 50 autour de l’affaire de Little Big Rock.
Pour beaucoup d’États en sortie de confinement, le spectacle offert par les rues américaines aujourd’hui est évidemment source de réflexion. Sommes-nous exposés au risque de subir le même sort ? Les troubles sociaux qui se déchaînent de l’autre côté de l’Atlantique sont-ils la préfiguration de tout ce que nous avons craint, et que nous craignons en France depuis plusieurs semaines ? De fait, une explosion du même ordre ne surprendrait personne en France tant elle est annoncée pour des motifs exactement similaires: précarité due à une crise foudroyante, ras-le-bol, apparence de conflit ethnique.
Please Retweet This MADNESS!!!!
— Colin (@SavedByKalel) May 31, 2020
This Is What’s Happening In New York!#BlackLivesMatter #BLACK_LIVE_MATTER #riots2020 #protests #GeorgeFloyd #NYCPROTEST #GeorgeFloydMurder pic.twitter.com/e6mPFO7ocq
Émeutes raciales ou émeutes de la faim ?En parcourant la presse américaine, on comprend que les commentateurs hésitent entre une analyse sociale et une analyse ethnique de la situation. Le dosage entre les deux explications varient selon les commentateurs. Les plus à gauche expliquent que l’Amérique de Trump est tellement clivée ethniquement que, d’un coup d’un seul, deux siècles de racisme reviennent au galop. Les plus à droite mettent en avant les pillages auxquels la revendication raciale sert de prétexte et soulignent les conséquences du chômage et du confinement sur la population et son état d’esprit, non sans pointer du doigt le rôle des agitateurs et des extrémistes. Vue de France, on a quand même du mal à ne pas penser qu’il existe un lien direct entre l’angoisse et la précarité issues du confinement, et l’agitation politique et sociale qui s’ensuit. Trump ou pas…
Le rôle de Trump critiqué
De façon très emblématique, Donald Trump a choisi d’adopter une ligne dure face aux désordres, ce qui a heurté de plein fouet la culture de l’excuse aussi en vigueur aux États-Unis. Dans la pratique, il est vrai que Donald Trump n’y est pas allé de main morte en écrivant (nous reproduisons le tweet ci-dessous): « quand les émeutes commencent, les tirs commencent », laissant entendre que l’armée était prête à tirer à balles réelles sur les émeutiers.
De fait, tout le monde a compris de quoi il s’agissait, même si, en France, les journalistes bien-pensants se sont rués sur cette nouvelle preuve présumée de folie du président américain. Trump fait de la politique. En pleine période électorale, il joue son électorat, hostile aux émeutiers, contre celui des démocrates. On notera que Joe Biden a finalement condamné les violences, après que son équipe a fait un don à une association qui se porte caution pour les émeutiers arrêtés.
Dans la pratique, les conditions sont réunies pour une campagne électorale proche de la guerre civile aux États-Unis.
….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020
En sortir par un affrontement avec la Chine
Pour Donald Trump, la situation est assez simple à comprendre « géométriquement ». Les élections présidentielles approchent et les Américains ne résistent jamais à l’appel de l’autorité lorsque le leadership américain sur le monde est menacé. Sur le plan intérieur, la crise économique fait les ravages que l’on voit dans les rues des grandes villes américaines.
Alors pourquoi ne pas détourner l’attention des affaires intérieures en attisant un conflit de plus en plus ouvert avec la Chine ? Cette solution vieille comme le monde, abondamment pratiquée depuis plus de cent ans sur la scène internationale, a commencé à montrer ses premiers effets. Alors que la Chine rêve manifestement de reprendre en main Hong-Kong, mais aussi la Chine nationaliste de Taïwan, Trump commence à donner de grands coups de moulinet dans les airs.
Pour l’instant, Trump joue sa partition de façon suffisamment intelligente pour que le conflit ne dégénère pas. Mais on ne peut s’empêcher de penser, le moment venu, faire monter la tension constituerait une réponse tentante à la crise intérieure américaine née de l’effondrement économique brutal du pays, comme nous l’avons déjà évoqué.
Un cas d’école pour la France
Certains Français ont la tentation de se moquer de Trump, mais on ne peut s’empêcher de penser que ce qui se passe aux États-Unis est le laboratoire de ce qui pourrait se passer en France. On sent bien qu’au sortir du confinement, le déferlement des passions est possibles, et pourrait conduire le pays, et singulièrement le pouvoir exécutif, à une situation singulièrement dangereuse.
Empressons-nous donc de ne pas nous moquer des Américains, mais plutôt de les analyser pour prévenir au mieux la contagion, et même la pandémie de contestation sociale.