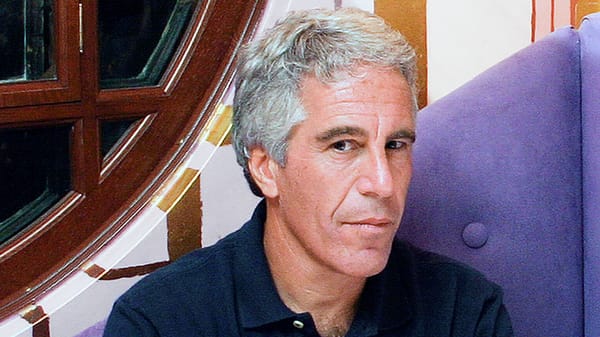Vous êtes nombreux à vouloir fuir notre pays, plombé par l'instabilité fiscale et par la cupidité des "bienveillants" qui, sous le prétexte de la "solidarité", préconisent le matraquage fiscal des fourmis pour préserver la rente des cigales. Voici un petit voyage en Europe pour savoir où la prédation sur les successions est la moins poussée.
Voici un "benchmark" complet des régimes de droits de succession à travers les 27 États membres de l'Union Européenne. Il détaille la profonde diversité des politiques fiscales nationales, qui contrastent fortement avec les efforts de l'UE pour harmoniser les aspects juridiques des successions transfrontalières.
Le paradoxe central de ce paysage réside dans la tension entre la certitude juridique offerte par le Règlement européen sur les successions (n° 650/2012) et la souveraineté fiscale jalousement gardée par les États membres. Il en résulte un système où la loi régissant qui hérite est unifiée, mais où la charge fiscale sur ce qui est hérité reste extrêmement disparate.
L'objectif de ce document de référence est de fournir un outil stratégique pour les particuliers fortunés, les expatriés et leurs conseillers. La structure progresse d'un cadre général (Partie I) à un benchmark comparatif de haut niveau (Partie II), suivi d'analyses approfondies de juridictions clés (Partie III) et de classes d'actifs critiques (Partie IV), pour aboutir à des recommandations stratégiques (Partie V).
I : Les cadres supranationaux et nationaux régissant les successions européennes
1.1 Le Règlement UE sur les successions (n° 650/2012) : unité juridique, fragmentation fiscale
Le Règlement européen n° 650/2012, applicable depuis le 17 août 2015 dans la plupart des États membres (à l'exception du Danemark et de l'Irlande), a introduit une révolution dans le traitement des successions internationales au sein de l'UE.
Le principe fondamental
Le règlement instaure le principe de l'unité successorale : « une seule succession, une seule loi ». Par défaut, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Ce critère s'applique à l'ensemble du patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier, et quel que soit son lieu de situation. Le caractère universel du règlement signifie que la loi désignée peut être celle d'un État non membre de l'UE, comme la Suisse, si le défunt y résidait.
Le pouvoir du choix (Professio Juris)
Une disposition essentielle du règlement est la possibilité pour toute personne de choisir, par testament, la loi de sa nationalité pour régir sa succession. Cette option, appelée professio juris, permet de déroger à la règle de la résidence habituelle. Elle est particulièrement stratégique pour les expatriés qui souhaitent que leur succession soit traitée selon les règles de leur pays d'origine, par exemple pour contourner des règles de réserve héréditaire jugées trop contraignantes dans leur pays de résidence.
La clause de neutralité fiscale
Le point le plus crucial pour ce benchmark est que le règlement est explicitement neutre sur le plan fiscal. Il détermine le cadre de droit civil (qui sont les héritiers, quelles sont leurs parts, etc.) mais laisse la question de l'imposition entièrement aux législations nationales et aux conventions fiscales bilatérales existantes. Cette séparation nette entre le civil et le fiscal a une conséquence majeure : en offrant une prévisibilité juridique claire quant à la loi applicable, le règlement a involontairement simplifié et rendu plus attractif le choix stratégique du pays de résidence pour des raisons fiscales. En stabilisant le volet juridique, il a fait de la résidence le principal levier d'optimisation fiscale successorale, encourageant de fait le "forum shopping" fiscal vers des pays comme l'Italie ou le Portugal.
1.2 Principes de territorialité fiscale : les racines de la double imposition
L'absence d'harmonisation fiscale au niveau de l'UE signifie que chaque État membre applique ses propres critères pour revendiquer le droit d'imposer une succession. Ces critères, ou "facteurs de rattachement", se chevauchent souvent, créant des situations de double, voire de triple, imposition. Les trois principaux critères sont :
- La résidence ou le domicile du défunt : de nombreux pays, comme l'Allemagne, appliquent une obligation fiscale illimitée (unbeschränkte Steuerpflicht), imposant l'intégralité du patrimoine mondial du défunt si celui-ci était résident allemand au moment du décès.
- La résidence ou le domicile de l'héritier : la France applique une règle particulièrement extensive. Un héritier qui a son domicile fiscal en France au jour du décès, et l'a eu pendant au moins six des dix années précédentes, est imposable sur la totalité des biens qu'il reçoit, y compris ceux situés à l'étranger.
- Le lieu de situation des biens (situs) : c'est le critère le plus universel. Presque tous les pays imposent les biens situés sur leur territoire, notamment les biens immobiliers, indépendamment de la résidence du défunt ou de l'héritier.
Le conflit inévitable entre ces principes est la cause directe des charges fiscales punitives dans les successions transfrontalières. Par exemple, un défunt résident en Allemagne (critère 1) lègue son patrimoine mondial, incluant un bien immobilier en Espagne (critère 3), à son enfant résidant de longue date en France (critère 2). L'Allemagne cherchera à imposer la totalité de la succession. La France cherchera à imposer la totalité de l'héritage reçu par son résident. L'Espagne imposera le bien immobilier situé sur son sol. Sans convention fiscale adéquate, le bien espagnol pourrait être imposé trois fois, et le reste du patrimoine deux fois, illustrant l'échec de la coordination fiscale au sein du marché unique.
1.3 Le réseau de conventions fiscales bilatérales : une solution incomplète
Pour atténuer ces doubles impositions, les États membres s'appuient sur un réseau de conventions fiscales bilatérales. Ces traités visent à répartir les droits d'imposition entre les deux États signataires ou à obliger l'État de résidence à accorder un crédit d'impôt pour l'impôt payé dans l'autre État.
Cependant, ce réseau est loin d'être complet et cohérent. L'Italie, par exemple, n'a signé que quelques conventions en matière de succession (avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Suède, la Grèce, le Danemark et Israël). De même, l'Allemagne a des traités avec la France, la Grèce, le Danemark et la Suède au sein de l'UE. De nombreuses paires d'États membres de l'UE n'ont aucune convention entre elles. De plus, toutes les conventions ne couvrent pas les donations, créant des lacunes supplémentaires dans la protection des contribuables. En l'absence de traité, les héritiers doivent se fier aux mécanismes unilatéraux de chaque pays pour éviter la double imposition, qui sont souvent moins généreux ou inexistants.
II : Un benchmark pan-européen : classification des régimes de droits de succession
Pour clarifier ce paysage complexe, les États membres de l'UE peuvent être classés en plusieurs catégories distinctes en fonction de leur approche de la fiscalité successorale.