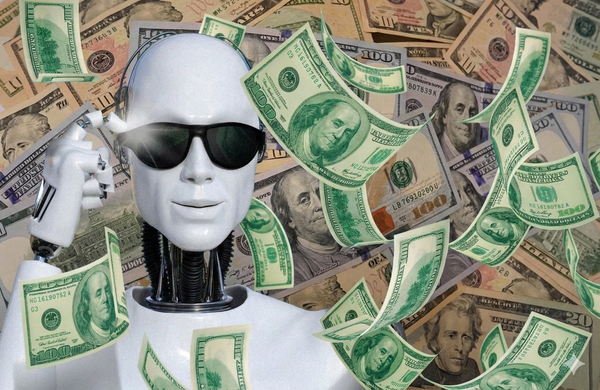Le gouvernement mauricien tire des revenus significatifs de l’exportation de macaques à longue queue (Macaca fascicularis) destinés à la recherche pharmaceutique américaine. Cependant, la décision de l’administration Trump d’imposer de nouveaux droits de douane risque de bouleverser cette industrie. L’île Maurice, qui fournit 60 % des primates utilisés dans la recherche américaine, craint un impact sur ses revenus et ses initiatives de conservation.

Maurice est devenu un fournisseur majeur de primates pour les laboratoires pharmaceutiques américains, expédiant 13 484 singes en 2023. Ces animaux jouent un rôle central dans le développement de vaccins, notamment ceux contre le COVID-19. L’Association des éleveurs de Cyno souligne leur contribution à la sauvegarde de « d’innombrables vies dans le monde ».L’exportation de macaques a connu une croissance exponentielle, passant de 20 millions de dollars de revenus par décennie à 86,6 millions de dollars en 2023. Le prix moyen d’un singe est monté à 2 236 dollars depuis 2014, et Maurice perçoit 200 dollars par unité, fonds réinvestis dans des initiatives de conservation.
Un impact économique majeur
En 2023,l’île Maurice a exporté 13 484 singes vers les États-Unis, représentant 60 % des primates utilisés dans la recherche pharmaceutique américaine. Les revenus générés par ces exportations ont atteint 86,6 millions de dollars en 2023, contre seulement 20 millions de dollars par décennie auparavant. Le prix moyen d’un singe est passé à 2 236 dollars en 2014, selon les déclarations du ministre Arvin Boolell en mars 2005. La mise en place d’une taxe supplémentaire par l’administration Trump pourrait rendre ces importations 40 % plus coûteuses pour les laboratoires américains. Maurice, qui assure 60 % de l’approvisionnement en macaques pour la recherche aux États-Unis, pourrait voir son secteur fragilisé.
Outre l’impact sur les singes, cette mesure tarifaire pourrait affecter d’autres industries phares du pays, notamment le sucre et le textile. Le ministre mauricien des Finances a déclaré qu’il envisageait de revoir à la hausse la part perçue par l’état sur chaque exportation, soulignant que les bénéfices actuels étaient relativement modestes.
Un enjeu scientifique, économique et écologique
D’un point de vue environnemental, les autorités mauriciennes considèrent les macaques à longue queue comme une espèce invasive. Leur présence pose des problèmes aux exploitations agricoles et constitue un danger pour les citoyens. Par conséquent, leur exportation n’est pas seulement une source de revenus, mais aussi une stratégie de gestion de la biodiversité locale.
Pour autant, le macaque à longue queue vient d’être classé en voie de disparition sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Cette dégradation de son statut s’explique par une intensification des captures, alimentant principalement la recherche médicale, mais aussi l’industrie du divertissement et, dans une moindre mesure, la consommation.Cette surexploitation menace désormais la survie de l’espèce, autrefois plus répandue.
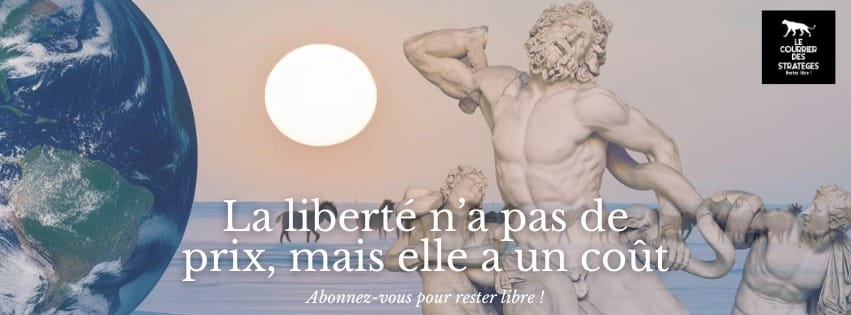
Outre les singes, les nouveaux tarifs « réciproques » américains pourraient également affecter les exportations de sucre et de textiles, deux autres piliers de l’économie mauricienne. Le taux de droit mauricien, l’un des plus élevés d’Afrique, pourrait amplifier l’impact négatif de ces mesures.
Les tarifs douaniers américains mettent en lumière la dépendance des laboratoires pharmaceutiques envers les singes mauriciens, tout en menaçant une source de revenus vitale pour le pays.Entre les enjeux financiers, scientifiques et environnementaux, Maurice devra ajuster sa stratégie pour maintenir un équilibre entre conservation, commerce et intérêts nationaux.