Confronté à une superposition de crises, notamment la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, le monde a perdu plus de cinq ans de progrès en matière de développement humain, selon l’ONU. Ce recul, touchant plus de 90 % des pays, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) tire la sonnette d’alarme : inégalités croissantes, ralentissement global, perte de confiance…Si certaines nations riches comme la Suisse, la Norvège ou l’Islande restent en tête du classement, d’autres, notamment en Afrique subsaharienne, en Amérique latine ou en Asie du Sud, subissent de plein fouet les effets en chaîne des crises. Le rapport du PNUD explore également le potentiel de l’IA pour relancer le développement humain.

Le dernier rapport du PNUD dresse un constat sans appel : plus de 90 % des pays du globe ont vu leur Indice de développement humain (IDH) reculer au cours des dernières années. Mesurant les progrès en termes de santé, d’éducation et de niveau de vie, cet indicateur témoigne d’une dégradation profonde et quasi généralisée, provoquée avant tout par la pandémie de Covid-19. En bas du classement, le Soudan du Sud, le Tchad et le Niger peinent à entrevoir un quelconque redressement. Bien que 2023 ait marqué un rebond jusqu’aux niveaux pré-COVID, le rapport 2024 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) révèle un ralentissement « inattendu et troublant ». Ce tassement, observé avant même les récentes coupes dans l’aide internationale, compromet l’objectif d’atteindre un haut niveau de développement d’ici 2030. Achim Steiner, patron du PNUD, avertit que ce rythme pourrait repousser cet objectif de plusieurs décennies, rendant le monde « moins sûr, plus divisé et plus vulnérable ».
Les crises en cascade aggravent les inégalités
La crise COVID a durement frappé, mais d’autres crises ont empêché une reprise durable. En Amérique latine, en Afrique sub-saharienne, en Asie du Sud et dans les Caraïbes, la guerre en Ukraine a exacerbé les problèmes de sécurité alimentaire et énergétique, des impacts non encore reflétés dans l’IDH 2021. Les inégalités persistent : la Suisse, la Norvège et l’Islande dominent le classement, tandis que le Soudan du Sud, le Tchad et le Niger restent en queue. L’ONU parle même d’un ralentissement « troublant » et « inattendu », survenu avant les récentes coupes dans l’aide internationale, notamment par les États-Unis, menacent d’aggraver la situation, avec des conséquences potentielles sur l’espérance de vie, les revenus et la stabilité. Le conflit en Ukraine, avec ses effets sur la sécurité alimentaire et énergétique, n’a fait qu’amplifier la détérioration du tissu socio-économique mondial.
Les experts du PNUD identifient un ralentissement des progrès en matière d’espérance de vie comme un facteur clé du recul de 2024. Ce phénomène pourrait être lié aux effets secondaires du COVID-19 ou à l’augmentation des conflits mondiaux. Si les causes précises restent à élucider, ce constat souligne la fragilité des avancées en santé publique face aux crises multiples. Sans interventions ciblées, ces tendances risquent de s’installer comme une « nouvelle norme », selon Steiner.
Le financement du développement en question
La réduction de l’aide internationale par les pays les plus riches, notamment les États-Unis, inquiète particulièrement les experts. Cette baisse des financements risque d’aggraver les fractures existantes, avec pour conséquences une baisse de l’espérance de vie, une recrudescence des conflits et un appauvrissement général.
Selon le PNUD, la dynamique actuelle appelle à une mobilisation rapide des ressources, sans quoi l’IDH poursuivra sa chute. Pour l’ONU, la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire pour contenir l’effet domino de ces crises interconnectées.
L’intelligence artificielle : opportunité ou menace ?
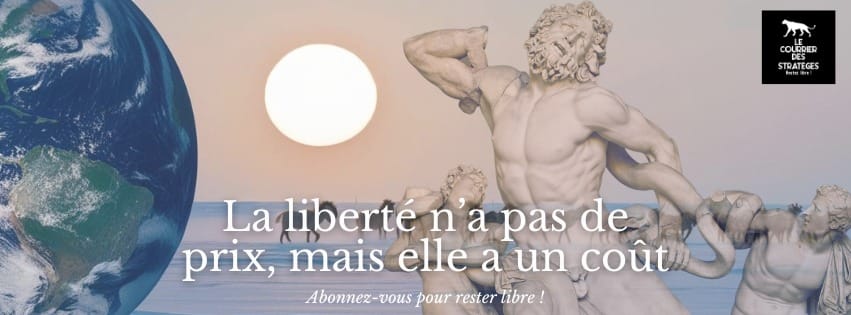
Le rapport du PNUD explore le potentiel de l’IA pour relancer le développement humain. Un sondage mené entre novembre 2024 et janvier 2025 auprès de 21 000 personnes dans 21 pays révèle que 20 % utilisent déjà l’IA, et 66 % prévoient de l’adopter pour l’éducation, la santé ou le travail.
Cependant, cette opportunité est à double tranchant.L’IA pourrait aggraver les inégalités si son accès reste concentré dans les pays riches, ou si elle reproduit des biais culturels issus de bases de données peu représentatives. Une étude citée dans le rapport révèle ainsi que les réponses générées par ChatGPT reflètent davantage la vision d’un individu issu d’un pays riche anglophone que celle d’un habitant d’un pays en développement.
Steiner insiste sur la nécessité de choix délibérés pour concevoir une IA collaborative, capable de créer des emplois nouveaux (60 % des sondés y croient) et de soutenir la recherche, notamment médicale.










